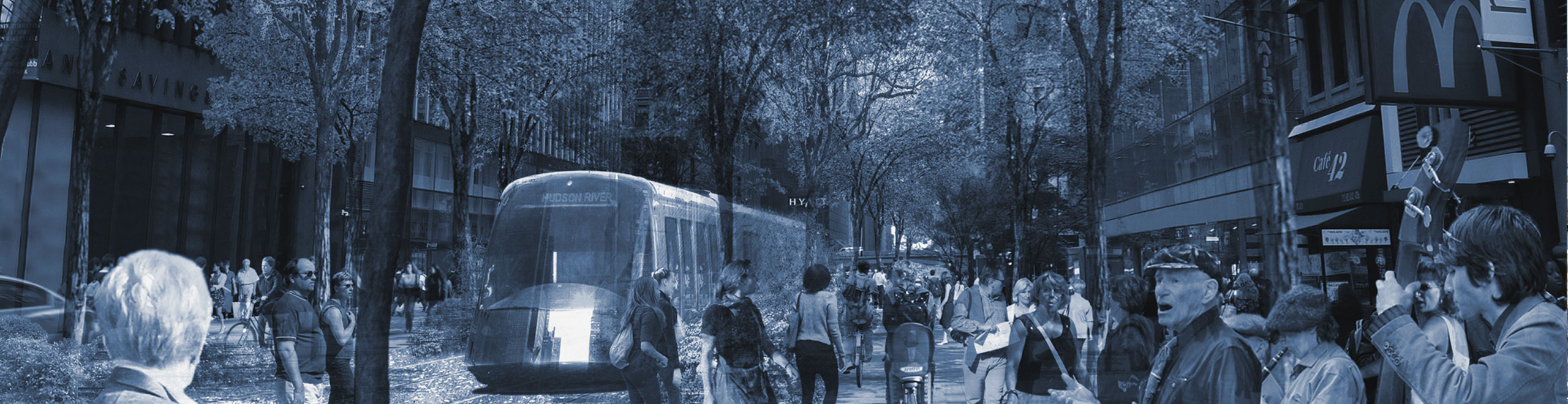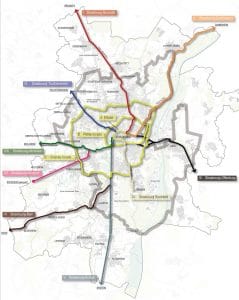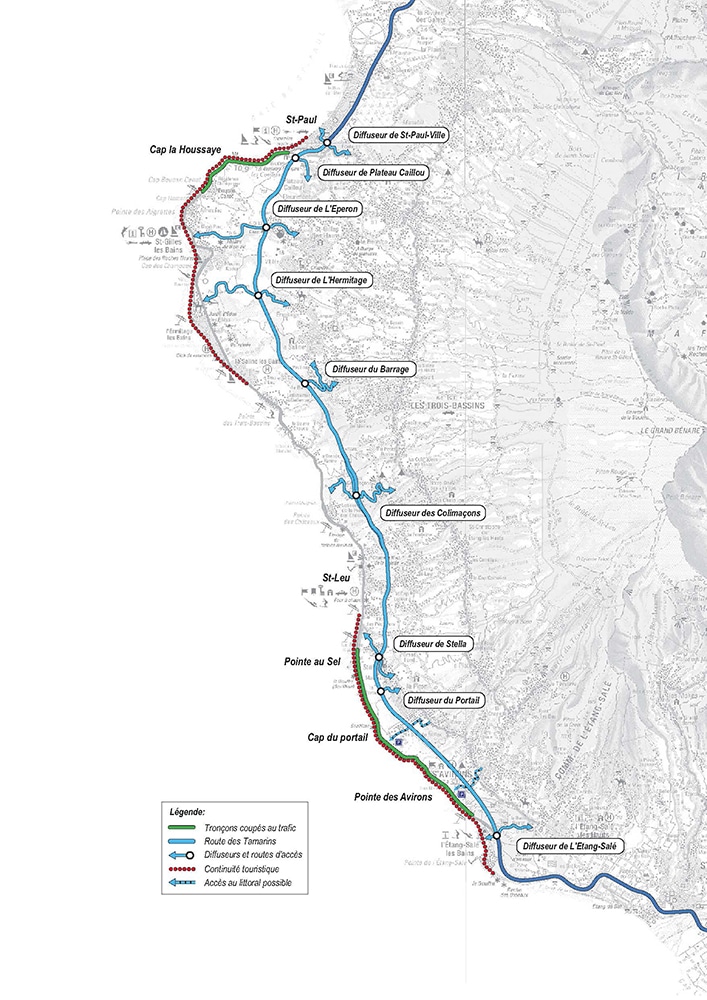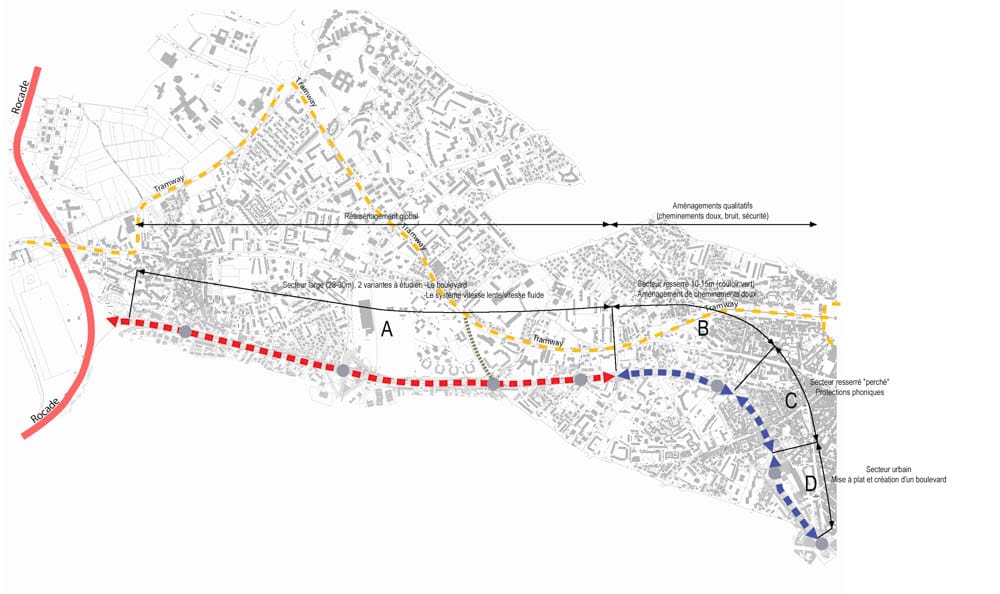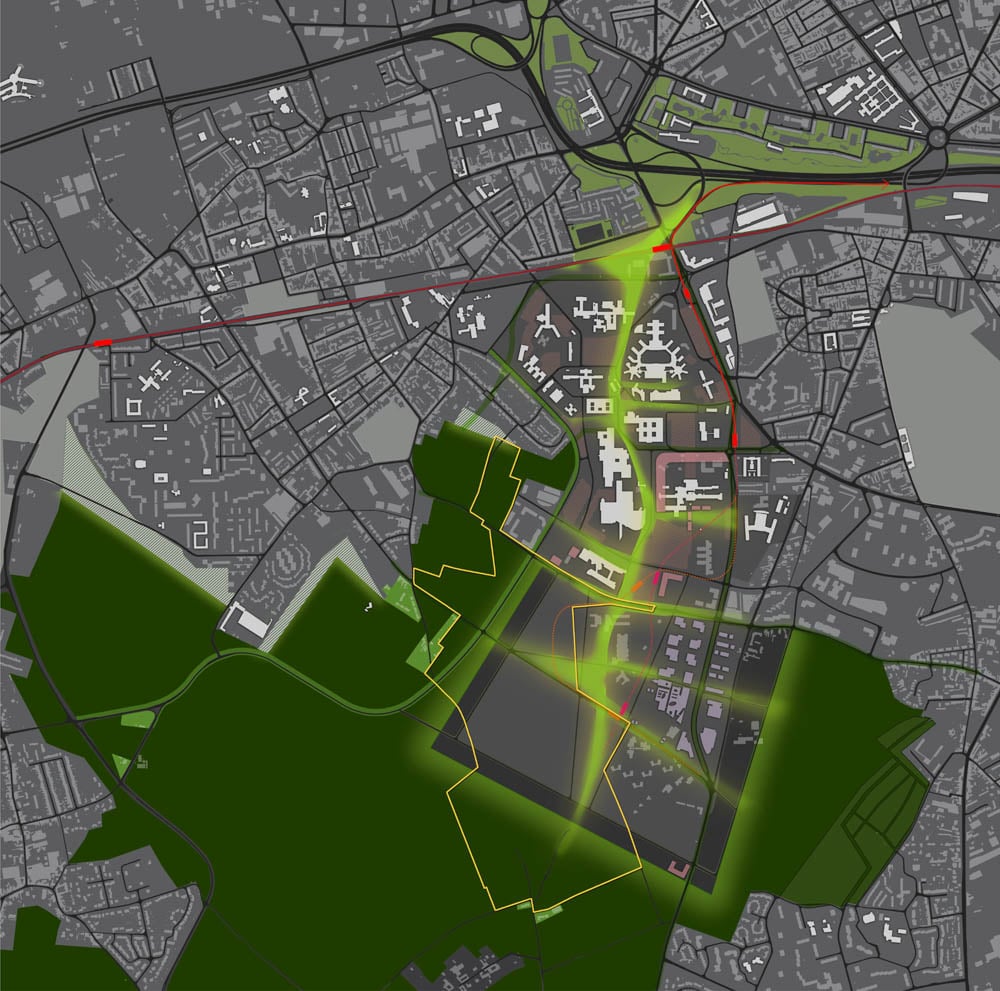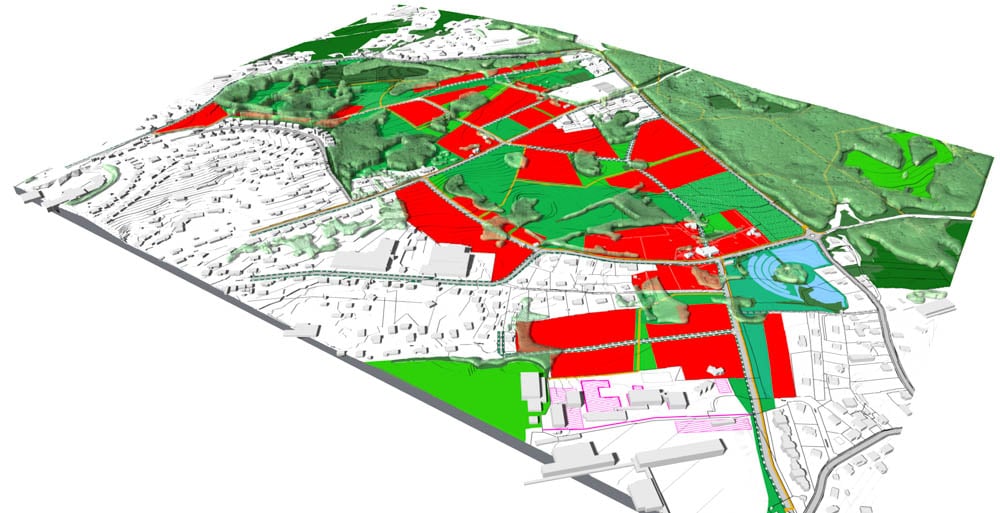Projet


Urbanisme
Mulhouse
Ville Nature
mou
Ville de Mulhouse
Dates
2020 - en cours

Pôles d'échanges
Strasbourg
Gare routière – Entrée ouest – Place des Halles
mou
Eurométropole de Strasbourg
Dates
2020 - 2022

Infrastructure
Grenoble
Intégration urbaine de l’A480
mou
AREA
Dates
2019-2022

Urbanisme
Mulhouse
Ville de nature et de bien-être
mou
Ville de Mulhouse
Dates
2019-2020
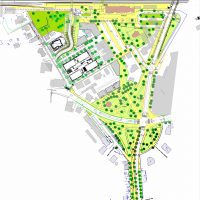
Pôles d'échanges
Sélestat
Aménagement des abords Est de la gare
mou
Ville de Sélestat
Dates
2018-2023
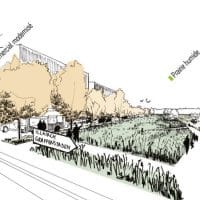
Urbanisme
Illkirhc-Graffenstaden
Rêver la ville
mou
Ville d'Illkirch-Graffenstaden
Dates
2018-2019

Espaces publics
Saint-Laurent du Var
Réaménagement du square Bénès
mou
SPL Côte d'Azur Aménagement
Dates
2018-2020

Urbanisme
Champs sur Marne
Colline Gibraltar
mou
EPA Marne la Vallée
Dates
2017-2019

Cheminements doux
Mamoudzou (Mayotte)
Aménagement du front de mer
mou
Ville de Mamoudzou
Dates
2017-2020

Pôles d'échanges
Tarnos
Création d’un échangeur multimodal
mou
Agglomération Côte Basque
Dates
2016-2020

Espaces publics
Dijon
Parc de la Toison d’Or
mou
Uni-bail
Dates
2016

Urbanisme
Saint-Jeannet
Coteaux du Var
mou
EPA Plaine du Var
Dates
2016-2020

Cheminements doux
Strasbourg
Quais sud de l’Ill
mou
Strasbourg Eurométropole
Dates
2016-2019

Espaces publics
Bordeaux
Aménagement de la place Gambetta
mou
Ville de Bordeaux
Dates
2016

Infrastructure
Strasbourg
Retraitement de l’A35
mou
Eurométropole de Strasbourg
Dates
2016

Infrastructure
Mayotte
« CARIBUS » Transport Collectif Urbain
mou
Communauté d’Agglomération de Dembéni – Mamoudzou (CADEMA) ; mandataire de MOU : NARENDRE
Dates
2016-2019

Infrastructure
Tarnos - Boucau - Bayonne
Bus à Haut Niveau de Service – Ligne 2
mou
Syndicat des Transports de l'Agglomération Côte Basque - Adour
Dates
2016-2019

Infrastructure
Tramway de Strasbourg
Transformation d’un échangeur et création d’un P+R
mou
Eurométropole de Strasbourg
Dates
2016-2020

Urbanisme
Gros-Morne (Martinique)
Requalification du centre-bourg de Gros-Morne
mou
Ville de Gros-Morne
Dates
2016-2017

Pôles d'échanges
Tramway de Strasbourg
Transformation d’un échangeur et création d’un P+R
mou
Eurométropole de Strasbourg
Dates
2016-2020

Infrastructure
Strasbourg
Contournement Ouest
Dates
2015

Grands sites
Gabon
Bois des Géants
mou
République Gabonaise - Présidence de la République Agence Nationale des Parcs Nationaux
Dates
2015

Grands sites
Anuradhapura (Sri Lanka)
Patrimoine, tourisme et développement urbain
mou
Agence Française de Développement
Dates
2015-2016

Infrastructure
Thionville-Fensch
Bus à Haut Niveau de Service
mou
Syndicat Mixte des Transports Urbains de Thionville-Fensch
Dates
2015

Espaces publics
Marseille
Quartiers libres
mou
Métropole Aix-Marseille-Provence
Dates
2015-en cours

Urbanisme
Strasbourg
Place des Halles
mou
Communauté Urbaine de Strasbourg
Dates
2014-2015

Infrastructure
Dunkerque
Transport à haut niveau de service DK’Plus
mou
Communauté Urbaine de Dunkerque
Dates
2014-2018

Infrastructure
Villerupt
Traversée entre Thil et Micheville
mou
Mairie de Villerupt
Dates
2014-2015

Infrastructure
New York (Manhattan)
Tramway sur la 42è Avenue_lauréat
mou
The Institute of Rational Urban Mobility, Inc
Dates
2014

Cheminements doux
Strasbourg
Réseau Express Vélo
mou
Communauté Urbaine de Strasbourg
Dates
2014-2015

Espaces publics
Sigolsheim
Réaménagement du centre du village
mou
Commune de Sigolsheim
Dates
2014

Espaces publics
Kehl-am-Rhein (Allemagne)
Neuewege – Neueperspektiven / Nouvel itinéraire – Nouvelles perspectives
mou
Ville de Kehl
Dates
2014

Infrastructure
Dunkerque
Transformation d’une voie rapide urbaine
mou
Communauté Urbaine de Dunkerque
Dates
2014-2018

Urbanisme
Sochaux
ZAC de la Savoureuse
mou
Ville de Sochaux
Dates
2013-en cours

Cheminements doux
Bordeaux
Schéma Directeur Piétons
mou
Communauté Urbaine de Bordeaux
Dates
2013-2014

Cheminements doux
Libreville (Gabon)
Aménagement du bord de mer
mou
République Gabonaise – Présidence de la République, Agence Nationale Grands Travaux
Dates
2013

Espaces publics
Sélestat
Requalification de l’espace public au centre-ville
mou
Ville de Sélestat
Dates
2013-2017

Pôles d'échanges
Dôle
Pôle d’échanges
mou
Agglomération du Grand Dôle
Dates
2013-2014

Espaces publics
Vendenheim
Transformation de délaissés en parc
mou
Commune de Vendenheim
Dates
2013-2016

Urbanisme
Lille Métropole - Branche de Croix
Restauration hydraulique, écologique et paysagère
mou
Lille Métropole
Dates
2013-2020

Espaces publics
Dijon
Florissimo
mou
Dijon Congrexpo
Dates
2013-2015

Urbanisme
Yutz
Yutz 2030, Ville nature
mou
Ville de Yutz
Dates
2012-2013

Infrastructure
Biarritz - Anglet - Bayonne
Bus à Haut Niveau de Service – Ligne 1
mou
Syndicat des Transports de l'Agglomération Côte Basque - Adour
Dates
2012-2016

Infrastructure
Marlenheim
Traversée du centre-ville
mou
Communauté de Communes La Porte du Vignoble
Dates
2012-2015

Cheminements doux
Nantes
Réseau cyclable structurant
mou
Nantes Métropole
Dates
2012-2015

Grands sites
Petite Rosselle
Warndt Wendel Métamorphoses
mou
Établissement Public et Foncier de Lorraine
Dates
2012-2020

Grands sites
La Grande Motte
Lido du Petit et du Grand Travers
mou
Agglomération du Pays de l'Or
Dates
2012-2015

Grands sites
Brisach
Île du Rhin
mou
Communauté de Communes des Pays de Brisach
Dates
2012

Espaces publics
Metz
Square du Luxembourg
mou
Ville de Metz
Dates
2012-2014

Espaces publics
Schweighouse-sur-Moder
Étude pour un aménagement urbain cohérent
mou
Ville de Schweighouse-sur-Moder
Dates
2012-2016

Pôles d'échanges
Dijon
Création d’un pôle d’échange : la gare de Dijon
mou
Agglomération du Grand Dijon
Dates
2012-2013

Urbanisme
Strasbourg
Schéma Directeur du Port du Rhin
mou
Communauté Urbaine de Strasbourg
Dates
2011-2012

Urbanisme
Sophia Antipolis
Plan directeur Sophia Antipolis 2030
mou
Syndicat Mixte Sophia Antipolis
Dates
2011-2014

Urbanisme
Noisy-le-Grand
Cluster Descartes
mou
EPA Marne
Dates
2011-2014

Urbanisme
Lille
Euralille 3000
mou
SAEM Euralille
Dates
2011-2015

Urbanisme
Marseille
Porte d’Aix
mou
Euroméditerranée
Dates
2011-2020

Urbanisme
Illkirch-Graffenstaden
Lôtissement Le Corbusier
mou
Société d'Équipement de la Région de Strasbourg
Dates
2011

Infrastructure
Montbéliard
Bus à Haut Niveau de Service
mou
Agglomération de Montbéliard
Dates
2011-2018

Espaces publics
Meursault
Aménagement du Centre Bourg
mou
Ville de Meursault
Dates
2011-2014

Espaces publics
Strasbourg
Création d’une zone de rencontre
mou
Communauté Urbaine de Strasbourg
Dates
2011

Pôles d'échanges
Louvres
Pôle d’échanges
mou
EPA Plaine de France
Dates
2011

Ouvrages d'art
LGV Rhin-Rhône
Viaduc de la Savoureuse et Tranchée de Bremont
mou
Réseau Ferré de France
Dates
2011

Espaces publics
Wintzenheim
Réaménagement de l’espace central
mou
Commune de Wintzenheim et Agence Départementale d'Aménagement et d'Urbanisme du Haut-Rhin
Dates
2011

Urbanisme
Montpellier
L’écocité Ode à la Mer
mou
Communauté d'Agglomération de Montpellier
Dates
2010-2012

Urbanisme
Lille
Eurasanté
mou
Communauté Urbaine de Lille et SORELI
Dates
2010-2011

Urbanisme
Freyming-Merlebach
ZAC de la Vallée de la Merle
mou
Communauté de Communes de Freyming-Merlebach, SEBL
Dates
2010

Urbanisme
Lille
Plan Bleu
mou
Communauté Urbaine de Lille
Dates
2010-2011

Infrastructure
Belfort
BHNS Optymo II
mou
Syndicat Mixte des Transports en Commun du territoire de Belfort
Dates
2010-2014

Infrastructure
Perpignan
Bus à haut niveau de service
mou
Communauté d'Agglomération et Ville de Perpignan
Dates
2010-2014

Grands sites
Nice
Promenade des Anglais
mou
Communauté Urbaine Nice Côte d'Azur
Dates
2010

Grands sites
Haïti
3 Parcs Nationaux
mou
République d'Haïti, Commité Interministériel d'Aménagement du Territoire
Dates
2010

Urbanisme
Pays de Montbéliard
Projet urbain d’agglomération
mou
Communauté d'Agglomération du Pays de Montbéliard
Dates
2010-2011

Espaces publics
Strasbourg
Réaménagement de la place du château
mou
Communauté Urbaine de Strasbourg
Dates
2010

Infrastructure
Lille
Liaison Intercommunale Nord
mou
Communauté Urbaine de Lille
Dates
2010-2013

Urbanisme
Grand Paris
Consultation pour l’avenir de la métropole
mou
Ministère de la Culture et de la Communication
Dates
2009

Urbanisme
Dambach
Plateforme d’activités d’Alsace Centrale
mou
Communauté de Communes du Bernstein et de l'Ungersberg
Dates
2009

Infrastructure
Toulouse
Intégration urbaine du tramway
mou
TISSÉO, SMAT
Dates
2009-2015

Infrastructure
Münich
Concours Pasing
mou
Planungsgruppe 504
Dates
2009

Infrastructure
Bruxelles
Ligne de tramway n°9
mou
Bruxelles Mobilité AED
Dates
2009

Grands sites
Besançon
Prés des Vaux
mou
Ville de Besançon
Dates
2009-2018

Grands sites
Freyming-Merlebach
Les carrières
mou
Établissement Public et Foncier de Lorraine
Dates
2009-2010

Grands ensembles
Colmar
Quartier Schweitzer
mou
Colmarienne de logement et Ville de Colmar
Dates
2009

Espaces publics
Chambéry
Avenue d’Annecy
mou
Ville de Chambéry
Dates
2009

Espaces publics
Vence
Aménagement du centre-ville
mou
Ville de Vence
Dates
2009

Urbanisme
Saint-Étienne
Plaine Achille
mou
Établissement Public d'Aménagement de Saint-Étienne
Dates
2008

Infrastructure
Tramway de Strasbourg
Le Quartier Européen
mou
Communauté Urbaine de Strasbourg
Dates
2008-2010

Infrastructure
Tramway de Dijon
Intégration urbaine du tramway
mou
Agglomération du Grand Di
Dates
2008-2013

Infrastructure
Tramway de Dijon
Place Darcy
mou
Agglomération du Grand Dijon
Dates
2008-2013

Infrastructure
Tramway de Dijon
Grands ensembles : Chenôve
mou
Agglomération du Grand Dijon
Dates
2008-2013

Infrastructure
Tramway de Dijon
Place de la Gare
mou
Agglomération du Grand Dijon
Dates
2008-2013

Infrastructure
Tramway de Dijon
Place de la République
mou
Agglomération du Grand Dijon
Dates
2008-2013

Infrastructure
Tramway de Dijon
Faubourgs : Toison d’Or
mou
Agglomération du Grand Dijon
Dates
2008-2013

Infrastructure
Strasbourg
Réaménagement de l’entrée sud
mou
Conseil Général du Bas-Rhin
Dates
2008-2009

Infrastructure
Chambéry
Traversée historique
mou
Ville de Chambéry
Dates
2008-2013

Grands sites
Mont Saint-Michel
Restitution du caractère maritime
mou
Syndicat Mixte Baie du Mont Saint-Michel
Dates
2008-2013

Grands sites
Grenoble
Quais de l’Isère
mou
Ville de Grenoble
Dates
2008-2009

Grands ensembles
Nancy
Cœur de plaine rive droite
mou
Communauté Urbaine de Grand Nancy, MOU délégué SOLOREM
Dates
2008-2010

Urbanisme
Plaine du Var
Étude d’aménagement
mou
Communauté d'Agglomération Nice Côte d'Azur
Dates
2007
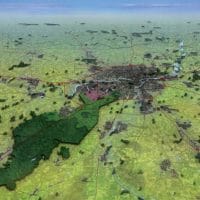
Urbanisme
Rennes
Secteur Intrarocade Nord-Est
mou
Rennes Métropole
Dates
2007-2025

Urbanisme
Besançon
Éco-cité : Quartier des Planches
mou
Ville de Besançon
Dates
2007

Urbanisme
Dijon
Parc d’Activités de l’Est Dijonnais
mou
Grand Dijon
Dates
2007

Infrastructure
Île de la Réunion
Tram-Train, dialogue compétitif
mou
Région Réunion
Dates
2007-2010

Infrastructure
Île de la Réunion
Requalification de la RN1
mou
Région Réunion
Dates
2007

Grands ensembles
Metz - Quartier Borny
Place réalisée dans le cadre du GPV
mou
Ville de Metz
Dates
2007-2008

Urbanisme
Val de Rosselle
Schéma de COhérence Territoriale
mou
Syndicat Mixte de Cohérence du Val de Rosselle
Dates
2006-2012

Urbanisme
Brumath
Plateforme Départementale d’Activités
mou
Communauté de Communes de la Région de Brumath, Conseil Général du Bas-Rhin
Dates
2006-2007

Urbanisme
Île Saint-Denis
Éco-quartier du Printemps
mou
Nexity
Dates
2006

Urbanisme
Montpellier
Étude urbaine de la RD 21 : l’Avenue de la Mer
mou
Communauté d'Agglomération de Montpellier
Dates
2006-2010

Infrastructure
Nice
Extension du réseau tramway
mou
Communauté d'Agglomération de Nice-Côte d'Azur
Dates
2006-2009

Infrastructure
Montpellier
Réaménagement de l’avenue de la Liberté
mou
Ville de Montpellier
Dates
2006

Cheminements doux
Villeneuve-Loubet
Route du littoral
mou
Ville de Villeneuve-Loubet
Dates
2006

Grands sites
Avignon
Réaménagement des remparts
mou
Agglomération du Grand Avignon
Dates
2006

Urbanisme
Lyon
ZAC Berthelot
mou
Nexity Apollonia
Dates
2005-2013

Infrastructure
Île de la Réunion
Tram-train sur le tronçon St-Paul – St-Pierre
mou
Conseil Régional de la Réunion
Dates
2005-2007

Infrastructure
Tram-Train Ouest Lyonnais
Réhabilitation des gares et de leurs abords
mou
Région Rhône-Alpes
Dates
2005

Cheminements doux
Moselle et Meurthe-et-Moselle
Berges de l’Orne
mou
Établissement Public et Foncier de Lorraine
Dates
2005-2006

Grands sites
Marseillan
Lido de Sète
mou
Communauté d'Agglomération du Bassin de Thau
Dates
2005-2014

Espaces publics
Illkirch-Graffenstaden
Aménagement du Forum de l’Ill
mou
Ville d'Illkirch-Graffenstaden
Dates
2005-2007

Espaces publics
Audincourt - Valentigney
Réaménagement du centre-ville
mou
Communauté d'Agglomération du Pays de Montbéliard et Ville d'Audincourt
Dates
2005-2008

Pôles d'échanges
Dunkerque
Création d’un pôle d’échanges
mou
Communauté Urbaine de Dunkerque
Dates
2005

Pôles d'échanges
Saverne
Construction d’un pôle d’échange multimodal
mou
Ville de Saverne
Dates
2005

Grands ensembles
Belfort
Quartier des résidences
mou
Ville de Belfort
Dates
2005

Urbanisme
Montpellier
Schéma de COhérence Territoriale
mou
Montpellier Agglomération
Dates
2004-2006

Urbanisme
Clermont-Ferrand
Abords du Stade Montpied
mou
Ville de Clermont-Ferrand
Dates
2004-2006

Urbanisme
Île de la Réunion
La Montagne : éco-cité du plateau Couilloux
mou
Région Réunion
Dates
2004-2006

Infrastructure
Antibes - Sophia Antipolis
Étude de Transport en Commun en Site Propre
mou
Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis
Dates
2004-2005

Infrastructure
Strasbourg - Bruche - Piémont des Vosges
Intégration des stations du tram-train
mou
Région Alsace, SNCF et RFF
Dates
2004-2005

Infrastructure
Blénod-Les-Pont-À-Mousson
Route Nationale 57
mou
Ville de Blénod-Les-Pont-À-Mousson
Dates
2004-2006

Espaces publics
Sélestat
Aménagement du Neja Waj
mou
Ville de Sélestat
Dates
2004-2005

Espaces publics
Yutz
Place de la Brasserie
mou
Ville de Yutz
Dates
2004-2007

Espaces publics
Yutz
Réaménagement de l’Avenue des Nations
mou
Ville de Yutz
Dates
2004-2006

Pôles d'échanges
Antibes
Pôle d’échanges bus-train
mou
Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis
Dates
2004-2005

Ouvrages d'art
Meurthe-et-Moselle
Passerelles et berges de l’Orne
mou
Établissement public et foncier de Lorraine
Dates
2004-2006

Cheminements doux
Cagnes-sur-Mer
Route du Littoral
mou
Ville de Cagnes-sur-Mer
Dates
2003-2007

Cheminements doux
Lille
Liaison intercommunale nord-ouest
mou
Communauté Urbaine de Lille
Dates
2003-2004

Infrastructure
Lille
Liaison Intercommunale Nord-Ouest
mou
Communauté Urbaine de Lille
Dates
2003-2005

Cheminements doux
Antibes
Route du Littoral
mou
Direction Départementale de l'Équipement - Alpes Maritimes, Subdivision d'Antibes
Dates
2002-2003

Espaces publics
Audincourt
Reconversion des filatures Japy
mou
Ville d'Audincourt
Dates
2002

Infrastructure
Belfort
Boulevards A. France et J.-F. Kennedy
mou
Conseil Général du Territoire de Belfort
Dates
2001-2009

Infrastructure
Belfort
Résidentialisation de la rue Dorey
mou
Ville de Belfort
Dates
2001-2007

Espaces publics
Pontarlier
Espaces publics du centre ville
mou
Ville de Pontarlier
Dates
2001-2009

Infrastructure
Marseille
Intégration urbaine du tramway
mou
Communauté Urbaine de Marseille
Dates
2000-2007

Infrastructure
Karlsruhe
Intégration urbaine du tramway
mou
VKB Karlsruhe, TTK Bureau d'études techniques
Dates
2000-2006

Infrastructure
Nancy
Intégration urbaine du tramway sur pneus
mou
Communauté Urbaine du Grand Nancy
Dates
1998-2000

Espaces publics
Strasbourg
Jardins de l’université
mou
Université de Strasbourg
Dates
1998-2005

Urbanisme
Strasbourg
ZAC de l’Étoile
mou
Société d'Équipement de la Région de Strasbourg
Dates
1997-1998

Infrastructure
Autoroute A4
Rénovation des aires de service
mou
SANEF
Dates
1997

Espaces publics
Illkirch-Graffenstaden
Nouvel espace public du cours de l’Illiade
mou
Communauté Urbaine de Strasbourg
Dates
1997-2000 et 2017 Insertion du Tramway

Ouvrages d'art
Illkirch-Graffenstaden
Pont du Lixenbuhl
mou
Communauté Urbaine de Strasbourg
Dates
1997-1998

Infrastructure
Amiens / Longueau
Avenue de la Ville Idéale
mou
Ville de Longueau et Amiens Métropole
Dates
1996-2003

Espaces publics
Erstein
Cimetière paysager
mou
Ville d'Erstein
Dates
1996

Infrastructure
Tramway de Strasbourg
Ville allemande
mou
Communauté Urbaine de Strasbourg
Dates
1995-2000

Ouvrages d'art
Strasbourg
Pont de l’Elsau
mou
Communauté Urbaine de Strasbourg
Dates
1995-2000

Ouvrages d'art
Strasbourg
Pont du Faubourg National
mou
Communauté Urbaine de Strasbourg
Dates
1995-2000

Urbanisme
Strasbourg
ZAC du Bon Pasteur
mou
Société d'Équipement de la Région de Strasbourg
Dates
1992

Espaces publics
Mont Sainte-Odile
Mémorial du crash du vol air inter 148
mou
Association des Victimes du Crash du Mont Sainte-Odile
Dates
1992
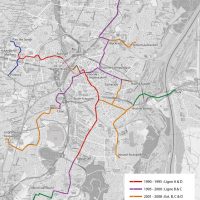
Infrastructure
Tramway de Strasbourg
Présentation générale
mou
Communauté Urbaine de Strasbourg
Dates
1990-2016

Infrastructure
Tramway de Strasbourg
Communes périphériques
mou
Commuanuté Urbaine de Strasbourg
Dates
1990-2016

Infrastructure
Tramway de Strasbourg
Centre-ville
mou
Communauté Urbaine de Strasbourg
Dates
1990-2000

Infrastructure
Tramway de Strasbourg
Tramway et Design
mou
Communauté Urbaine de Strasbourg
Dates
1990-2016

Infrastructure
Tramway de Strasbourg
Tramway et faubourgs
mou
Communauté Urbaine de Strasbourg
Dates
1990-2016

Infrastructure
Tramway de Strasbourg
Tramway et ouvrages d’art
mou
Communauté Urbaine de Strasbourg
Dates
1990-2016

Infrastructure
Tramway de Strasbourg
Tramway et Pôles d’échanges
mou
Communauté Urbaine de Strasbourg
Dates
1990-2016

Infrastructure
Tramway de Strasbourg
Tramway et quartiers sensibles
mou
Communauté Urbaine de Strasbourg
Dates
1990-2016

Infrastructure
Mulhouse
Extensions du tramway

Espaces publics
Lille
Requalification de la rue du Molinel – Liane 5
mou
Métropole Européenne de Lille, Ville de Lille
Dates
Juin 2020 - En cours

Espaces publics
Dijon
Recomposition des entrées métropolitaines
mou
Dijon Métropole
Dates
Août 2019 - Février 2020

Espaces publics
Belfort
Réaménagement de la place de la République
mou
Ville de Belfort
Dates
Mars 2021 - en cours

Pôles d'échanges
Saint-Jean-de-Luz
Aménagement de P+R aux entrées Nord et Sud
mou
Syndicat des Mobilités Pays Basque - Adour
Dates
Janvier 2020 - Décembre 2022

Grands sites
La Rothlach
Piste de luge
mou
Collectivité européenne d'Alsace, Julian HOECKEL
Dates
Janvier 2021-février 2022
Le travail sur Metz Borny Sud a permis d’ouvrir une nouvelle entrée du quartier sur le réseau viaire structurant de la ville. Ce travail préalable sur les infrastructures et le paysage anticipe un accompagnement bâti dont les programmes et l’architecture doivent apporter de la diversité et de nouveaux centres d’intérêts. Le travail sur les infrastructures a donc un rôle de déclencheur.


Avant-après du projet : vue de l’échangeur

Une véritable gare routière interconnectée à la ville et à la gare ferroviaire
L’arrivée sur Strasbourg par l’entrée Ouest est aujourd’hui extrêmement problématique tant au niveau fonctionnel (pour tous les modes), que visuel (le paysage est très médiocre). Le déploiement de la gare routière dans l’arrière de la gare ferroviaire, la requalification de la rue Georges Wodli, du boulevard du président Wilson et du boulevard Sébastopol permettra de favoriser l’accessibilité en transports publics et modes doux dans des espaces publics revalorisés.
L’emplacement en gare basse permettra un accès rapide et fiable depuis l’A35 requalifiée ou depuis le TSPO pour les autocars, dont le nombre exponentiel obèrera l’accès au centre-ville de Strasbourg. Cet emplacement, éventuellement provisoire, enclenchera de manière pragmatique un début d’ouverture de la gare vers l’Ouest. Ce premier pas en entrainera d’autres… En premier lieu les bâtiments existants dont celui donnant sur la rue Georges Wodli qui pourrait devenir un marché couvert.

Redonner la place aux modes actifs sur la rue Georges Wodli
Ce square, tant attendu dans le quartier allant de pair avec la rue de Sébastopol requalifiée, permettra de créer un espace public de qualité reliant le centre-ville aux quartiers entourant les Halles. Cet aménagement est prévu pour conserver un certain nombre d’arrêts pour les bus urbains et interurbains.
En sortant de la gare, le tramway attend le voyageur dans la cour parallèle au bus départementaux, aux taxis ; à quelques mètres se trouve une station de vélos. Dans le parking sur la gare se trouve une station de voitures de location et du car sharing. Sur une très petite surface donc, on trouve l’ensemble des systèmes de déplacement dans un espace urbain de qualité. C’est le principal tour de force de ce projet : mettre en contact tous les modes sans dispositif sophistiqué !

Le projet d’ensemble porte sur la requalification des espaces publics des casernes Saint-Charles, avec une stratégie de mobilité et une trame paysagère claire.
Partout il s’agit de mettre en place des situations immersives et des situations ouvertes. Les aménagements paysagers s’organisent autour d’un projet d’agroforesterie, élément majeur, au rayonnement métropolitain.
Des plantations diverses et variées se développent comme un boisement libre d’accès. Sis en promontoire sur la terrasse du Muy, la plus haute du site, faisant écho à la mise en valeur du patrimoine monumental que représente la caserne du Muy. Dans cette logique de mise en valeur d’éléments bruts ou existants, les balcons et allées liés au boisement sont des éléments minéraux rectilignes dont le traitement de sol sera sobre. Au nord du site, l’allée du Muy est celle qui mène depuis le cœur du quartier vers les plantations denses et sera donc traitée à la manière des allées de parc. Ici, c’est l’allée du boisement : mêmes essences plantées de part et d’autre d’un cheminement central, en retrait des murs de soutènement. Cet espace procurera un cœur vert et frais pour les logements qui seront construits sur les terrasses. Les cœurs d’îlots seront plantés au maximum pour former un type d’agroforesterie. L’ombre des bâtiments permettant l’insertion de petits écosystèmes plus denses.

Une forêt en cœur de ville
Florissimo, concept issu de la grande époque des espaces verts, plonge le visiteur dans un monde merveilleux symbolisé par une profusion de fleurs et de végétaux. L’évènement souligne la sortie de l’hiver et dans une artificialité assumée, crée un spectacle généreux et coloré.

Ambiance dans le bateau


Le monde change… Le concept né durant les années glorieuses est confronté à une époque plus incertaine, individualiste, cherchant dans la nature une forme de sécurisation et des raisons de croire en l’avenir.
L’engouement pour toutes les formes du ‘‘durable’’ en est une manifestation concrète. Inscrire Florissimo dans l’air du temps nous semble indispensable pour assurer son succès ; nous souhaitons garder le spectacle mais lui donner un autre sens.
La prise de conscience que la biodiversité est menacée, et que cet appauvrissement sans précédent des espèces animales et végétales menace notre propre existence, peut non seulement remettre Florissimo dans l’air du temps, mais lui donner un rôle vertueux et d’avant-garde. Cette évolution permet de sortir
l’écologie de sa posture culpabilisante et moralisatrice, et, au moins le temps de la manifestation, la présenter comme un rêve collectif.
C’est pour relever ce pari ambitieux que nous avons imaginé une mise en scène associant la science à la haute technologie des effets scéniques.
Le projet prend place sur les communes de Barr et du Hohwald. Il s’agit de créer une piste de luge et de renforcer le caractère naturel aux abords de l’auberge de la Rothlach, clé de voute autour de laquelle s’articule le projet. Les aménagements s’inscrivent dans le projet global de création du pôle d’activité en pleine nature.
L’environnement immédiat de l’auberge est retravaillé pour inscrire le bâtiment dans un écrin vert et réduire l’artificialisation du site. Le stationnement des véhicules est relocalisé pour en minimiser l’impact visuel. Les cheminements piétons sont sécurisés et le carrefour D214/D130 est simplifié.
La piste de luge est implantée en retrait par rapport à la route départementale offrant un cadre remarquable à la pratique de la luge. Les remontées sont séparées de la piste par un dispositif de type ganivelles.

Plan du projet
Avec la reconstruction du téléphérique des grands Montets suite à un incendie, se pose la question de son accessibilité. Reste-t-on comme aujourd’hui principalement dépendant de l’automobile ?
Notre projet consiste à installer progressivement un mode de mobilité qui s’appuie sur le train et le bus ; le parking est donc fortement réduit (de 800 à 400 places), le paysage est « naturalisé » de même que les rives de l’Arve. De ce projet ponctuel, nous avons imaginé un concept de mobilité de plus en plus vertueux qui intègre tous les modes de transport et qui doit à terme supprimer totalement le trafic automobile dans Chamonix.
Ce chantier qui se terminera en 2027, fait partie des grands sites français. Au travail de R. PIANO sur le téléphérique lui-même, nous apporterons une dimension environnementale dans la vallée avec un vrai big bang au niveau des transports.

Principe d’aménagement du site
Le bord de mer est un concentré de fonctions sur un espace public de taille réduite. La fonction dominante (circulation et stationnement) occupe 65% de la surface ! Elle réduit ainsi les autres usages à la portion congrue et fabrique une nuisance peu compatible avec celle d’une vitrine avenante, généreuse et multifonctionnelle.
Aucun projet n’est possible sans réaliser au préalable un nouvel enrochement afin de stabiliser une berge en très mauvais état ! La solution est de décaler alors le nouvel enrochement afin de gagner 8 mètres de promenade plantée d’une véritable canopée donnant l’ombre indispensable à un espace convivial.
Le projet s’étend en longueur de la jetée du port de plaisance à la pointe Mahabou. Les 8 mètres gagnés sont la largeur minimum pour faire coexister une promenade continue avec kiosques et terrasses. Le revêtement de cette promenade contribue à donner un aspect noble et confère au lieu un sentiment de sécurité.
Complémentaire au projet du BHNS, ce projet est ouvert sur l’avenir.
Situé au Centre Nord de la Martinique, le Gros Morne est une commune rurale de l’île et une des sept localités à n’avoir aucun contact direct avec la mer. Cette commune agricole est dominée par un relief montagneux et caractérisée par une végétation luxuriante et un réseau hydrographique dense.
Le projet d’aménagement du centre-ville a pour objectif de réaffirmer le bourg historique comme le centre de la vie culturelle et économique du Gros-Morne. Repenser le plan de circulation pour donner un nouveau souffle au centre-ville est un préalable indispensable à la création d’un cœur fédérateur, un réseau d’espaces publiques connecté et hiérarchisé. Des actions diverses sont proposées : une grande place multifonctionnelle, paysagée et animée à proximité de la Mairie, une «zone de rencontre» pour y insuffler une nouvelle ambiance vivante et attractive, renforcer des liaisons douces confortables vers les quartiers périphériques pour faciliter le développement de la vie sociale et économique locale, mettre en scène le belvédère et créer un écrin végétalisé à l’Eglise pour offrir un lieu de détente aux seniors et familles, dans un contexte où les espaces paysagers sont rares…
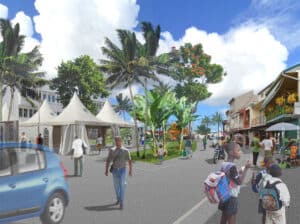
Réaménagement de la place de la Mairie

Réaménagement de la rue Jules Ferry
Une étude récente pour le compte d’APRR sur la modernisation de l’A36 nous a permis de faire connaissance avec les différents projets d’études en cours aussi bien au niveau de la Ville que de l’Agglomération. Elles visent à répondre aux trois principales priorités de Mulhouse :
• La diversification économique en prenant appui sur les friches industrielles,
• L’attractivité résidentielle en créant de nouvelles aménités et en réhabilitant le parc existant,
• Le marketing en développant les grands équipements dont certains ont vocation à être trinationaux.
Hélas ! La somme d’études sectorielles ne se substitue pas à une vision, un fi l conducteur ou une cohérence globale. En période de disette budgétaire, ouvrir des fronts sur tous les domaines, sur tous les secteurs en même temps, c’est s’exposer à brouiller les pistes, à ne jamais achever les projets ; c’est le cas à Mulhouse, « une grande œuvre inachevée », m’a dit un jour son ancien maire. Il faut donc prioriser « synergiser » en s’appuyant sur ses forces : sa situation géographique, sa taille, son passé industriel, sa géographie. C’est précisément l’objet de cette étude et comme cela que nous la comprenons : « Inversons le regard » et parions sur le grand monument des villes du XXIe siècle : le Paysage/la Nature. Ce pari s’appuie sur un déjà-là contrairement aux bâtiments, aux infrastructures de transports. Ce déjà-là a été très malmené par l’industrie, par les infrastructures, par une substance bâtie qui s’en est beaucoup éloignée.
La Ville-Nature est une carte gagnante pour plusieurs raisons :
• Elle répond aux nouveaux entrants « durables » : climat, biodiversité, qualité de l’air et de l’eau,
• Elle répond aux critères d’installations existantes et terme de cadre de vie : ceci vaut pour les entreprises comme pour les résidents,
• Elle induit des comportements vertueux : promotion du vélo, de la marche à pied et fabrique de la sociabilité
• Elle valorise des fonciers perdus, des délaissés, des zones polluées,
• Elle crée un sentiment de bien-être par son ambiance, par la qualité de ses lumières et de ses premiers plans.
L’inversion du regard est une méthode qui chamboule les réflexes classiques du projet urbain : la transformation du lourd est précédée par celle du « soft ».

Des parkings-relais pour réaménager les portes d’entrée.
La création de deux parkings-relais de 200 et 250 places a permis de répondre à la fois à une problématique de mobilité et de paysage.
Chaque ouvrage est adapté au site. Le traitement d’une grande simplicité satisfait à des critères d’infiltration des eaux pluviales, de création d’énergie et d’avoir une véritable canopée, une piste cyclable relie les extrémités de la Commune.
Le préalable : le plan de circulation et de stationnement
Une place libérée de sa fonction stationnement
Un aménagement qui valorise son patrimoine
- aménager des perspectives sur les façades pour donner de la profondeur à la place
- faire remonter le monument central dans une mise en scène qui renforce sa présence
- valoriser le pourtour en valorisant mieux la perspective sur le lion
Créer un contraste d’ambiance entre les deux places et un cœur bicéphale
Une place répondant de manière forte à tous les paramètres du durable
- Reconnaître ce territoire pour sa particularité et son potentiel,
- Créer une instance de gouvernance transversale sur le modèle des OIM bordelais : le PIM Nord pourrait servir de laboratoire pour les 4 autres territoires à enjeux fort de la Métropole.
La particularité de cette rue nous a conduit à créer un profil en V avec un point bas qui se trouve dans l’axe de la rue. Cette modification altimétrique casse le caractère routier. Ceci n’est pas flagrant sur des plans et coupes, mais compte énormément dans l’espace réel. Ce profil en V est très souvent utilisé pour aménager des rues piétonnes, plus rarement des rues de telle largeur.
Bien sûr, ce profil est lié au fait que nous cherchons à casser la dichotomie classique des rues entre chaussée et trottoirs. La rue du Molinel, nous la percevons comme quelque chose de singulier, une sorte de cour urbaine ; tout sauf une rue classique. Cela souligne aussi le lien très important que constitue cette rue entre le Palais des beaux-Arts et la gare de Lille-Flandres.
Le tracé de l’A480 à travers la métropole de Grenoble est un parcours très contraignant. Il doit composer avec une rivière capricieuse sur le flanc Ouest et une ville qui se diversifie sur son flanc Est. Ces deux facteurs contextuels ont nécessité des mesures d’insertions très soignées en conciliant les exigences environnementales, une valorisation de l’image de Grenoble et une impression de réduction de l’effet de coupure.
Pour répondre à ces exigences le projet prévoit de :
– minimiser l’élargissement de l’emprise.
– mettre aux normes la récupération et traitement des eaux pluviales.
– rendre l’autoroute plus silencieuse.
– améliorer les cheminements transversaux des modes actifs.
– faciliter les relations entre les rives et l’autoroute.
– améliorer l’image de Grenoble perçue depuis l’autoroute.

Mur anti-bruit en pierre

Chantier : double paroi en galets dans cadre métal avec remplissage acoustique en sable
Le projet repose sur le concept de «Ville apaisée» offrant la part belle aux modes doux, écartant le principe d’une «île-giratoire» pour dégager un centre-ville en «presqu’île».
La circulation automobile passe ainsi au second plan afin de satisfaire à ce concept.

Un parc dans la ville

Plan masse
En adoptant en 2012 le Plan Bleu Métropolitain, la MEL a acté le rôle central que doivent jouer les canaux et les rivières dans le territoire métropolitain Lillois et dans la création d’une nouvelle identité. L’étude stratégique, alors menée par notre groupement a permis d’identifier 9 sites-clefs pour la politique de reconquête et de redéveloppement urbain et naturel autour du réseau bleu. La Branche de Croix est l’un des sites à plus fort enjeux Mais c’est aussi l’un des sites les plus complexes à réhabiliter en raison de la pollution des sols et de l’état de la rivière – qui ne coule plus – suite à la récente histoire industrielle et urbaine du site.
Pollution de cette friche de l’industrie lourde et putréfaction des eaux de la Marque, rivière contrariée compromettent, aujourd’hui son développement urbain et paysager.
Un scénario vertueux basé sur des actions complémentaires permettra de transformer ce délaissé de 25 hectares en « LiIle Métropole », cœur de nature tant désiré dans un contexte fortement urbanisé :
– Restauration hydraulique, écologique et paysagère de la rivière Marque.
– Confinement des terres et sédiments pollués, après traitement si nécessaire, dans une butte paysagée de 30m de haut au cœur du Parc, participant pleinement à l’équilibre économique de l’opération (redevance de mise en décharge).-Remise en navigation partielle de la Branche de Croix, création d’un port de plaisance.
Ces actions sur l’hydraulique et le paysage, complétées par l’amélioration du plan des mobilités (optimisation des dessertes TC, développement des cheminements doux…), rendent crédible l’intensification urbaine des centres villes de Croix et de Wasquehal. Au total, ce sont plus de 200 000 m² de SHON de logements qui sont envisagés en lien avec le cadre de nature intense, dont 1/3 de logements et 2/3 d’activités.

Vue aérienne du site

Vue vallée de la Marque
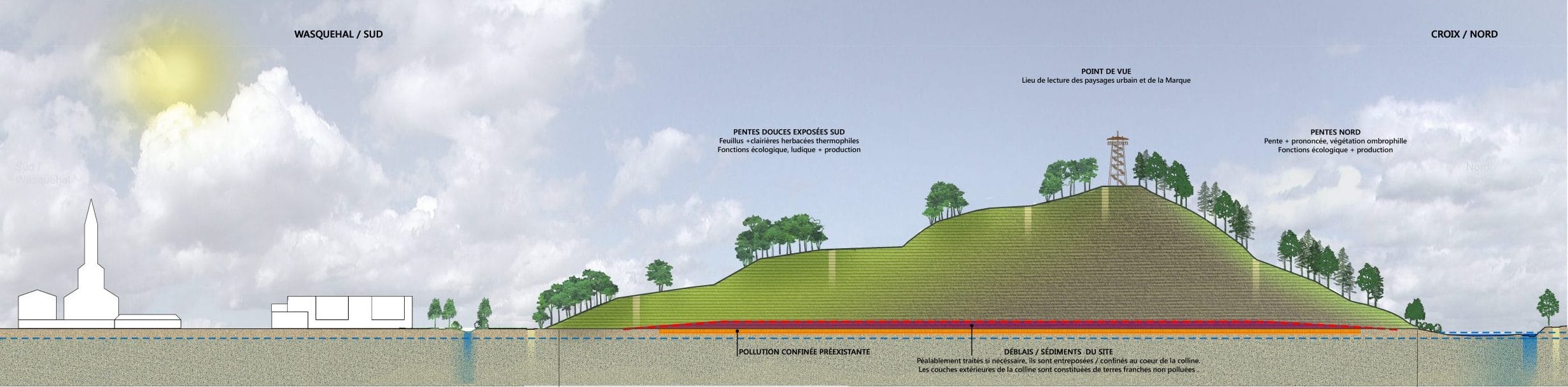
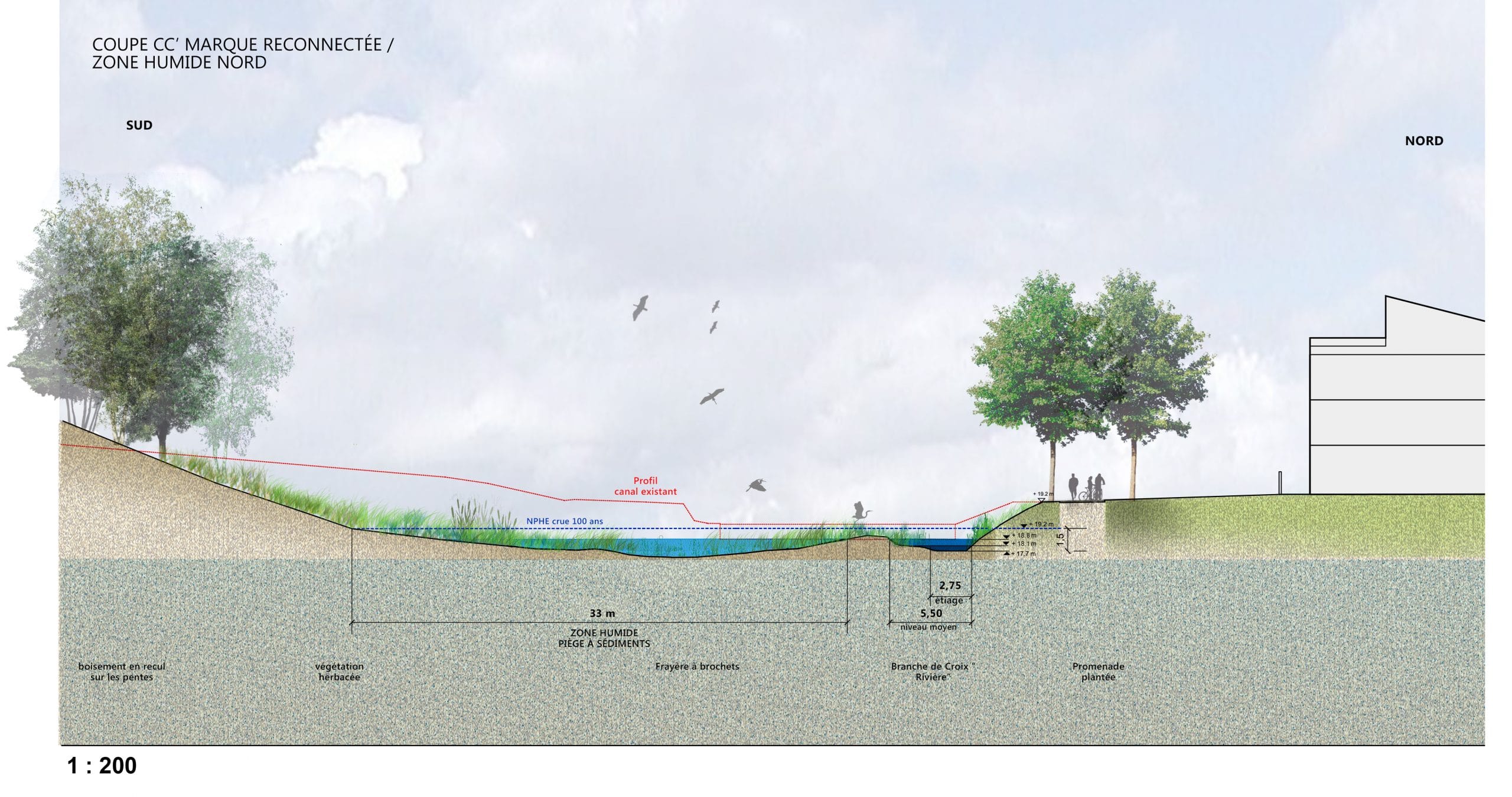
Profil colline et zone humide de la Marque
À Illkirch-Graffenstaden, toutes les infrastructures linéaires structurantes sont orientées Nord/Sud : rivière, canal, tramway, routes et autoroutes sont dirigées vers la ville centre. Il en résulte un découpage en tranches de la commune qui limite les échanges entre ses composantes ; affaiblit la perception de ses richesses et survalorise son tropisme vers Strasbourg.
Les 3 grandes allées Est/Ouest rééquilibreraient cet état de fait et articuleraient autour d’espaces publics de nature différentes toutes les composantes de la commune en les rapprochant. De la forêt du Neudorf au lac Achard, on doit pouvoir circuler en vélo sans obstacles ou déambuler sur une partie.
Elles relient, réorientent et donnent une vocation à des espaces tout en renforçant la présence de la nature, en sanctuarisant un vide entre Strasbourg et la commune.
Ces 3 allées croisent le canal et l’Ill. Elles en facilitent l’accès et forment des boucles offrant plusieurs variantes dans les parcours. Avec ces deux cours d’eau, Illkirch-Graffenstaden se dote d’un maillage nature, destiné à renforcer le sentiment mainte fois exprimé d’un «bon vivre» et d’une appartenance à «un village».
Les 3 allées peuvent aussi donner des inflexions à des projets en cours, comme les rives du canal, et en susciter d’autres dans un équilibre ville/nature beaucoup plus ambitieux.

L’allée bleue, entre Ostwald et Baggersee, un grand corridor écologique
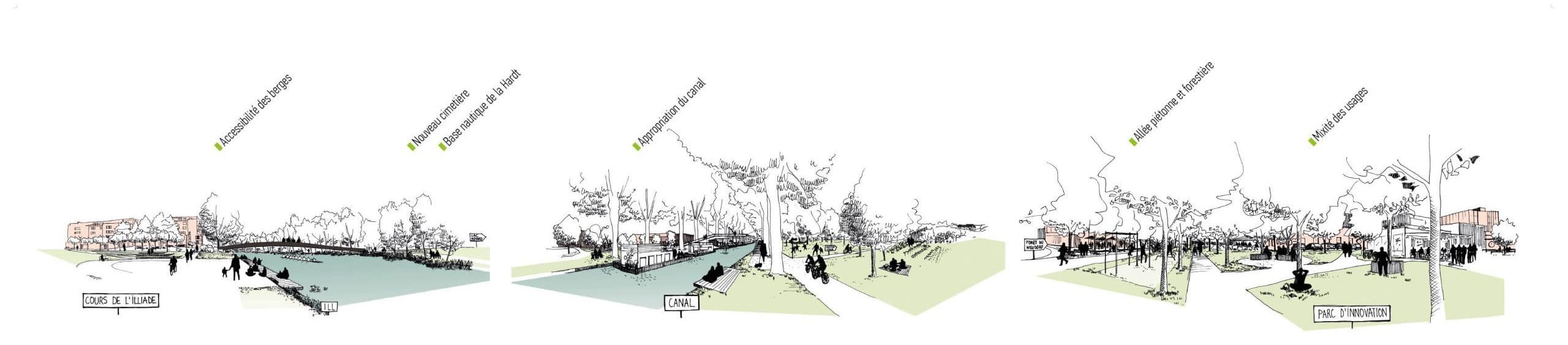
L’allée urbaine, une chaîne d’espaces publics du lac Achard à la forêt du Neudorf

L’allée verte, une valorisation écologique du Sud de la commune
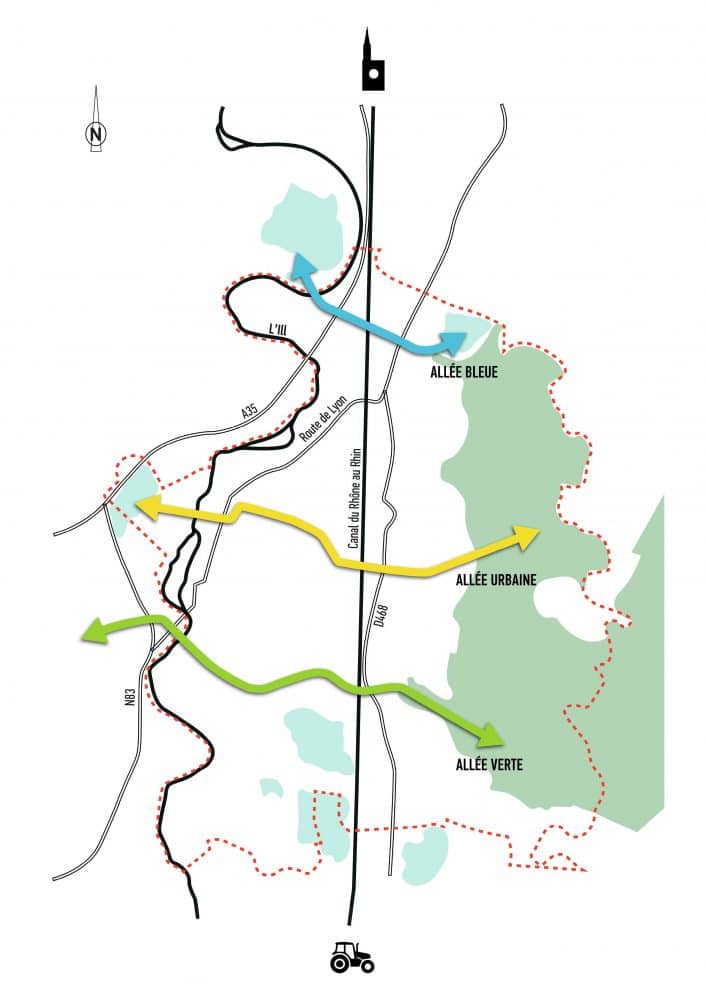
Localisation des allées
La Colline de Gibraltar doit redevenir dans son aspect final un paysage boisé naturel capable de supporter des aménités urbaines. Cet objectif est consubstantiel au projet lui-même ; pour y arriver, un effort important est prévu dans le projet sur plusieurs points :
– La création d’un sol fertile sur une forte épaisseur en travaillant à partir des matériaux mis en place et en les enrichissant avec la matière organique. Cette création de sol sera encadrée par un expert pour l’intégrer dès le départ dans le processus de création de la colline.
– Les plantations de type forestier seront réalisées à partir d’essences adaptées au substrat et aux essences locales. L’objectif prioritaire est de recréer un milieu riche, dense, dans tous les étages d’une forêt saine. Les plantations seront donc réalisées avec un mélange d’arbres formés, de baliveaux et d’arbustes pour créer le corridor écologique. Cet aspect plantations sera lui aussi encadré par des experts en matière de régénération forestière.
– Le confortement, c’est à dire le suivi des plantations sur une période de 4 ans pour assurer la bonne installation du système naturel. Le futur propriétaire de la colline récupérera donc un paysage installé qui ne demandera pas plus d’entretien qu’une forêt classique.
Ces trois temps, création d’un sol fertile, opérations de plantations et confortement sont des éléments prépondérants dans le projet car c’est sa finalité même. La Colline de Gibraltar n’est pas un nouvel élément dans le paysage mais un maillon manquant dans un système haché par les grandes infrastructures.

Une colline métropolitaine, pas une butte !
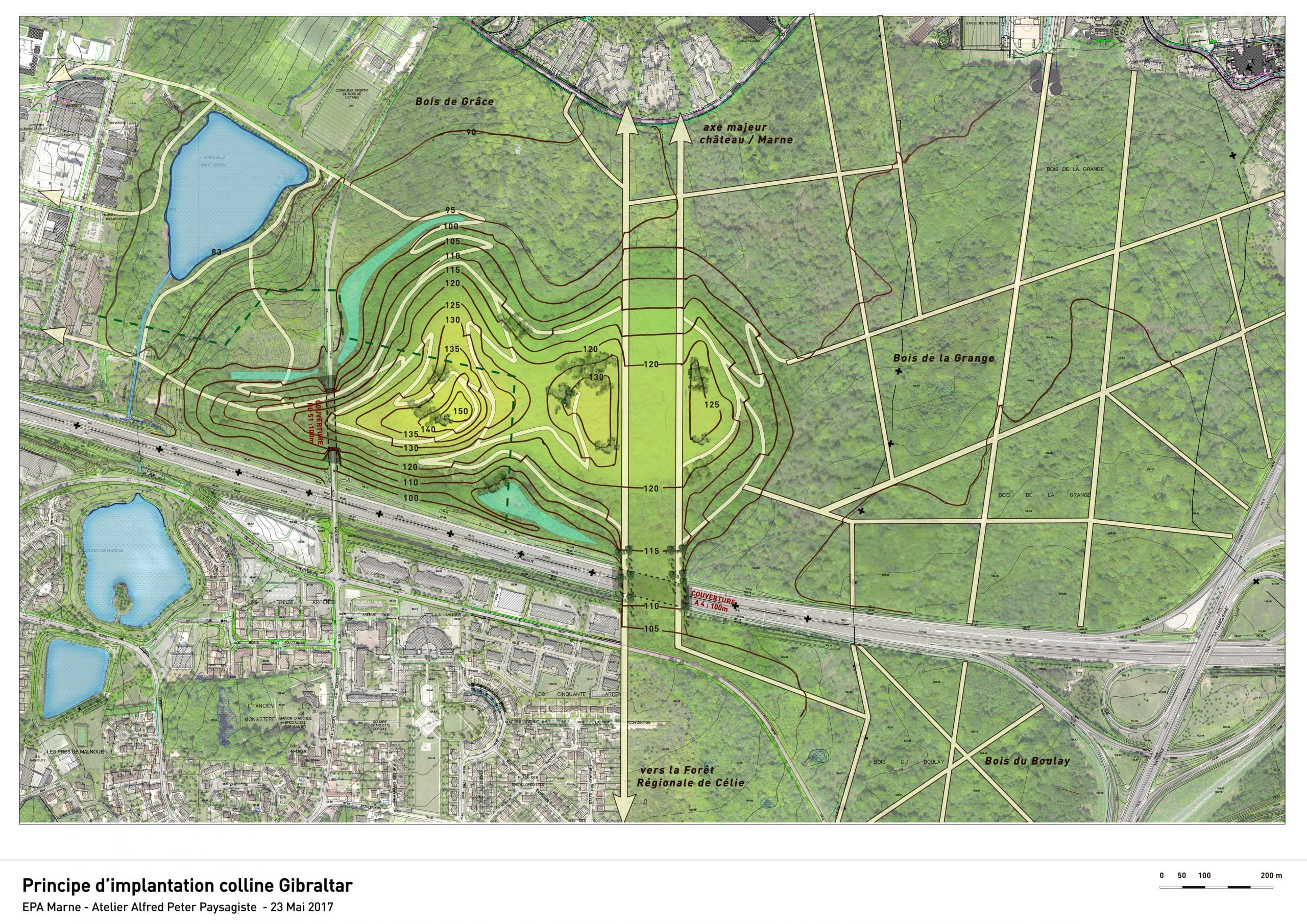
Inversion du regard et trame verte
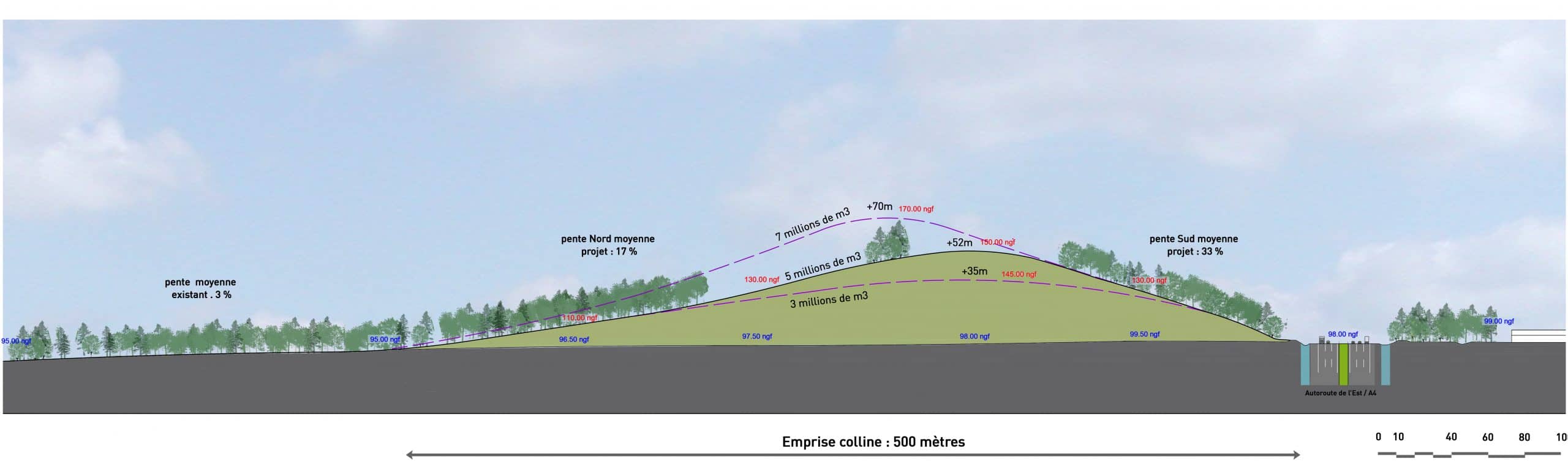
Une capacité de stockage ajustable avec un optimum autour de 5 millions de m3
Anuradhapura est l’une des anciennes capitales du Sri Lanka, célèbre pour son site archéologique inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les ruines, bien préservées, sont un témoignage de la sophistication de la civilisation sri lankaise qui s’est épanouie au début de l’ère commune. La ville disposait de systèmes d’irrigation extrêmement complexes, dont beaucoup sont toujours en usage.
L’Agence Française de Développement (AFD) conduit un projet de valorisation du patrimoine, de développement du tourisme, et d’amélioration du fonctionnement de la ville moderne. Une équipe pluridisciplinaire, dirigée par l’agence d’urbanisme de la ville de Bordeaux, a été chargée de constituer une préétude de faisabilité. L’atelier Alfred Peter, responsable de l’expertise paysagère, a développé un plan directeur et différents scénarii d’aménagements de sites.
Le projet met en valeur le paysage exceptionnel de la région d’Anuradhapura, afin de proposer une expérience unique aux visiteurs.
Un nouveau réseau de voirie réservé aux modes de transports doux et basé sur le tracé historique des axes de desserte du site, donne une meilleure lisibilité du territoire.
Ces aménagements permettent de découvrir les monuments sous un angle neuf, tout en créant de nouveaux moyens de se déplacer en sécurité et à l’abri de la pollution dans la ville moderne.
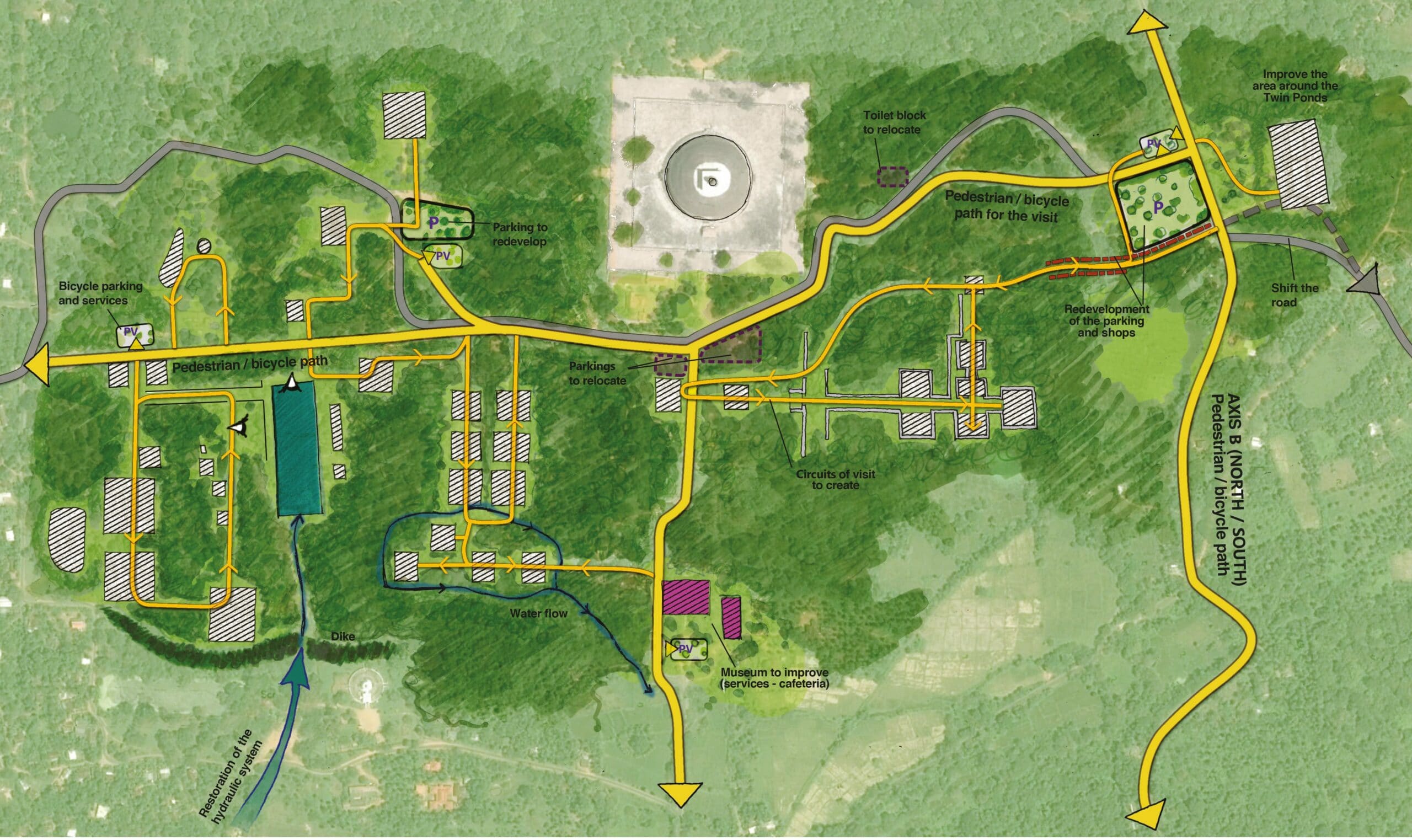
Plan du site d’Abhayagiri Monastery

Nouvel itinéraire cyclable et piéton le long de la voie ferrée

Nouvelle promenade le long de Nuwara Wewa Tank

Nouvel itinéraire cyclable et piéton le long de la voie ferrée
Ce projet de Transport en site propre est le deuxième volet de la réorganisation du réseau basée sur 4 lignes structurantes. La ligne 2, orientée Nord-Sud, complète la Ligne 1 reliant Bayonne – Anglet – Biarritz d’Est en Ouest.
Le parcours de la ligne 2 permet de desservir des territoires attractifs en plein développement situés aux deux extrémités du tracé.
Dans sa partie centrale, la nouvelle ligne reprend le tracé de la ligne 1 en desservant notamment le centre historique de Bayonne.
L’objectif urbain de ce tracé est également de liaisonner de nombreux projets de requalification de sites, et pour Tarnos, un travail soigné de « couture » et de partage d’espaces publics parviendront à reconnecter ses deux morceaux de ville..

Station multimodale

Station multimodale
Le bus est le système de transport public le plus utilisé dans le monde ; souvent considéré comme le moyen de transport du pauvre, il a, ces dernières années, retrouvé une place non négligeable dans les transports modernes en gagnant en confort, en capacité et en efficacité.
Dans une île encore faiblement motorisée, nous sommes persuadés qu’il y a un véritable challenge à relever en créant un projet systémique dans lequel les modes doux, les taxis et le bus créent une offre rendant la voiture particulière inutile. Toutefois la possession de sa voiture reste un symbole social très fort ; pour contourner cette difficulté, nous pensons qu’un travail de fond sur l’espace urbain, combiné avec des mesures judicieuses de restriction des capacités routières, permet de rendre le bus « naturel », qualifiant et totalement intégré. C’est pour nous le principal défi de ce projet : Créer un projet unique, original et adapté à ce contexte très particulier, et non pas plagier un concept élaboré ailleurs….
Les études antérieures ont bien dégrossi le travail en définissant les armatures du réseau structurant. Notre travail consiste d’abord à le faire « atterrir », à lui donner un visage, à le faire réagir aux multiples contextes traversés. Dans ce domaine, le groupement a une longue expérience et en a tiré la stratégie appelée « les frappes ciblées ».
Ce principe, dont le nom (mais que le nom) est emprunté des militaires, consiste à ne pas saupoudrer le budget sur l’ensemble du parcours mais de le concentrer sur des lieux bien choisis en fonction de trois critères :
- ceux qui permettent de faire gagner significativement du temps aux véhicules de transport public,
- ceux qui permettent de créer une vraie qualité urbaine,
- ceux qui permettent d’interconnecter tous les systèmes entre eux,
En dehors de ces trois situations, le grand avantage des bus est qu’ils peuvent emprunter des voiries existantes. Cette souplesse du système permet une utilisation optimale du budget pour améliorer la qualité de la vie quotidienne des mahorais.
Cette stratégie, que nous avons mise en place sur les projets TCU comme Dunkerque (DK plus), Belfort (Optymo 2), ou encore Bayonne-Anglet-Biarritz, montre à quel point chaque projet est, pour nous, une invention unique et non transposable.

Pôle d’échange central à proximité du Marché

Desserte des groupes scolaires à Kawéni
L’attractivité d’un transport collectif dépend de sa régularité, qui le rend prévisible et fiable pour le voyageur. En réduisant les points noirs de circulation, le projet d’aménagement supprime les aléas de temps de parcours, assure que le bus soit à l’heure à chaque station, et que son temps de parcours soit toujours le même.
La mise en place du BHNS permet au transport en commun d’être plus compétitif au regard de l’automobile. Il est projeté que 15 % des usagers de la ligne de TCSP, après sa mise en service, utilisaient une voiture auparavant pour se déplacer. Le projet participe activement à une décongestion urbaine de par son attractivité.
Le confort physique des passagers est amélioré par la réduction des temps d’arrêts et des accélérations et décélérations dues aux congestions routières.
Chaque ligne du projet TCSP aura 2 pôles multimodaux principaux qui permettront de desservir les liaisons transfrontalières.
Le long du parcours du TCSP sont aménagées plusieurs plateformes d’intermodalité permettant à l’utilisateur d’avoir accès à un service de location de vélo et de location de véhicules électriques. Un seul support de billettique est utilisé pour l’ensemble des services.
Ces lignes permettent d’améliorer sensiblement les temps de parcours, le confort de déplacement et l’accessibilité en général. Cela se traduit par un gain de fréquentation, pour le projet à l’horizon 2020, de 12% par rapport à la situation « Fil de l’eau» 2020, et un gain de fréquentation de 34% par rapport à la situation de calage 2006.
Les estimations de la fréquentation, avec le projet TCSP année 2020 est de 37 096 voyageurs/jour.
Le projet de Liaison Intercommunale Nord Ouest (LINO) a été initié dans les années 1970 comme un élément purement fonctionnel du système routier radio-concentrique rapide exclusivement basé sur l’automobile.
Après plusieurs décennies de mise en veille, cette étude a permis de faire évoluer substantiellement le projet et d’en préciser le programme et le parti d’aménagement. Au-delà du simple projet de voirie, la LINO devient un élément constitutif du « grand boulevard urbain Lillois » et la moitié de l’emprise disponible sera affectée à d’autres modes de déplacements : piétons, cyclistes, couloirs bus mais aussi à des aménagements paysagers.
La LINO est devenue un projet « pluridisciplinaire » et « transversal » et ne se pense plus comme une offre supplémentaire en concurrence avec les transports publics, mais comme un l’un des maillons d’un système de modes de déplacements complémentaires.
- LINO SUD est une route dans un écrin planté type parkway, avec deux séquences fortement bâties à Haubourdin et à Lomme.
- LINO NORD est un boulevard planté 2×1 voie avec stationnement et voie Bus à Haut Niveau de Service.
- LINO CENTRE est raccordée sur l’avenue de l’hippodrome pour améliorer son fonctionnement.
Une voie bus en rocade empreinte l’ensemble de l’itinéraire (en voie unique sur certains tronçons).
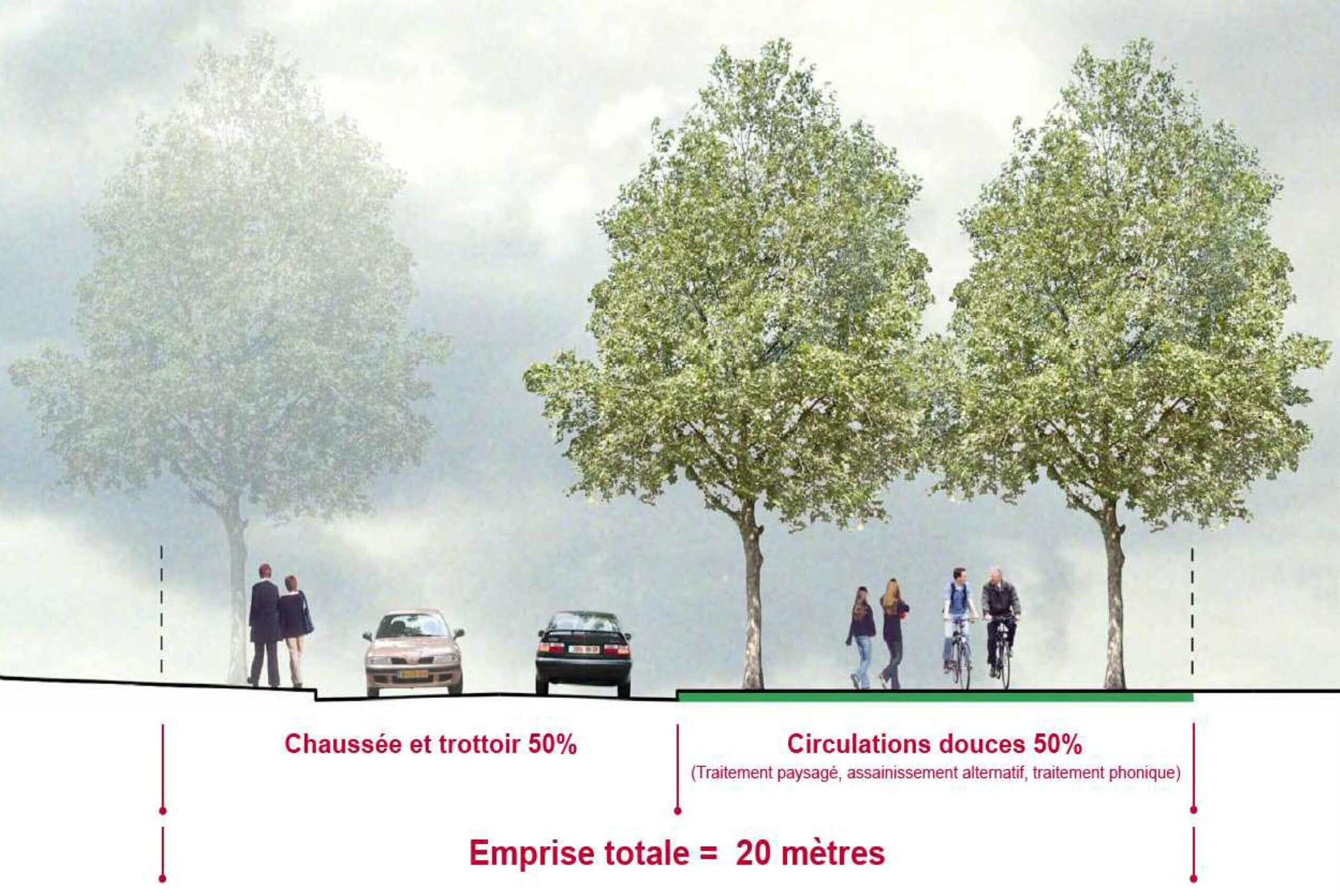
Principe d’aménagement en section courante

Photomontage
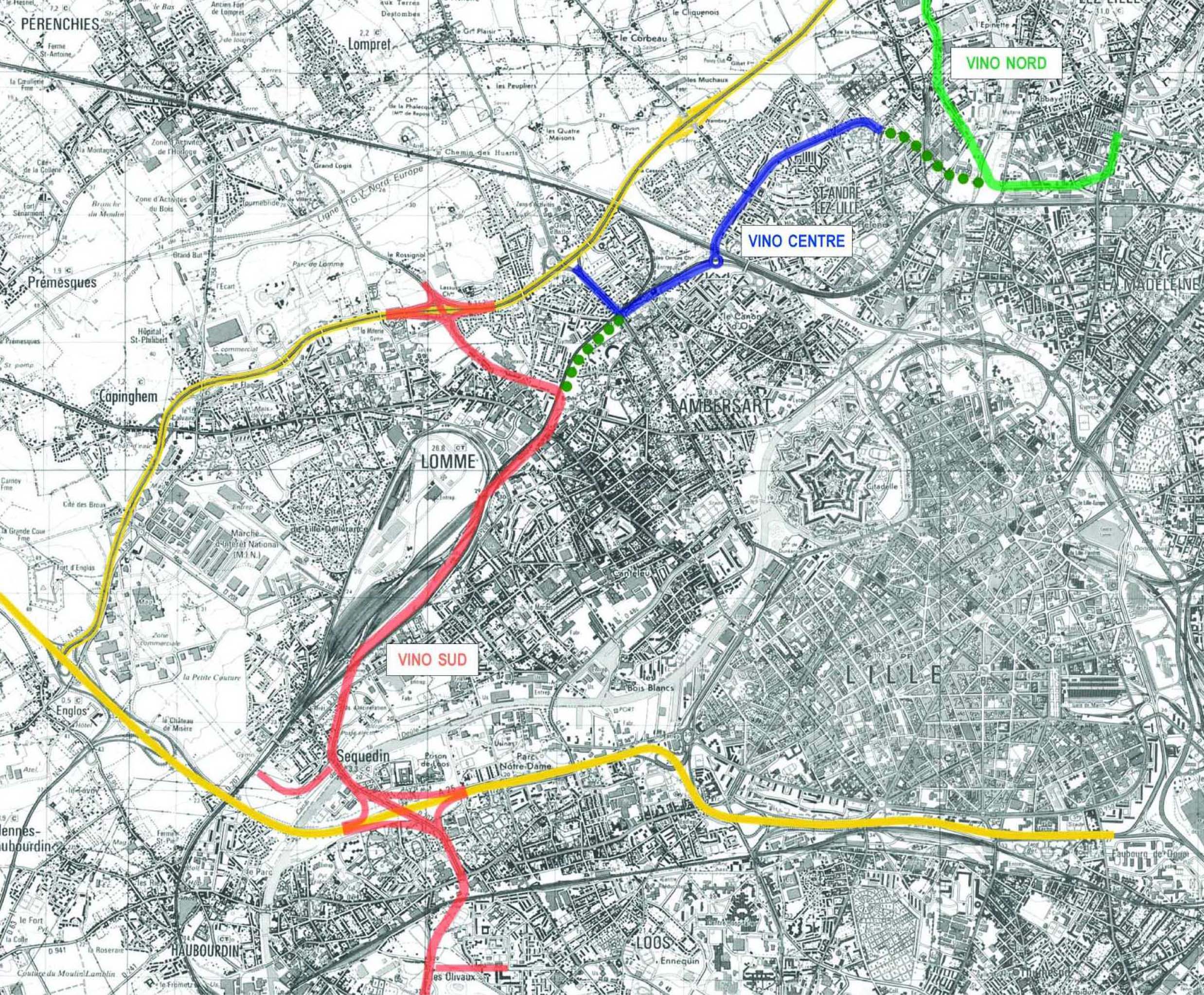
Plan de situation des LINO Nord, Centre et Sud
Le projet LINO a initialement été pensé comme un système routier radio-centrique rapide basé sur l’automobile. Après 40 ans de dormance, l’étude menée en 2005 par l’Atelier Peter / RR&A a permis de repenser le projet comme un élément constitutif du « grand boulevard urbain Lillois » en consacrant la moitié de son profil aux modes doux et au paysage.
Le projet de la LINO Nord avait pour objectif de transformer un tronçon stratégique de la LINO, longeant de d’importantes emprises industrielles vacantes.
La LINO Nord doit être considérée comme un espace public de près de 3500 mètres linéaires. Elle préfigure le renouvellement des quartiers le long de la Deûle par un traitement basé sur trois principes :
- Une répartition équilibrée des différents modes de déplacements : moitié de l’emprise réservée pour les transports motorisés, moitié pour les autres modes.
- Une armature spatiale et végétale permettant d’identifier la LINO comme une voie structurante.
- Un traitement environnemental innovant permettant d’intervenir sur les questions du bruit, de l’eau, de la température, du vent, de la lumière…
Pour prendre en compte les projets de développement urbain d’envergure entrevus sur les délaissés industriels qui longent en grande partie l’infrastructure, l’aménagement intègre une mesure conservatoire permettant son l’élargissement à 2×2 voies. Cette évolutivité du profil permettra à la LINO de s’adapter à densité urbaine forte sans opter pour un surdimensionnement immédiat.
Dans un souci de durabilité, le projet maximise la réutilisation de la voirie existante.

Route bordée d’une noue plantée qui structure, agrémente et récolte les eaux pluviales

État antérieur
Sur la base d’une série d’entretiens de concertation avec les acteurs-clés du contrat de pôle il s’agissait de :
- mettre à jour les éléments de programme propres à chaque partenaire, en tenant compte des enjeux et des opportunités liés au développement urbain des communes ;
- formuler des scénarios de spatialisation (2 à 3) des éléments de programme, en mettant en évidence, le cas échéant, les arbitrages à effectuer pour construire un projet cohérent qui ne soit pas uniquement la somme des contraintes propres à chaque partenaire ;
- mettre à jour le contrat de pôle sur la base du scénario retenu. Le rendu doit permettre d’établir un programme en vue du lancement d’une consultation de maîtrise d’œuvre. Pour ce faire, il s’agit de vérifier la faisabilité technique et géométrique du projet au niveau étude préliminaire (esquisse au 1/1.000) et de définir une enveloppe budgétaire pour sa réalisation
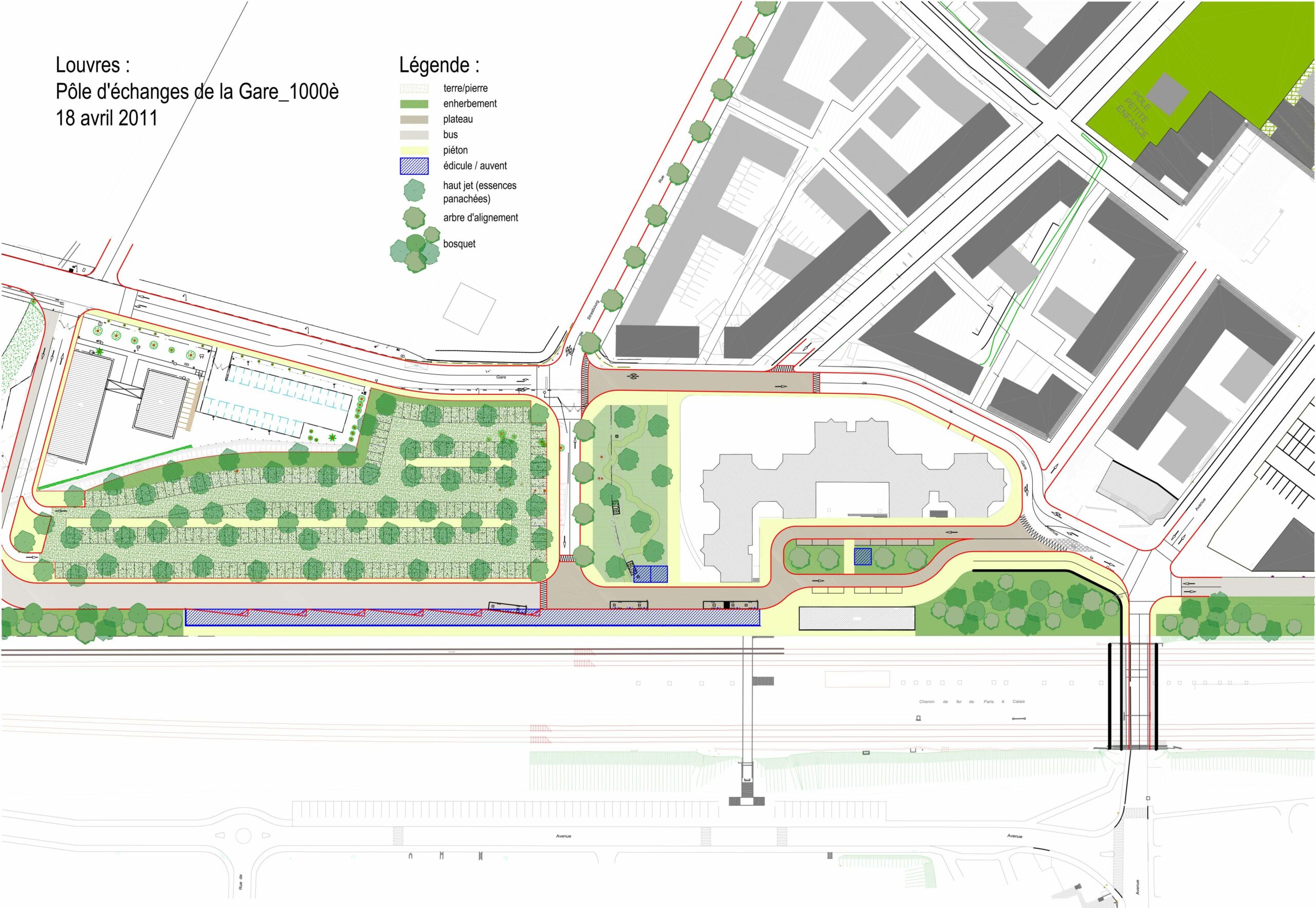
Plan masse du projet
Le Rhin Supérieur (Bâle/Karlsruhe) fonctionne de plus en plus comme un territoire métropolisé dans lequel les gares sont des points d’entrée stratégiques. Pour que Sélestat y tienne son rang, sa gare et son environnement nécessite un lifting sérieux. L’étude de faisabilité en a élaboré les bases, l’étape à venir doit le consolider tout en y apportant quelques innovations qui transcendent le sujet.
L’accessibilité, les parkings
L’accès par une nouvelle voie depuis le Sud pour desservir une poche de parking payante déportée au delà de la passerelle est un point fort du projet. Si le parking lui-même peut être traité de manière extrêmement sobre, (il n’a pas vocation à rester parking indéfiniment) la conduite des piétons vers l’accès au quai doit être soignée par un passage couvert, par exemple éclairé la nuit, pour créer un lien fort et effacer le sentiment d’éloignement de celui-ci.
La taille et la vocation du parvis
La construction imminente de l’immeuble Boltz sur le bord Sud contribuera à le border et effacer le côté fuyant ou liquide de cet espace ; Le parvis lui-même a pour premier rôle d’être un maillon du parcours Gare/Centre Ville. Nous le voyons comme une place jardin qui, animée ou pas, est un espace agréable. Comme pour l’entrée Nord en cours de réalisation, Sélestat se dévoilera en traversant un parc ; parc qui se prolongera jusqu’au NEJE WAJ. Les 3 maisons qui obstruent l’axe Ville/Gare depuis plus de 150 ans seront englobées dans le traitement global.
La gare routière
Maillon essentiel dans le dispositif multimodal, elle semble un peu étriquée, entre le talus du passage supérieur et le parvis. En matière de transport public, il faut voir grand, même si dans un premier temps, l’espace pourrait convenir. Mas nous pensons qu’un dispositif perpendiculaire à la gare plus ouvert et extensible mérite d’être testé. Cela permettrait sans doute de donner un bord à la face Nord du parvis et contribuerait mieux à son animation. Juste une intuition, privilège de l’oeil neuf …
La fermeture de l’entreprise ALBANY
Cette actualité brûlante est bien entendu une nouvelle donne. Même si elle n’aura probablement pas de répercussion sur la première phase du projet gare, le potentiel de cette énorme parcelle doit être intégré dans une nouvelle réflexion qui mêle court, moyen et long terme. Elle ouvre une perspective de constitution d’un vrai quartier gare avec une masse critique permettant de le concevoir comme tel. Même si à court terme, cette mutation se traduit par des pertes d’emplois, cette réserve foncière permet d’envisager l’avenir de la gare de Sélestat avec une ambition visant à renforcer le rôle de la ville dans une métropole mulipolaire.
Le bâtiment de la Gare
Vaisseau amiral du quartier, de très bonne facture architecturale, mais totalement vidé de sa fonction de gare traditionnelle, il doit retrouver une fonction majeure dans le nouveau dispositif. Même si la ville n’en est ni le propriétaire, ni le gestionnaire, ce bâtiment ne peut rester à quai. Notre expérience de travail avec la SNCF nous permet d’envisager une réflexion collaborative pour lui redonner son rôle prédominant même avec une fonction autre, et d’autres investisseurs…
Le périmètre d’étude, étendu, avec sa gare routière est situé stratégiquement à l’entrée ouest du centre ville. Notre ambition est de faire de ce pôle d’échanges bien plus, un parc urbain digne d’une entrée de ville telle que Sélestat.

La gare aujourd’hui…

La gare aujourd’hui…
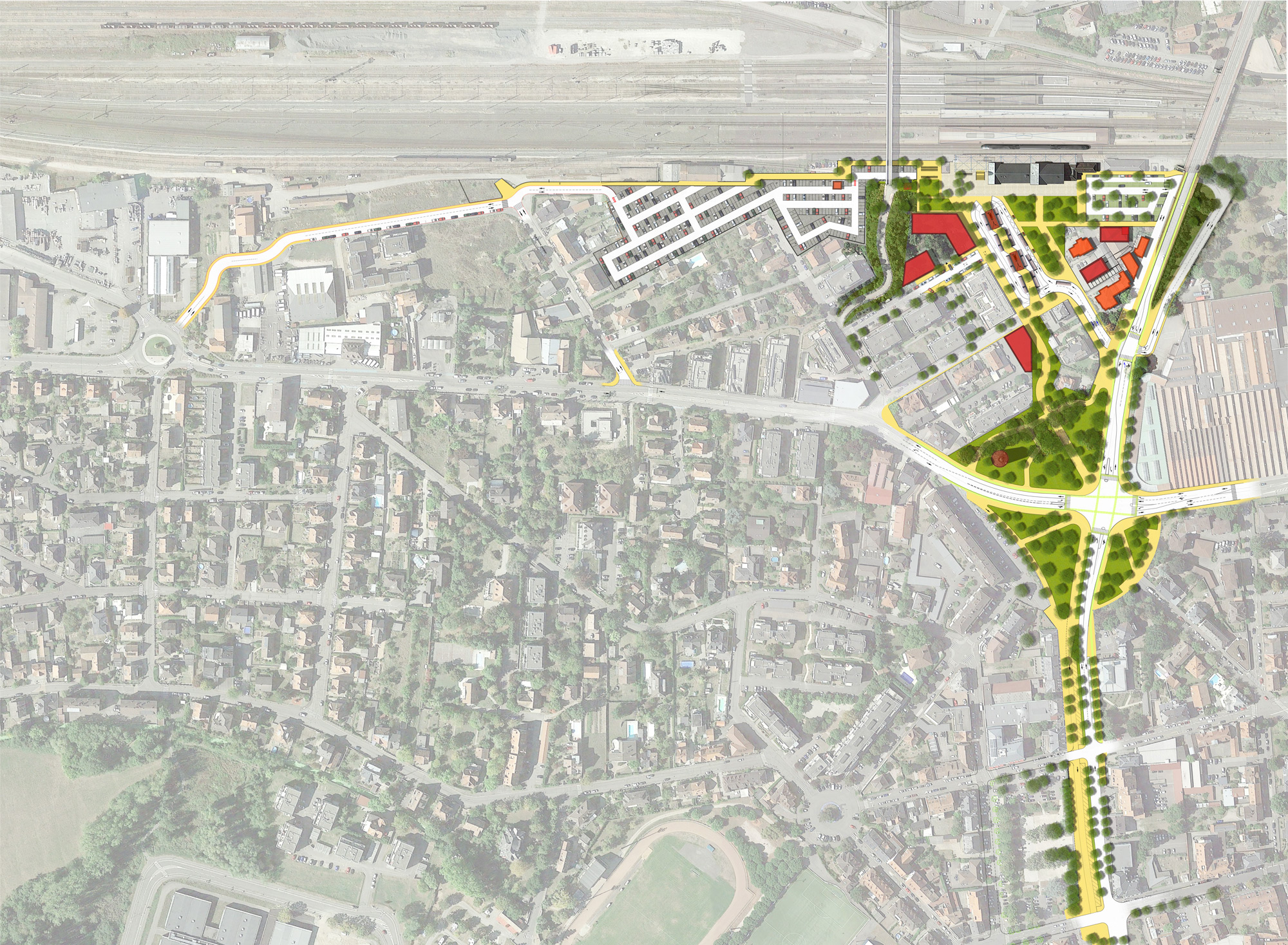
Demain, un aménagement structurant autour d’un parc
La libération de la contrainte du trafic de transit dans la traversée de la commune de Wintzenheim a offert une opportunité d’initier une véritable « Renaissance ». Le réaménagement de l’axe principal et ses dilatations en est le premier acte ; les mutations commerciales vont suivre, et de nombreux usages vont s’instaurer. Notre proposition vise à ouvrir ce chantier en changeant spectaculairement l’ambiance de ce parcours sans trop prédéterminer les usages futurs… Notre suggestion peut donc se résumer en 3 mots :
- PACIFIER la circulation restante
- ÉQUILIBRER les usages, entre les transports individuels et les autres usages
- EMBELLIR en créant un nouveau climat « villageois »
La mise en lumière des espaces
L’éclairage joue un rôle important dans notre proposition de maîtrise des ambiances. Plutôt que de tout démonter, nous proposons de travailler avec le matériel existant d’une part, en changeant les sources inadaptées ou simplement en le repeignant ; avec des luminaires neufs aux performances adéquates et pour traiter des lieux singuliers d’autre part.
La situation géographique particulière de la ville de Wintzenheim et l’omniprésence du paysage vallonné, nous invite à matérialiser le cycle du soleil par la mise en lumière.
Nous marquons les 3 sections avec 3 teintes de lumières blanches.
Du « blanc froid » matinal à l’Est, à la lumière dorée du couchant à l’Ouest, la lumière apportera une vraie diversité d’ambiances.
8 tableaux de lumière comme autant de repères dans la ville, de lieux de rencontre, de flânerie ou de contemplation – jardins publics, place des fêtes, place centrale et place de la république, porte basse, porte haute, parking rue de Verdun et rue du Hohlandsbourg, la chapelle – viennent ponctuellement rompre cette linéarité blanche singulière, en les baignant dans des couleurs pastelles douces et intimistes.
Les soubassements des façades des rues latérales de la vieille ville reçoivent quant à eux 3 points lumineux renvoyant aux 3 points de « l’ae cetera », incitant les passants à s’y aventurer également…

Un nouveau lieu de destination dans une ambiance apaisée

Des espaces publics polyvalents, sobres et authentiques
En fermant la place aux voitures le 10 février 2010, la municipalité a fait le plus dur : rendre ce lieu bordé de monuments exceptionnels agencés de manière très subtile, à la vie urbaine.
Pour transformer cet essai, nous nous appuyons sur les principales demandes qui ont émergées de la concertation : fabriquer de la convivialité, faciliter les animations, prendre son temps pour la contemplation. Nous pensons que cet espace n’a pas besoin de grand geste, la cinquième façade doit être entièrement au service des quatre autres ; dans un lieu aussi chargé historiquement, la retenue nous semble la seule attitude juste et la transformation doit se faire par petites touches.
Une touche spatiale : si l’état sanitaire des arbres condamne à les supprimer, mais il ne nous semble pas imaginable de rendre ce lieu entièrement minéral. Nous proposons de créer «un filtre visuel» entre la cathédrale et les autres monuments par dix arbres majestueux au feuillage très léger, installés en double rangée dans le sens de la plus grande longueur et dans le tiers supérieur de la place. Ce filtre permet une perception d’ensemble tout en installant un confort pour l’œil en évitant des confrontations visuelles trop violentes.
Une touche de confort : un sentiment de fraîcheur en été, une liberté de mouvement sans entrave, une impression de sécurité la nuit sont quelques paramètres auxquels nous portons une attention particulière. Nous avons réalisé une modélisation de l’ensoleillement de la place pour apporter de l’ombre au bon moment, nous soignons les assises pour apprécier ce lieu sous différents angles et avons veillé à ce que cette place puisse rester très polyvalente et accueillante pour toutes les expressions de la vie collective. Pendant les heures chaudes des journées estivales, un brouillard rafraîchissant émergera dans toute la partie centrale de la place… Il faut également repenser l’usage de nuit, composer une identité nocturne du lieu. Nous souhaitons, plus que d’en permettre l’usage, de donner à ressentir une atmosphère, à vivre un temps à part.
Une touche artistique : le sol, tout en gardant une grande neutralité est travaillé comme un tapis. Un rectangle de 90x36m détaché des rives par le pavé granit existant autour de la cathédrale, donne une touche singulière à ce lieu. Composé de dalles béton grenaillées de dimensions 50x50cm et perforées de 25 trou s coniques chacune, ce sol poreux, écologique pixellise la surface. Son motif est une interprétation d’un fragment de vitrail de la cathédrale. Ce travail très poussé des qualités du béton (résistance, teinte, aspect de surface, stabilité dans le temps…) sollicite une virtuosité, un savoir faire de ce matériau dans l’esprit des bâtisseurs de cathédrale.
Une touche écologique : ce matériau poreux laisse respirer le sol et passer les eaux de pluie. Déjà mise en œuvre à Strasbourg sur de petites surfaces autour des arbres, il doit donner une expression plastique originale d’un concept écologique en démontrant que le «durable» et le beau peuvent fabriquer cet aménagement de référence souhaité dans le programme.
Nous avons donc adopté une posture de traitement minimaliste : c’est l’art le plus difficile ; chaque détail compte double et la moindre erreur en matière de nivellement, de raccordement, d’assemblage peut être fatale ! Nous essayons d’être à la hauteur de ce défi en ce lieu hautement emblématique, en rapprochant deux effets contradictoires : rassurer et étonner.

Un traitement minimaliste

Évocation en pavé béton d’un vitrail de la Cathédrale Notre-Dame
Simplicité
La structure urbaine de Vence est tellement belle, tellement claire que l’aménagement des espaces publics doit entièrement et exclusivement être dédié à la mise en valeur de ce patrimoine. Les espaces publics de Vence sont soit « suraménagés », soit « sous-aménagés » et envahis par l’automobile.
Nous avons privilégié la justesse, l’évidence, l’impression que cela a toujours été comme ça, au détriment des effets à la mode.
Authenticité
Les espaces à traiter sont des lieux de vie devant s’accommoder d’espaces réduits forcément polyvalents ; l’influence des saisons, les animations événementielles, le climat, le poids de la tradition, le besoin de se faire voir sont autant d’éléments qui doivent guider l’aménagement.
Sobriété
La sobriété est déclinée dans tous les domaines : les matériaux du sol, l’éclairage, le mobilier, les installations festives…. et ouvre grand le champ des possibles.

Photomontage depuis le belvédère

Plan masse
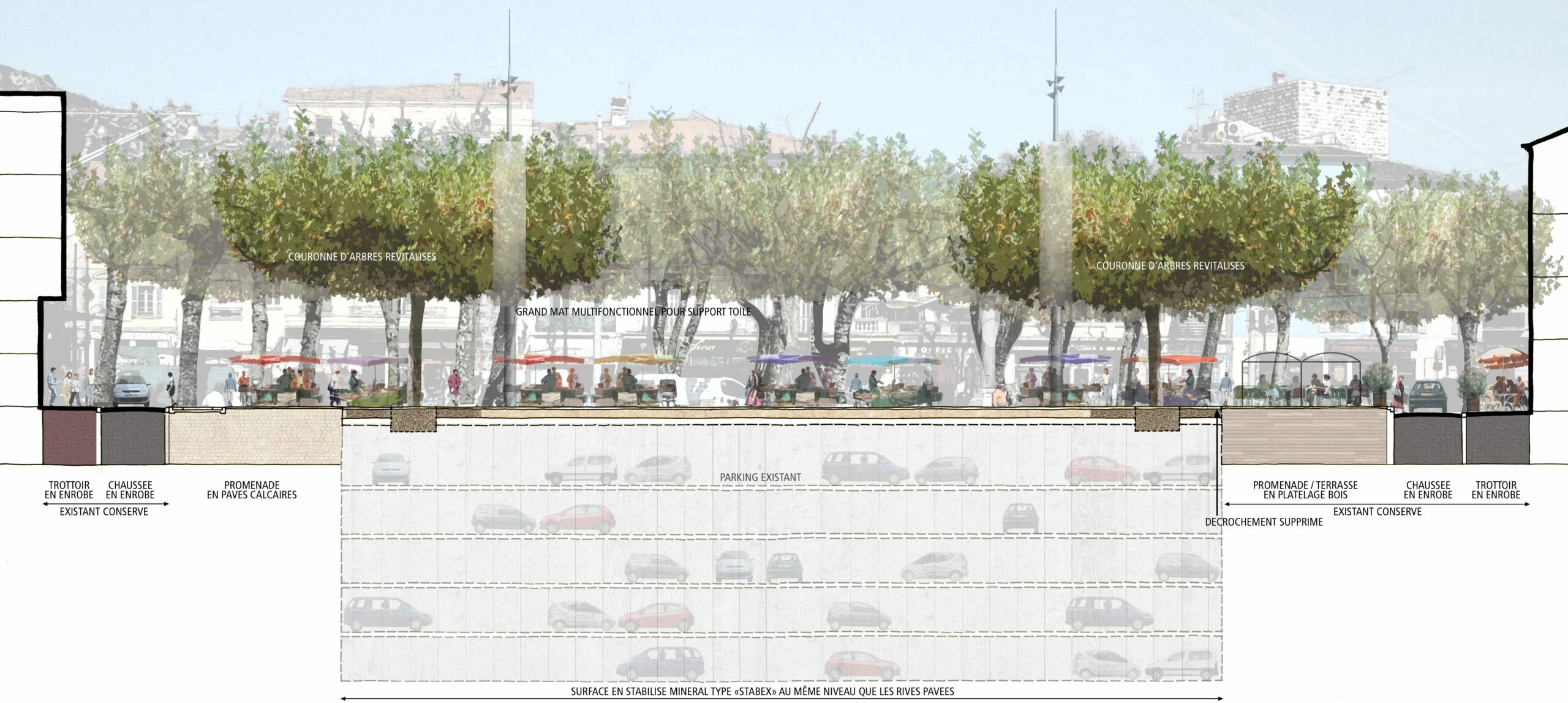
Profil en travers sur la place et le grand jardin
Transformer la place Gambetta en un espace public significatif de ce début du XXIème siècle est un beau challenge car ce lieu aux multiples facettes nécessitait de croiser trois paramètres :
- L’histoire : depuis la destruction des remparts pour créer la ceinture des cours, ce lieu a subi maintes transformations pour d’adapter à son époque, hormis les façades, héritage stable et immuable. Cette architecture significative du XVIIIème siècle doit retrouver son véritable rôle structurel de la place en la rendant plus présente.
- L’environnemental (ou la préséance du vivant) : la fraîcheur, l’hydraulique, la biodiversité, la résilience, sont quelques paramètres qui émergent dans les visions de la ville durable ; ils sont condensés dans ce projet avec la redéfinition du rôle et de la forme du jardin.
- La mobilité : les transports ont fait les heures de gloire de cette place mais sont aussi une des principales sources de problèmes avec la ronde infernale des autos et des bus autour du jardin. Un rééquilibrage est donc nécessaire.
The « leaf » ne choisit pas, ne priorise pas l’un des trois domaines. Il les traite simultanément en modulant la forme et les fonctions avec les marges de liberté offertes par le programme :
- Le patrimoine est remis à sa juste place en redonnant le rôle essentiel aux bords à travers des perspectives inédites, à travers les masses végétales disposées de telle manière à redonner aux façades leur rôle imminent.
- Le jardin est réinterprété et adapté aux nouveaux modes de vie des citoyens : ouvert, polyvalent, décontracté. L’eau pluviale, la palette végétale, le traitement légèrement en creux façonnent le « vert » sans le figer dans une scénographie statique.
- La mobilité, tous modes confondus, est réinterprétée en conservant de la place son statut de lieu de passage, d’échange en applicant le concept de la fluidité lente mis en évidence dans le grenelle des mobilités.

Un jardin décontracté adaptable aux nouveaux usages

Deux courbes dessinent une feuille : the leaf

La lanterne / le jardin et les façades illuminent la place… Pas de mobilier d’éclairage sur les parties minérales

Photomontage place de la mairie
« Les Quais » représentent une part importante du patrimoine strasbourgeois confisqué par une occupation de l’espace public par l’automobile. Le pari du projet est que cette situation n’est pas inéluctable et ainsi cette reconquête permet de développer simultanément 3 thèmes :
- Les retrouvailles avec l’eau de l’Ill, racine essentielle de l’identité strasbourgeoise.
- Un lieu de flânerie sur le quai haut avec la création de nouveaux points de vue sur le patrimoine.
- Un lieu d’usages nouveaux dans la philosophie d’une zone de rencontre.
C’est la combinaison de ces 3 paramètres qui a permis de créer un projet dont le principe est de garder une grande sobriété dans le traitement et une vraie polyvalence dans les usages.
Les rapports à l’eau
Sur les quais bas, comme il n’est pas possible de créer un cheminement continu – à l’instar du quai rive gauche – le rapport à l’eau est travaillé suivant plusieurs dispositifs en utilisant au maximum les éléments préexistants :
- Un ponton flottant de 120m de long est installé en lieu et place du porte à faux sur la partie Ouest du quai
- 6 petites plate-formes suspendues sont réparties le long du quai des Bateliers, offrant des accès ponctuels au dessus de l’eau.
Parfois ponctuel, parfois linéaire, le rapport à l’eau est donc développé en de multiples facettes.
La rue
Le principe de la zone de rencontre est de permettre une cohabitation apaisée de tous les usagers. Cela nécessite d’être particulièrement vigilant au nouveau rapport de force qui doit s’installer entre les véhicules, les modes doux et les nouvelles activités…
L’espace public est restitué sous forme d’un plateau continu, ce qui d’emblée créé une sensation de largeur, de générosité complètement occultée aujourd’hui.
Une plinthe d’environ 1m redonne une assise aux superbes bâtiments très hétérogènes.
Il y a 3 revêtements de sol majeurs : la plinthe traitée avec les pavés granit de récupération, aujourd’hui posés le long des garde-corps. Le reste de la surface est revêtu de pavés béton gris avec un traitement de surface en pierre reconstituée. La zone 30 du quai des Pêcheurs jusqu’à la rue de Zurich est traitée en enrobé.
Des massifs d’arbres plantés en bosquets permettent de casser la perspective au niveau des ponts ou des dilatations de l’espace.
Des usages nouveaux
La principale difficulté d’une zone de rencontre est de créer un aménagement souple, capable de s’adapter aux nouveaux usages qui vont se manifester au fur et à mesure que le nouvel espace public s’impose comme un haut lieu du « Strasbourg qui bouge ». Pour réaliser un espace souple et polyvalent, nous distinguons différentes émergence :
- Les éléments fixes : arbres, bornes et quelques luminaires sur mât l’essentiel étant en accroche façade
- Les éléments déplaçables puisés dans un « kit » pour tester des dispositifs (jour de marché par ex.)
- Les éléments saisonniers : terrasses, jeux, installations pour les animations de Noël…
- Les facilitateurs bornes encastrables, kiosque,…

Perspective depuis le pont du Corbeau

Vue du quai des Bateliers

Perspective Place Saint-Guillaume

Vue du belvédère quai des Bateliers
Construire la pente
Le premier principe constructif du projet consiste à utiliser la pente forte du terrain naturel pour offrir à l’ensemble des habitants une vue dégagée sur le grand paysage. La construction en escalier permet de coller au plus près au terrain naturel et éviter les terrassements pouvant déstabiliser le terrain.
Cette construction sur le mode des « restanques augmentées » implique des logements, pour l’essentiel, mono-orientés vers l’Est ; des prises de lumière complémentaires sont néanmoins possibles par le toit et les façades latérales pour ceux qui donnent sur les venelles. Le travail des architectes d’opération sera très important pour apporter de la diversité et de la surprise (en utilisant les duplex, les fentes de lumière, etc…). Le toit végétalisé des rangées supérieures permettra d’installer de longues travées de panneaux solaires
La desserte
La route d’accès utilise au maximum la voirie existante. Elle n’est pas traversante pour éviter tout appel de trafic de transit à travers le quartier.
Les parkings, un par secteur, sont installés dans la partie basse ou haute du terrain dans 2 ouvrages semi enterrés. Ce regroupement permet de rationaliser les ouvrages, d’en diminuer le coût et d’éviter la création d’une voirie traditionnelle dans la zone habitée.
Des ascenseurs inclinés permettront de desservir les différentes rangées de logements. Bien qu’étant partiellement à l’air libre, ils font partie intégrante de la construction. Le raccordement aux différents niveaux des appartements sera une des difficultés compte-tenu de leurs contraintes de pente et de profil en long. Chaque barrette est néanmoins accessible pour les pompiers, les livraisons lourdes via la piste carrossable.
Les cheminements piétons Est-Ouest sont favorisés par une multitude de passages entre les différentes constructions et un réseau de cheminements complémentaires uniquement mode doux Nord-Sud irriguent le site dans son ensemble, d’une rive à l’autre du vallon principal. Le nouveau quartier est relié au vieux village par le chemin de Provence. Déporté vers l’opération, il permet la réalisation de quais bus adossés à une place d’accueil haute rive gauche, avec son pendant rive droite au bas de l’opération.
L’espace public
Le projet dégage entre les travées des espaces de transition qui s’ouvrent sur les coulées vertes des vallons. Le concept consiste à lier ces espaces naturels entre eux par un traitement alliant une bande de desserte minéralisée, une dépression pour collecter et infiltrer les eaux pluviales et des restanques permettant de rattraper le niveau.



Le projet est construit autour de 5 principes :
LA FORME URBAINE : comme beaucoup de cités construites dans les années 60, sa morphologie est largement inspirée des concepts du mouvement moderne et n’est pas sans qualité. On peut regretter qu’elle tire si peu avantage de ce site exceptionnel, mais sa composition assez aérée laisse une grande liberté d’expression aux espaces publics. Nous en avons profité pour créer une figure jouant avec la facture monumentale et monolithique des bâtiments.
LA DISSYMÉTRIE : entre les rives Nord et Sud, les affectations des rez-de-chaussée est une particularité que nous avons décidé de souligner en positionnant les animations (marché, pôle d’échanges, activités ludiques…) côté commerce. Cette dissymétrie fonctionnelle s’inscrit néanmoins dans un traitement global visant à conserver l’unité de l’espace.
LES PERSPECTIVES : nous avons tenté en vain d’ancrer cet espace dans le grand paysage, pour finalement aboutir à une figure calme, centrée sur elle-même plutôt qu’un arrimage lointain peu crédible. Cette figure se compose d’un sol strié par des bandes de 5 mètres comme un tissu dans lequel sont piqués toutes sortes d’émergences verticales (arbres, luminaires, mobilier…) amenant diversité et singularité.
LA POLYVALENCE DU LIEU : le plus grand danger pour les espaces réaménagés est de les surcharger en y imprimant fortement les usages connus. Ces aménagements «surdessinés» sont souvent des obstacles à l’organisation de nouvelles activités. En profitant des facilités (dimension de l’espace, accessibilité,…) nous avons veillé à ce que non seulement les différentes fonctions connues de pôle de correspondance, stationnement, marché… puissent fonctionner de manière concomitante, et que l’aménagement par sa modularité puisse suggérer d’autres événements. Nous pensons en particulier aux activités culturelles et sportives.
LA SINGULARITÉ : une place de 420 mètres de long sur 55 mètres de large est en soi déjà un événement. Nous avons pris le parti de la détacher par son expression formelle de toute référence similaire. La place d’Annecy, grand plateau planté doit compenser sa position un peu à l’écart par une très forte attractivité de son traitement dans le respect scrupuleux des contraintes énumérées dans le programme d’aménagement.

Pôle de correspondance des bus

Le marché hebdomadaire

Une nouvelle esplanade
Aujourd’hui on entre au centre de Sigolsheim depuis l’Est sans s’en apercevoir. Notre regard est attiré par Kaysersberg sur flanc de collines sous-vosgiennes, bien au-delà de la route des Vins. Rien n’est fait pour nous inciter à nous arrêter. Les actions engagées par la commune sur son patrimoine bâti, afin de dynamiser son centre, sont les prémices d’une nouvelle identité. Elles doivent s’accompagner d’un aménagement urbain à la hauteur.
Pour ce faire, notre première intervention, forte, vise à captiver le visiteur en dévoyant la route des Vins devant le lavoir. Le trafic de transit mû par la rapidité sera dissuadé ; on ralentira ; on s’interrogera sur cette inflexion et on finira par s’arrêter… pour voir.
Les deux sens de circulation seront séparés par une banquette enherbée sous les majestueux tilleuls préexistants. La nouvelle voirie au Sud est aussi l’occasion de créer un large trottoir, véritable promenade bucolique au bord de l’eau, de bout en bout de la rue. Son point d’orgue est le lavoir auquel on aura donné une seconde vie comme buvette, propice à une halte gourmande, en lien avec la future aire de pique-nique.
L’inflexion de la chaussée permet également de raccrocher la rue de la Première Armée à ce dispositif : en améliorant la lisibilité du carrefour ; en offrant un parvis généreux libéré de tous véhicules, aux commerces de bouche ; en plantant de vrais arbres d’alignement sur la rive Ouest de la rue jusqu’à celle du Vallon.
Cette dernière bénéficie d’un traitement simple mais imparable pour sécuriser les enfants sur le trajet de l’école et lui conférer un statut de zone de rencontre. Trottoirs filants en entrée de rue, mise à sens unique de la voie et plantation d’arbres en quinconce sur chaussée obligent ainsi les véhicules à réduire leur allure. On pourrait envisager l’ouverture d’une venelle entre la rue du Vallon et la route des Vins pour minimiser les déplacements motorisés et encourager les déplacements à pied de l’une à l’autre.
Dans ces aménagements, piétons et cyclistes trouveront leur compte (larges trottoirs, pistes ou bandes cyclables) sans pour autant oublier l’accès motorisé aux commerçants limitrophes en leur proposant une réelle offre de stationnement : 100 places réparties en 3 poches de parkings verts ou le long des voiries.
Ce travail phasé mais néanmoins complet de la route des Vins, des rues du Vallon et de la Première Armée donnera à Sigolsheim le dynamisme qu’elle mérite et fera de son cœur de ville un lieu vivant, attractif et authentique.
Le parc de l’Université est constitué de 3 sous-ensembles :
- un jardin classique
- un jardin scientifique
- un jardin romantique
L’atelier Alfred PETER a été chargé de la restauration de ce jardin en redéfinissant les usages, en régénérant la strate plantée et en imaginant une nouvelle forme de sa gestion. Respectueux de l’histoire du lieu, de ses tracés d’origine, le projet introduit une dimension contemporaine à travers des interventions artistiques ponctuelles dans les bosquets, à travers ses fontaines, sa mise en lumière…
Le projet a été réalisé en plusieurs phases de travaux en fonction des – petits – moyens disponibles.

Refaire un jardin donnant le goût de la réflexion

Vue sur le jardin classique
Ce projet d’extension a commencé alors que le nouveau cimetière était déjà lancé…
Situé sur un terrain nu ingrat en frange de ville, nous avons opté pour un dispositif alliant des sculptures traditionnelles (il y a trois marbriers à Erstein !) à un puissant dispositif paysager. Celui-ci est basé sur une levée de terre en forme de conque qui redéfinie un horizon ; de fortes plantations permettent d’accueillir d’autres formes de tombes. L’ensemble est conçu comme un parc qu’on a envie de visiter plus d’une fois l’an !

Un espace central libéré et polymorphe

Un lieu de recueillement dans la nature



Le 20 janvier 1992, à 19h25, l’avion Air Inter du vol Lyon-Strasbourg s’écrase dans la forêt vosgienne, à 500 m de la route qui monte au Mont St-Odile. Le bilan des victimes fait état de 87 morts et 10 survivants.
De toutes origines culturelles et religieuses, les victimes et les parents de victimes souhaitent tout simplement donner place à la mémoire. Nous respectons la marque du crash et installons des veilleurs taillés dans le grès par la sculptrice Annie Greiner.

Les trois veilleurs d’Annie Greiner

Un lieu de mémoire

Autre vue des veilleurs

Vue aérienne du site
Dans le cadre de la recherche de nouveaux modèles pour le commerce de périphérie, le gestionnaire du centre commercial de la Toison d’Or a proposé à la ville de Dijon de racheter un parc à la dérive et de le transformer en Parc de Loisirs.
L’atelier Alfred Peter accompagne cette démarche de diversification par la mise en scène de ce parc, s’appuyant sur les qualités du préexistant et du tramway.
Cette rénovation se fait donc d’abord par l’installation de nouveaux usages…

Plan masse

Activer le site la nuit
Cette friche industrielle en bordure du Doubs constitue une pièce importante du puzzle permettant de revitaliser le centre-ville.
L’Atelier Alfred Peter en association avec le cabinet BEJ a été lauréat d’un concours d’idée sur l’ensemble de la friche.
Le projet se réalise en plusieurs tranches et l’île en bordure du Doubs a été réalisée en priorité pour continuer la réappropriation de la rivière.

Ancien bâtiment réhabilité et transformé en halle festive

Vue aérienne du site

Vue d’ambiance

Vue d’ambiance

Vue d’ambiance
Toute commune a son espace collectif de représentation ; le plus souvent c’est une place publique regroupant les principaux bâtiments symboliques : mairie, église, commerces… Vendenheim n’en a pas.
L’objectif de ce projet est de créer ce «salon collectif» à partir d’un lieu qui aujourd’hui est une agrégation de fonctions. Il faut lui donner une âme, le rendre fédérateur, polyvalent, ouvert à tous. Les différentes fonctions : sports, loisirs, détente, agrès de jeux pour les enfants, fêtes, cérémonies doivent être mises en scène à travers un traitement de parc qui fera de ce lieu de Vendenheim l’incontournable, pour les fédinois et les autres…
L’armature du projet
Le parti d’aménagement est construit à partir de deux axes :
– La grande promenade centrale Est/Ouest reprend une allée qui existe déjà en la rendant plus généreuse, plus ouverte, plus équipée. Elle est mise en scène par rapport au dénivelé (+9.00 m), sa forme en aiguille accentue la perspective (la largeur varie de 29 m au niveau de la rue J. Holweg, à 5 m au débouché rue des Châtaigniers). Elle est équipée de mobilier, est éclairée, présente une pente douce continue, et est protégée contre les intrusions des véhicules motorisés. Des vues sont aménagées sur les principaux équipements de part et d’autre. Elle est revêtue d’un tapis en enrobé clair sur une largeur de 4 m, le reste de la surface est en sablé. Elle est conçue pour pouvoir y organiser des manifestations comme des brocantes, expositions de plein air dans un cadre très attrayant.
– La promenade cyclable sur la rive Sud est un espace destiné à créer tout au long de la rue qui la longe une vitrine attrayante ; pour cela, les plantations y sont nettement renforcées tout en ménageant les perspectives sur certains espaces internes du parc. Bien que réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la Communauté Urbaine cet espace doit pleinement s’intégrer au parc…
Ces deux axes sont reliés entre eux par trois passages transversaux dont le plus important relie l’espace culturel, la mairie et le gymnase. Des cheminements de moindre envergure permettent de démultiplier les itinéraires et les points de vue sur le parc.

Perspective du projet

Plantation de la haie

Vue du trampoline et de la grande tyrolienne
Les tours des résidences, immeubles posés dans des pelouses sans âmes, ont fait l’objet d’un retraitement de leurs façades et de leur pied. Ce travail a permis d’affecter des parcelles privatives à chaque tour sans oublier le retraitement des artères avoisinantes, boulevards A.France et J.F. Kennedy, généreusement plantées.

Aménagement du pied de tour

Aménagement du pied de tour

Aménagement du pied de tour

Travail sur les fermetures
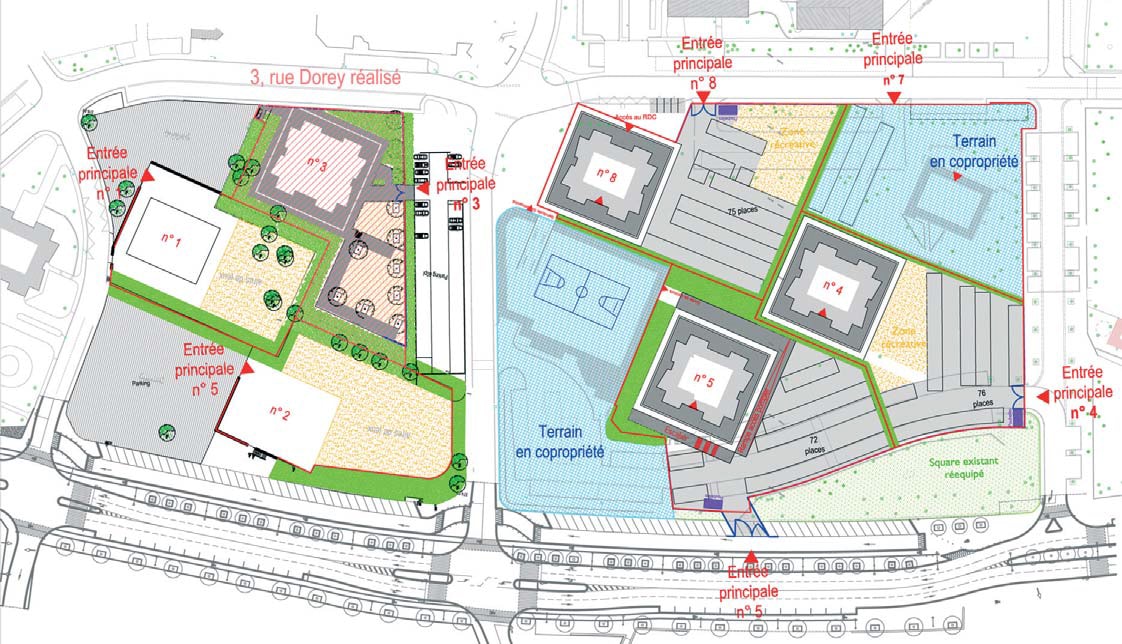
Plan masse du projet
Un quartier de paradoxes
Alors que, comme dans nombre de quartiers construits dans les années 60, une part belle est faite aux espaces libres et aux circulations, notamment automobiles ; que l’espace public s’impose jusqu’au pied des immeubles, voire sous les immeubles ; le quartier Schweitzer est, malgré tout, très hermétique.
Cela est flagrant dans les relations inter-quartiers, notamment en direction du centre-ville : il est impossible pour un automobiliste d’entrer le quartier par la rue Schweitzer, si ce n’est pas la rue privée de Lucca ; mais cette dernière a son entrée située si près du feu rouge qu’elle est confidentielle. La rue Saint-Niklaas, irriguant le quartier, se dérobe derrière l’immeuble privé de la rue de Lucca. Ainsi, l’entrée n’est pas visible depuis l’avenue de l’Europe. Seuls les riverains détiennent la clé et les échanges sont ainsi limités. Cela n’empêche pas (ou, en est-ce là la conséquence ?) que cette intersection est dangereuse et qu’il s’y produit des accidents.
De même, les équipements publics se dissimulent à l’ombre des immeubles. C’est le cas du club de jeunes comme de l’école maternelle «Les Pâquerettes».
Les démolitions programmées vont désenclaver ces équipements et ouvrir des portes sur le quartier.
Si les emprises des immeubles sont limitées, libérant le sol, ce dernier est souvent dédié à l’automobile, ou lorsqu’il est paysagé, il n’a pas toujours de valeurs d’usage, à l’exemple de l’îlot de l’école maternelle.
Des espaces existent avec quelques qualités, comme le jardin au pied des tours ou la place rouge, mais il manque une continuité dans les cheminements et les enchaînements de ces espaces pour qu’existe un véritable parcours paysager traversant le quartier.
Un nouveau souffle vert
Le projet de transformation urbaine propose de donner un nouveau souffle au quartier en lui permettant de respirer. Une grande onde verte s’engouffre dans le quartier pour mettre en relation les différentes alvéoles qui le composent.
Des cheminements piétons et cyclistes le parcourent, reliant ceux de la rue Schweitzer et de l’avenue de Paris.
L’objectif est de conférer au site une identité moins minérale mais aussi de favoriser le lien social en réunissant les lieux de convivialités aujourd’hui clairsemés.

Vue d’ensemble

Perspective du projet
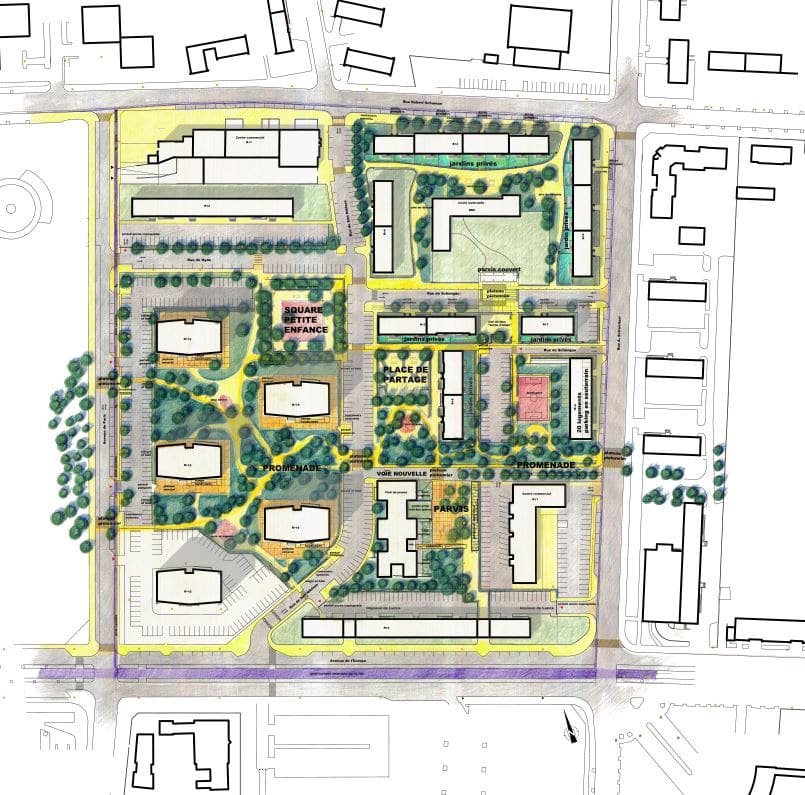
Plan de composition
Contexte du projet
La rive droite de la Meurthe est constituée d’une vaste plaine bordée au nord, par le plateau de Malzéville, la butte Sainte-Geneviève, le Pain de Sucre, au sud, par un ensemble de bois communaux, à l’est, par de vastes surfaces agricoles et en lien à l’ouest avec le centre de l’agglomération.
Sur ce territoire, différentes emprises de projet situées tout autour de l’aéroport de Nancy-Essey totalisent de l’ordre de 400 ha de foncier à aménager. La démarche de reconquête et de valorisation de ces sites est structurée en une démarche de réflexion urbaine d’ensemble intitulée ‘Plaine Rive Droite’.
Le périmètre de l’opération comprend les secteurs de Mechelle, Picot, Kleber, Flageul, qui regroupent les abords ouest de l’aéroport, le stade et le pôle sportif, les bords de Meurthe et les emprises de la Caserne Kléber en cours de libération. Le secteur aéroport comprend en outre le site de l’ancien 7°RHC déjà maîtrisé par la collectivité. Plus à l’est, en frange d’agglomération, le secteur Loisirs Est vise à définir et qualifier les limites urbaines par des équipements sportifs et touristiques et le développement de l’agriculture périurbaine.
Au sud de l’aéroport, un vaste écoquartier est en cours d’aménagement au lieu-dit de Bois La Dame sur le territoire.
Le schéma directeur d’aménagement vise à :
- Articuler les fonctions urbaines résidentielles et d’activité
- Assurer la continuité avec les tissus urbains existants
La spécificité de l’opération réside dans l’articulation de l’ensemble des fonctions urbaines autour d’une trame verte et bleue, multi-usages qui relie les grandes entités paysagères entre elles : la Meurthe à l’Ouest, la butte Ste Geneviève au Nord, des forêts au Sud. La trame verte caractérise et constitue la spécificité du projet ; c’est ce qui lui confère un statut d’exceptionnalité et créera toute la qualité des paysages urbains et naturels entendus dans leurs acceptations larges.
La plus grande emprise, de l’ordre de 170 ha, ‘Cœur de Plaine’, est située au centre de la plaine urbanisée et constitue la dernière grande réserve foncière de l’agglomération Nancéenne. Ces disponibilités foncières constituent «la dernière possibilité pour l’agglomération de constituer un pôle de développement économique fortement attractif et diversifié».

Plan masse de la trame verte

Perspective montrant la trame verte
Près du Rhin, la cité rhénane s’est développée sur l’Ill, en un lieu où cette grande rivière d’Alsace se ramifie et en collecte d’autres.
Le tramway, qui s’étire sur une longueur totale de 50 km franchit naturellement ici ou là ces cours d’eau, il nous a donc fallu aménager et restaurer des ponts existants, en créer d’autres.

Le tramway et le cours d’eau

Vue vers la rue du Faubourg National
Le projet consiste à réaliser une promenade ouverte à tous les usagers non-motorisés (piétons, cyclistes, rollers…), d’une longueur de 23 km, traversant 9 communes.
Les travaux concernent la réalisation du « ruban » de promenade, les franchissements de la rivière (création des passerelles nouvelles et réhabilitation des ouvrages d’art existants), la protection et la réfection des berges là où la promenade le nécessite, des aménagements spécifiques (seuils, épis, frayère, restauration du milieu), des accès à l’eau, des placettes d’accueil et des aménagements paysagers.
Les ouvrages d’art
Ils constituent une animation dans le parcours. 13 franchissements sont prévus :
• deux grandes passerelles métalliques, d’une portée supérieure à 30 mètres
• trois petites passerelles à âme pleine, avec un tablier en bois cintré, fixé sur deux poutres métalliques
• trois gués praticables hors crues
• une passerelle industrielle s’appuyant sur un barrage
• quatre ponts existants qui seront réhabilités
Coût des ouvrages d’art : environ 5 M d’euros H.T.

Passerelle sur le Rawé à Auboué

Passerelle à Joeuf

Passerelle à Homécourt
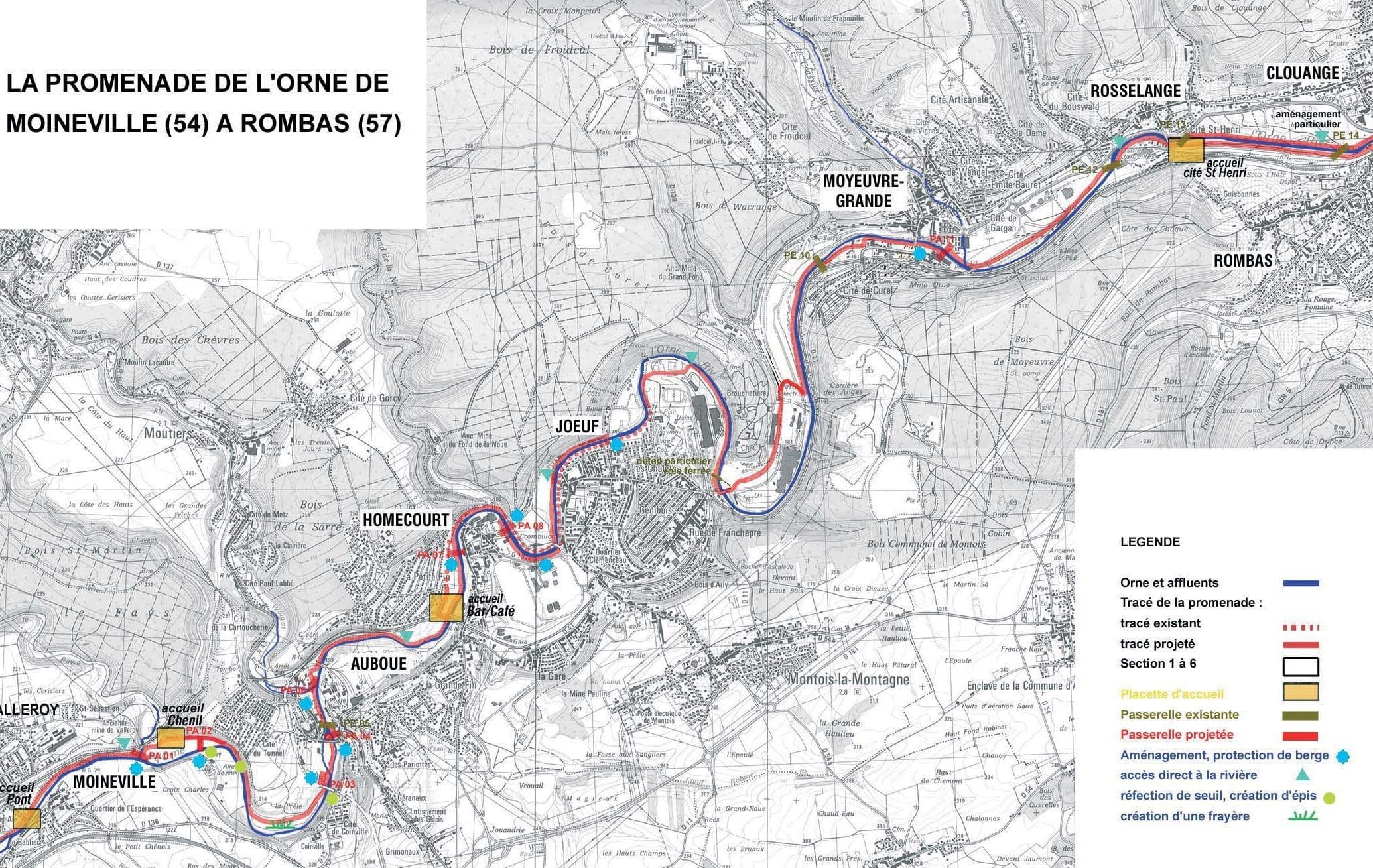
La promenade de l’Orne de Moineville (54) à Rombas (57)
La conception des T.G.V. français est toute imprégnée d’un objectif simple : GAGNER DU TEMPS.
De cet impératif respectable, est née une infrastructure « pure » dans son rapport aux territoires traversés, à la manière des canaux Freycinet du XIXe siècle. Ce principe fort s’exprime sans ambiguïté dans le profil en long : une ligne extrêmement tendue se confronte à la topographie, et de cette rencontre sortent des saignées, des remblais et parfois des viaducs…
Rarement, le T.G.V. français «touche-t-il terre» en collant au terrain naturel.
Le viaduc de la Savoureuse provient de cette confrontation, à un endroit où la ligne, même courbée, n’arrive plus à rattraper le sol.
Nous définissons notre travail de conception comme la transformation de cette rencontre impossible en un événement architectural puissant mais humain. Il importe très peu que cela soit une rivière, une autoroute, un canal ou une zone commerciale que l’on franchisse ; tout se joue dans le dessin des éléments qui font la liaison entre «la ligne des gens pressés» et un relief croisé là par hasard.
Treize quadripodes inversés
Le viaduc, ouvrage hors échelle, se compose de treize quadripodes distant les uns des autres de 67 mètres. Ce geste ne vise pas à surmarquer tel ou tel franchissement, c’est un travail d’architecture au sens noble du terme. Il a pour but unique de rendre légers et élégants des supports traditionnellement très massifs.
L’exceptionnel de notre proposition se pose donc bien dans les piles, éléments de liaison entre la ligne tendue du T.G.V. et le sol naturel.
À propos de l’intégration d’une promenade cyclable
Au-delà des aspects esthétiques évoqués, nous avons cherché à donner à l’ouvrage une dimension supplémentaire, en permettant à un piéton, un cycliste, un touriste ou un simple visiteur du dimanche, de s’approprier un peu «la ligne des gens pressés».
Rajouter un passage sous le tablier engendre un surcoût modeste mais change radicalement le sens du projet. La création d’un parcours original et unique signifie toute l’attention portée aux riverains.
Cette promenade cyclable pourrait se connecter à la véloroute internationale qui passe le long du canal. La présence d’un pôle universitaire et la réalité de ces deux villages séparés par les infrastructures Est/Ouest pourraient justifier, à côté d’autres arguments, cette proposition iconoclaste mais très «développement durable».

Détail de l’ouvrage

Insertion du viaduc dans le paysage
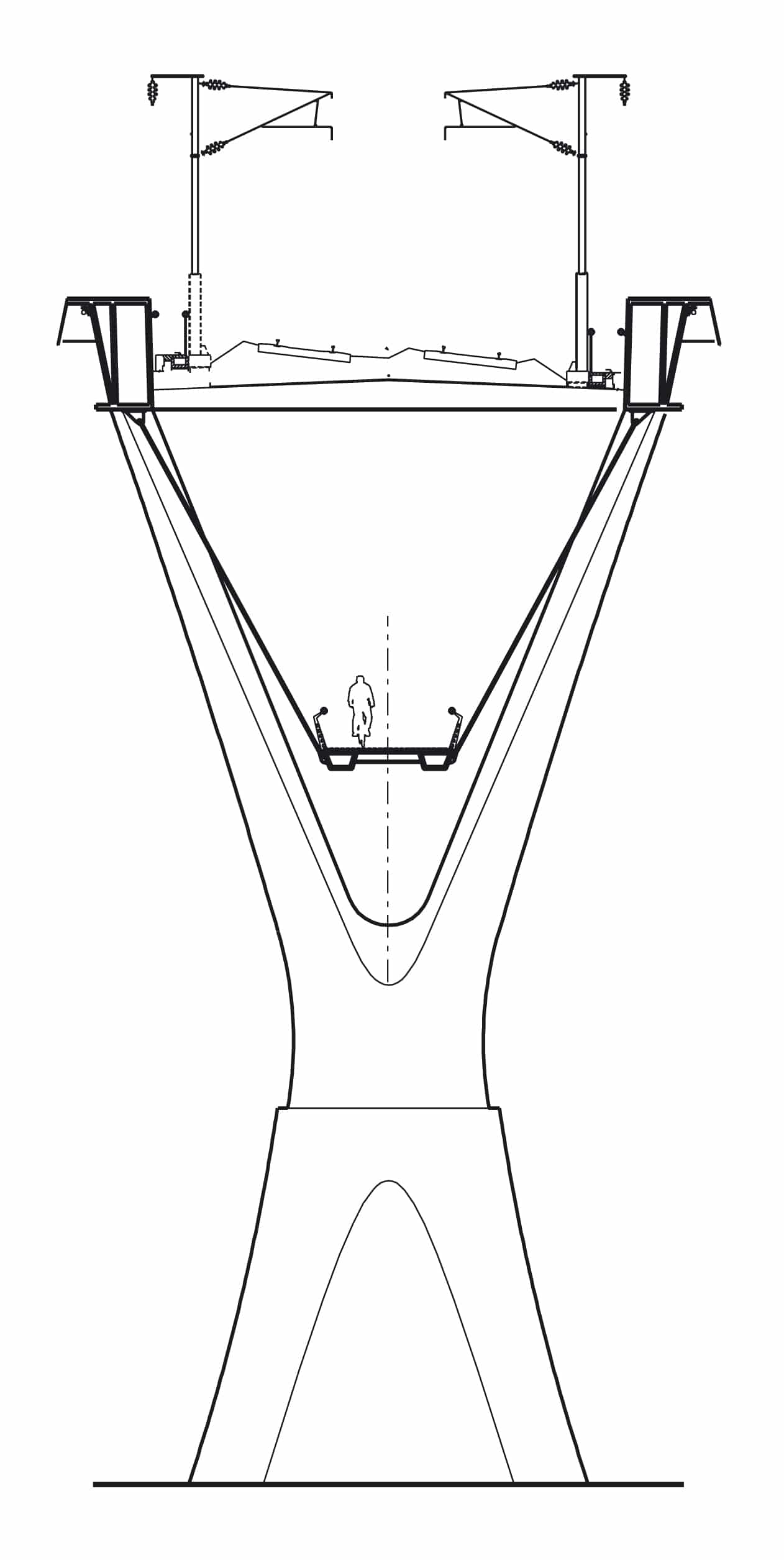
Intégration dune promenade cyclable

Le monument de la région
Strasbourg est une ville d’eau. Le tramway croise de nombreuses fois rivières et canaux dans des contextes très différents. L’architecture des ponts, souvent couplée à des stations, est un thème très présent dans le projet. La ligne est toujours sobre, en harmonie avec le site et dénuée de gestes gratuits.

Passage du tramway

Pont de l’Elsau : deux arcs en milieu sauvage
Strasbourg est une ville d’eau. Le tramway croise de nombreuses fois rivières et canaux dans des contextes très différents. L’architecture des ponts, souvent couplée à des stations, est un thème très présent dans le projet. La ligne est toujours sobre, en harmonie avec le site et dénuée de gestes gratuits.
Ce franchissement du Canal du Rhône au Rhin a été dessiné pour garder « la mesure du canal » (restriction de la passe navigable) et créer en banlieue un ouvrage compact ; à cette fin, les rampes et les façades sont revêtues de briques.

Franchissement du canal par le tramway, une chaussée et une piste cyclable

Franchissement du Canal du Rhône au Rhin
Le pôle d’échange consiste à transformer un espace « fonctionnel » en un espace urbain mettant en valeur le bâtiment voyageur et en trouvant un nouvel usage au hall de la Sernam tout en créant une gare routière bus urbains et interurbains.
Le nouvel espace urbain est traité de manière à retrouver la sensation du Jura que le voyageur a pu admirer pendant son voyage en train, en particulier les chênes et hêtres centenaires qui font la gloire de ce massif…

Réaménagement des abords de la gare SNCF
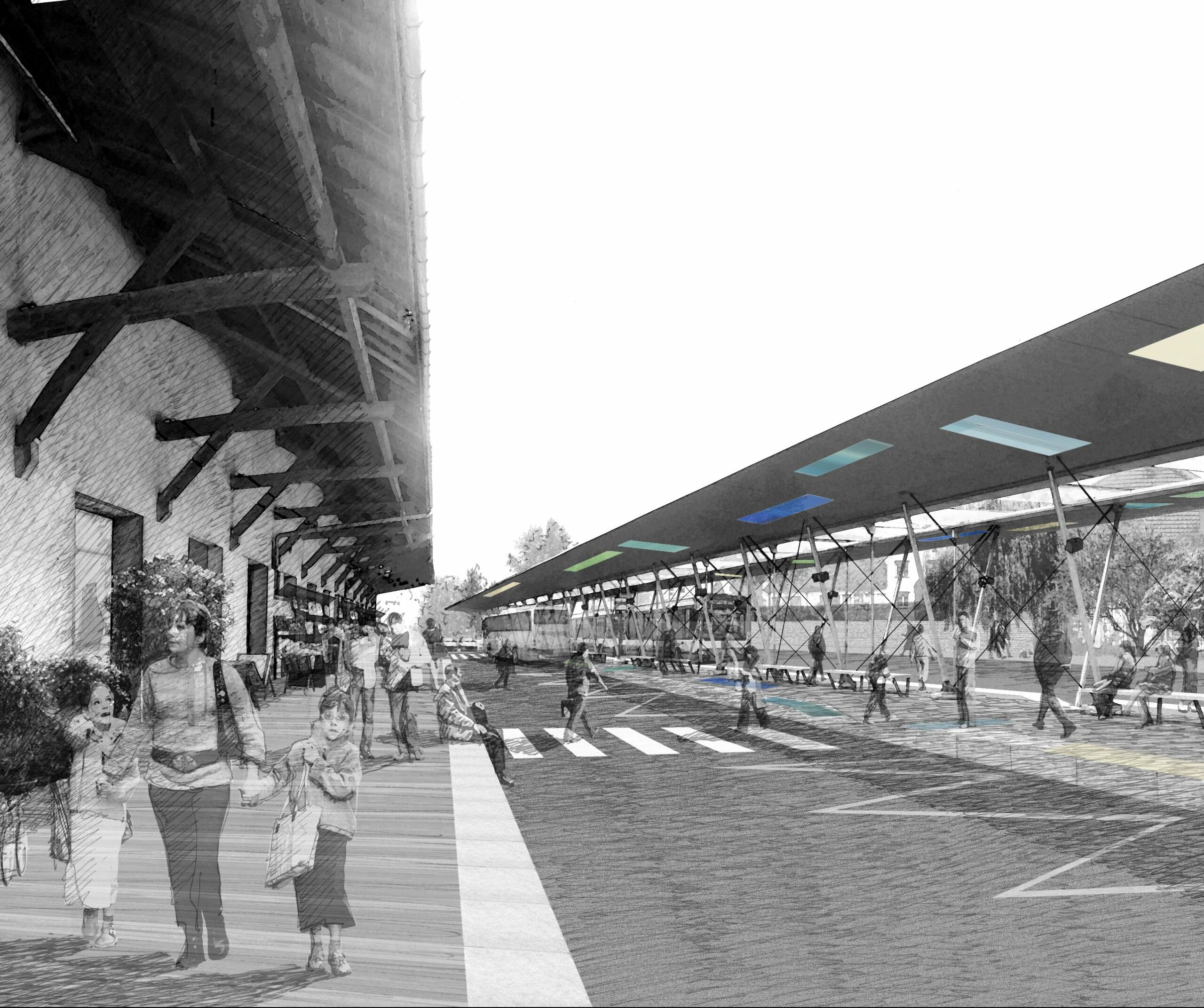
Gare routière et réaffectation du bâtiment Sernam

Plan masse du projet
Transformer un boulevard très banal et très « roulant » en pôle d’échange Bus-Train est le thème de ce projet (en cours de réalisation avec une autre équipe).
Un quai supplémentaire, parallèle à ceux de la gare SNCF, permet grâce à une nouvelle passerelle de rejoindre directement les quais de la gare.
Une importante plantation de palmiers permet de donner au projet un fort caractère méditerranéen.
La gare et ses abords constituent un espace stratégique. À proximité du centre-ville, ce lieu s’inscrit dans un faisceau de projets urbains : espace Guynemer (projet Atelier Ruelle Paysage, logements), espace Marine (projet Reichen et Robert architectes-urbanistes, centre commercial).
Nous appuyant sur le foncier maîtrisé et le foncier mutable et dans une pleine logique de fonctionnement des déplacements, nous restructurons fortement le lieu : création d’une deuxième gare à l’extrémité des voies ferrées, articulation directe de la gare historique à l’Espace Guynemer puis au centre-ville, requalification d’un îlot délaissé au bord d’un rond-point (qui devient parc de stationnement, les surfaces naguère vouées au stationnement de surface se convertissent ainsi en espace vert) et au bord du plan d’eau, articulation avec l’Espace Marine.
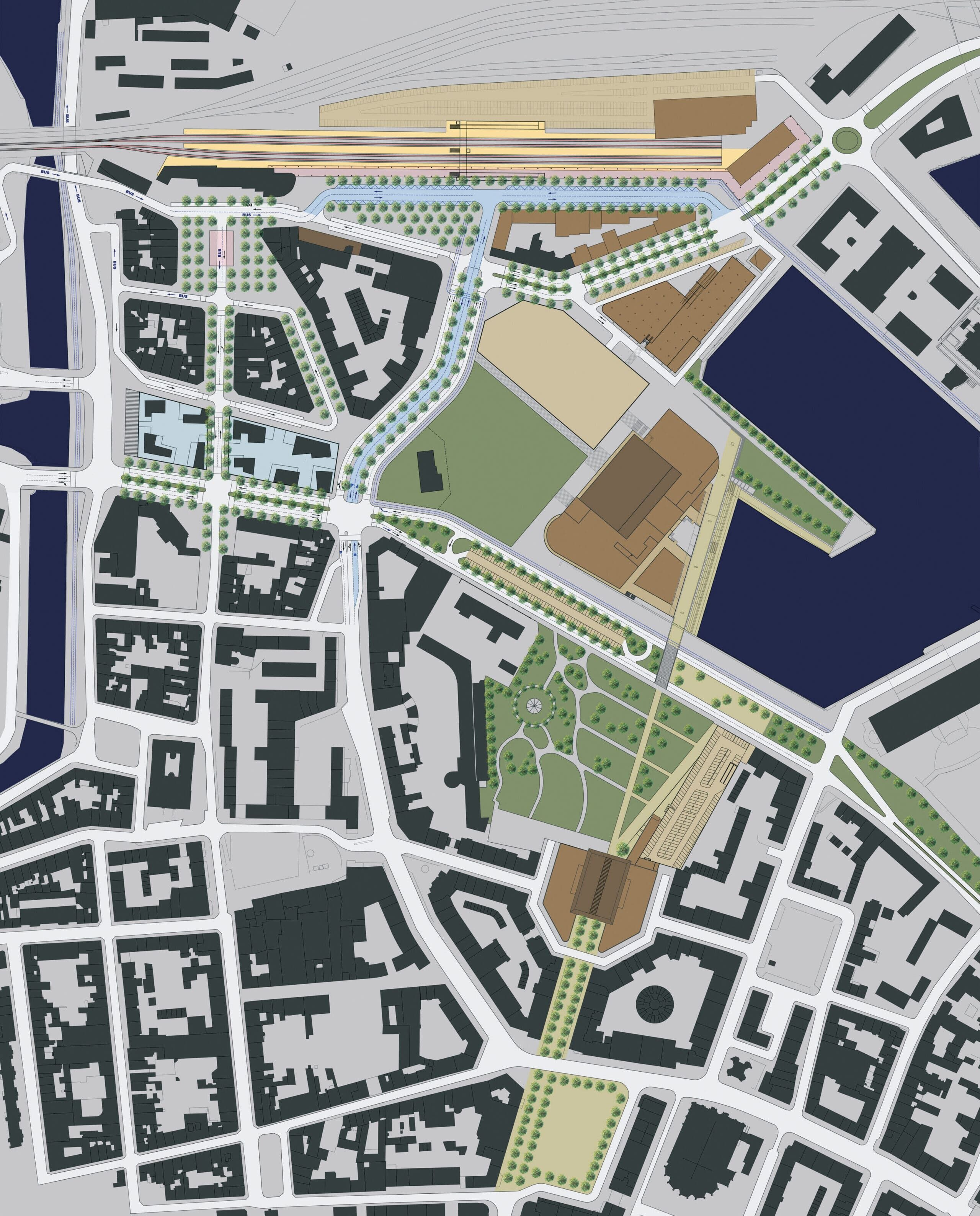
Articuler aux autres projets urbains
À titre expérimental, la gare de Saverne sera ville étape du Train à Grande Vitesse Paris-Strasbourg. Les déplacements entre ce bassin de vie et Strasbourg sont en pleine expansion.
Conscientes des limites, contraintes et nuisances du trafic automobile, les collectivités cherchent à revaloriser les transports collectifs.
Dans ce contexte, la ville de Saverne requalifie la place de la gare et ses abords, en créant une gare routière, et un espace de stationnement véhicules légers et… bicyclettes.

Parvis et gare routière sur une dalle de parking

La place de la gare un jour de marché

Simplicité et compacité
Haut lieu de recherches, d’activités et d’éducation installé dans un environnement méditerranéen boisé et vallonné remarquable, Sophia Antipolis est une ville introuvable.
Ce sentiment est lié à un système d’accessibilité sans repères, fortement congestionné et entièrement voué à l’automobile, qui tend à isoler la technopôle et devient un obstacle à la vie sociale. La spécificité d’un site exceptionnel disparaît et l’avenir de la technopôle paraît fragilisé.
Pérenniser l’avenir de la cité scientifique
Seul un réseau performant de déplacements collectifs et doux permettra d’inscrire Sophia Antipolis dans son époque. L’équipe Reichen/Peter a donc imaginé un tracé de BHNS pour créer de nouvelles conditions d’accessibilité à la métropole et permettre le développement de la cité dans 4 pôles de vie complémentaires mis en réseau : Trois Moulins, le Fugueiret , la Cité du Savoir et les Clausonnes.
Inverser le regard : de la protection à la valorisation d’un cadre naturel d’exception
Que ce soit au titre des Espaces Boisés Classés ou de la protection contre les feux de forêt, la quasi-totalité des terrains autour de la boucle du BHNS est concernée par des mesures de protection… qui tendent à les figer dans un état médiocre.
L’ambition du projet urbain appellé à se développer autour du transport en commun nécessite d’inverser le regard : ces espaces de nature se situeront désormais au cœur des 4 pôles de vie auxquels ils devront donner le change.

Fabriquer des lieux (autour de l’usine Peugeot)

Station multimodale

Station multimodale
La nature, et particulièrement LA FORÊT est LE Monument du Gabon. Un Monument légendaire véhiculant histoires, craintes, fantasmes, qu’une population majoritairement urbaine porte dans son inconscient et éloigne de plus en plus des réalités et des richesses de son territoire.
Pour redonner ENVIE de parcourir la forêt, de dissiper un certain nombre de fausses vérités, et d’en découvrir toutes ses richesses, notre proposition de sentier pédagogique s’est donné trois objectifs qui constituent le fil rouge du projet :
- Créer un parcours «Grand Spectacle» c’est-à-dire un cheminement qui propose au visiteur une succession de tableaux relançant sans cesse son intérêt.
- Construire un parcours en réutilisant exclusivement des matériaux issus de la région, pour en garantir son authenticité.
- Associer pédagogie et traitement ludique pour accrocher le visiteur, en particulier le jeune publique, sans faire du projet un parc d’attraction.
Le projet du sentier, associé à la promenade dans la canopée, et avec laquelle nous avons cherché toutes les complémentarités possibles, créera un événement capable de générer un nouvel intérêt collectif, meilleur rempart contre les destructions sauvages.
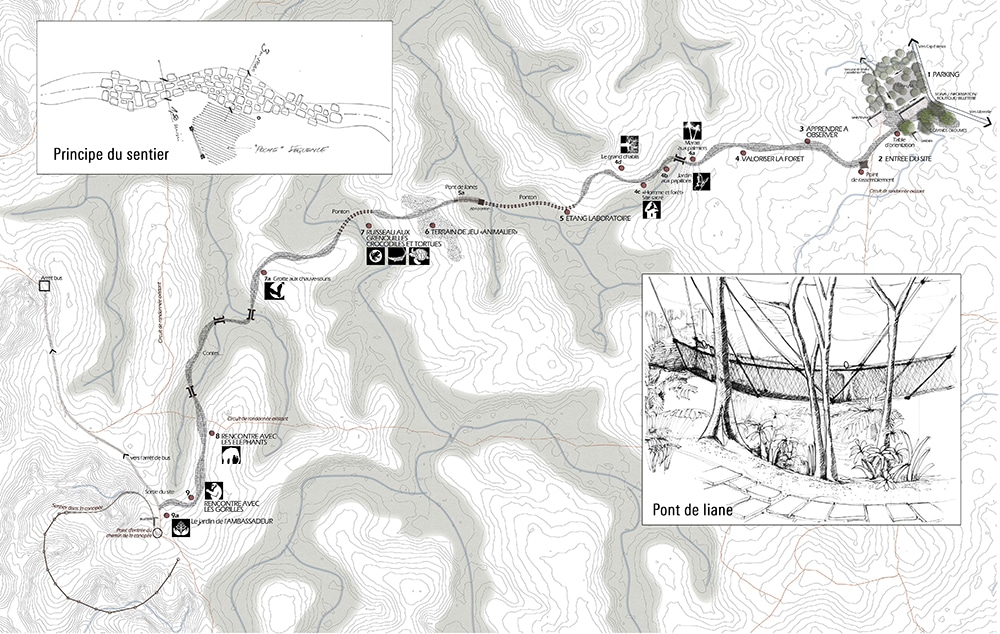
Circuit à travers le parc

Photomontage autour de l’aire de jeux

Ponton-belvédère

Sentier et éducation ludique
Les objectifs de la charte
Ce qu’on aime en venant au centre-ville de Sélestat, c’est son authenticité. Contrairement à beaucoup de centres villes concurrents régionaux, il n’est ni suraménagé comme ceux du piémont des Vosges, ni déstructuré comme celui de Haguenau. Il fait 25 hectares, est dense, labyrinthique et ponctué de merveilles patrimoniales. C’est un paradis pour le promeneur.
Ce qu’on aime moins, c’est son inconfort, le plateau piétonnier est minuscule et en-dehors du secteur protégé, le piéton gêne, est gêné ; il ne se sent en sécurité nulle part. On sait que la qualité du cheminement, son confort, son ambiance, ses surprises sont un critère déterminant pour décider d’aller s’y promener et donc y consommer.
Fort de ces deux constats, la municipalité a décidé, après avoir réaménagé une partie importante du plateau piétonnier dans le mandat qui se termine, de se doter d’un plan d’actions pour la mandature suivante. Elle a engagé simultanément trois réflexions sur la circulation (CETE de l’Est), le stationnement (SARECO) et l’aménagement (Atelier Alfred Peter).
Ce travail sur l’aménagement des espaces publics est accompgné d’une véritable stratégie commerciale. Le débat sur l’attractivité ne peut pas se réduire à une question de stationnement. Au contraire, cette forte revendication (qui n’est pas spécifique à Sélestat) reflète plutôt le manque de visibilité sur l’avenir du commerce. Que manque-t-il ? Quelles sont les locomotives ? Quelle stratégie en matière de localisation des activités ? La réponse à ces questions est essentielle et sera menée parallèlement au projet d’aménagement.
Cette étude du centre-ville s’est concrétisée pour l’agence avec la maîtrise d’œuvre de l’espace public du centre-ville depuis l’entrée nord (boulevard Charlemagne, square…) jusqu’à la rue de la grande boucherie en passant par les places Gambetta et Kubler devant la Bibliothèque Humaniste qui fait elle aussi peau neuve.
Nous avons mis en application ce que nous proposions dans l’étude amont : dissuader le trafic de transit, privilégier les modes doux, augmenter et redéfinir l’offre de stationnement, mettre en scène les bâtiments publics et planter généreusement. A ce propos, le jardin de l’ESPE entrera dans le domaine public et deviendra le plus grand parc urbain de la ville avec 1 hectare de superficie.
La zone de rencontre organise la cohabitation de l’ensemble des modes de déplacement.
Au sein de ces zones :
- La priorité est donnée aux piétons sur les autres modes
- La vitesse des véhicules motorisés est limitée à 20 km/h
- Les espaces dédiés à la voiture s’effacent pour permettre de nouvelles formes d’appropriation de l’espace public par les habitants.

Esquisse de la zone de rencontre

Plan de programmation des animations
Schweighouse-Sur-Moder a une image brouillée, difficile à caractériser. Son monument principal est la forêt, immense, dans laquelle la commune s’est nichée. Une situation exceptionnelle pourtant peu perceptible dans son traitement.
Au lieu de s’être développée en « Waldstatt », Schweighouse-Sur-Moder est devenue un village de « banlieue » très hétérogène. Pour modifier cette image, la municipalité a décidé de remodeler prioritairement son centre pour augmenter son attractivité et le bien-être des habitants.
L’étude confiée au groupement Peter – Roland Ribi & Associés a pour objectif de définir des actions aux coûts en rapport avec les moyens de la commune pour arriver en quelques années à modifier considérablement l’identité de son centre. Le groupement constitué d’un paysagiste/urbaniste et d’un spécialiste des mobilités a mis en évidence les points forts et faibles de l’agglomération.
Une douzaine d’actions ont été dessinées, chiffrées et programmées de manière logique dans le temps. Ces dernières sont ainsi en cohérence d’un programme politique pouvant se résumer en quatre points :
- AMÉLIORER l’utilisation du domaine public
- ASSURER une qualité de service et un dynamisme associatif
- RESPECTER la nature et le patrimoine
- RENFORCER la solidarité et la citoyenneté.
Niché au cœur du vignoblebourguignon, le village de Meursault est soumis à une fréquentation touristique extrêmement importante notamment l’été. La quasi totalité des espaces publics de la commune est consacrée à la voiture.
Après avoir réenvisagé les sens de circulation automobile dans le village, après avoir réorganisé l’offre de stationnement, le projet a consisté en une libération de l’espace public et notamment des places au profit des piétons.

Place de la République

Place de la mairie

Fontaine déplacée devant la mairie

Parvis de l’église

Plan de réaménagement du cœur de village
La reconversion de cette route a visé à changer l’image très négative qu’elle donnait de la commune et à générer d’autres comportements, en particulier en nature de vitesse de circulation. Changer le paysage sans trop bouleverser le fonctionnement initial tel pourrait être la devise résumant ce projet.
Notre intervention traite un segment d’une longue ligne droite de plusieurs kilomètres. Il permet dans un premier temps d’apercevoir de loin le centre-ville. La perspective « à perte de vue » vers Basse-Ham est rompue par une inflexion de la chaussée à hauteur du centre médico-social.
L’aménagement a consisté en un reprofilage de la chaussée, asymétrique et à la réduction drastique de sa bande de roulement (de 11 à 6m de large) cédant ainsi une large place aux modes doux (trottoirs cyclable), tout en maintenant du stationnement longitudinal bilatéral de courte durée.
La singularité de cet axe est sa plantation généreuse. 87 sujets de hauts jets, pour plus de 40 essences et sur chaque grille d’arbre est apposée une plaque émaillée renseignant parfaitement sur les végétaux, un véritable arboretum.

Réalisation d’une belle avenue plantée
La révélation d’un site riche en histoire
L’axe romain
Du moyen pont au pont des Morts, les citadins retrouvent un axe requalifié avec plusieurs ambiances. Il est composé d’une rue partagée, aménagée de manière flexible et saisonnière, d’un pôle d’échanges spacieux et très « nature », et enfin de la Moselle avec un pont-balcon confortable ouvrant sur ce paysage merveilleux.
L’axe moyenâgeux
Le temple protestant, la rue du pont Saint-Marcel, la liaison avec la cathédrale Saint-Étienne et la Moselle constituent un deuxième itinéraire Nord/Sud que nous révélons en créant une passerelle panoramique ouverte sur le paysage des collines de Saint-Quentin.
L’axe « Vauban »
Il est constitué d’un ensemble unique mettant face à face deux églises (Saint-Simon/Saint-Jude et Saint-Vincent) et du travail de Vauban qui y perfectionna son premier système de canonnières, dans l’axe de la place de France, en réutilisant partiellement les fortifications du XIVe siècle.
Le plaisir de la vie collective dans un espace à forte coloration « cultures »
La culture est pour nous tout ce qui fait lien. Nous souhaitons ouvrir le fort à des pratiques urbaines calmes en transformant les cellules pour accueillir des activités commerciales liées à la culture : bouquinistes, ateliers d’artiste, antiquaires, etc.
Ces cellules ouvriront sur une esplanade, espace polyvalent tendu entre le point haut du fort à l’Ouest du pôle d’échanges et la Flèche de l’Ancien Temple de Garnison à l’Est. Des sculptures monumentales réalisées par des artistes messins connus (Goutin, Copeaux…) symboliseront la vocation du site et sa complémentarité avec Pompidou.

Un pôle d’échange dans une nature consolidée


Plan masse du projet
Le centre ville d’Audincourt niché au bord du Doubs était extrêmement pénalisé par un trafic de transit induisant de fortes nuisances.
La construction d’un nouveau pont sur le Doubs a permis de limiter le transit et de réaménager les espaces publics principaux, en particulier la place du Temple, la place de la Mairie, la grand’rue et l’avenue Aristide Briand.
L’arrière de la place du Temple qui ouvre sur le Doubs sera réalisée en différé après le transfert de la gare routière.
Cette place créée de toute pièce sur une ancienne friche industrielle brassicole a nécessité 3 types d’interventions :
- La reconstitution des bords avec une succession d’immeubles de logements R+4
- La création d’une capacité de stationnement significative derrière la maison de maître avec une forte plantation pour en diminuer l’impact
- La création d’une esplanade polyvalente pour le marché bi-hebdomadaire. Une fontaine réalisée avec des blocs de granit anime l’extrémité de cette esplanade.
Cette place, d’une grande simplicité de traitements, illustre bien l’approche de l’atelier à partir d’une mise en situation des usages.

Place de la Brasserie : création d’une place centrale sur une friche industrielle

État antérieur : une friche industrielle

Détail de la fontaine et ses cépées
L’aménagement du Neja Waj a réveillé la belle endormie qu’était Sélestat jusqu’alors. Pour augmenter l’attractivité du centre-ville, avoir une vie urbaine plus riche et apporter de la convivialité, il a fallu opérer un vrai lifting de cette voie.
- Rééquilibrer les usages pour sortir du tout automobile, par la réduction de la chaussée à 6m en maintenant du stationnement bilatéral réglementé, la création d’une piste cyclable bidirectionnelle, élargissement des trottoirs et redéfinition du square Ehm en un véritable lieu dédié aux piétons, aux cyclistes et aux activités festives.
- Augmenter la sécurité et modérer la vitesse en mettant dès l’entrée l’axe en zone 30 à l’aide de dispositifs physiques et par le dévoiement de l’axe.
- Révéler le Beckele et le rendre accessible grâce à une ouverture dans son mur et la création d’une pente très douce ombragée par 9 arbres.
- Libérer la partie médiane du stationnement sauvage et planter généreusement jusqu’au pont de Marckolsheim, où est installée – avec la participation de la fondation Martel Catala – une fontaine coiffée de Jeanne d’Arc.

Structure festive du Square Ehm

Place Vanolles
La plateforme s’insère dans le cours, sur l’emprise de l’actuelle petite poche de stationnement.
Le trottoir arboré au Nord est même quelque peu élargi vers le Sud.
L’accès à la copropriété rue du Vieux Moulin est maintenu, le sens entrant se fait sur la voie de droite du tramway et le sens sortant se fait hors plateforme tramway au Sud de celle-ci.
Cette configuration permet de ne pas impacter les aménagements du cours de l’Illiade (bordures, revêtements, plantations). Ce n’est que dans son virage vers le Sud le long du Centr’Ill que la plateforme impactera un ou deux platanes du mail.

L’arrivée du tramway en 2017 prolonge la figure du cours vers l’Ouest

D’anciennes usines deviennent les éléments structurants d’un nouveau quartier
À la croisée du cours de l’Illiade et de la route de Lyon, le Forum de l’Ill est la vitrine du projet global de réaménagement du centre-ville. L’ensemble prend forme par couches successives, tel un puzzle dont on assemble les pièces.
Au cœur de ce projet, une place polyvalente qui change au gré des saisons et des événements. Elle peut aussi bien accueillir un marché, qu’un festival, que des installations d’Illkirch-place en été. Nous allons en 2018 y rajouter un kiosque/restaurant. C’est un lieu vivant – mouvant, dédié à toutes les expressions de la vie collective de la commune.

Les jeux d’eau dans la nuit

Des bords traités avec force, un espace central libéré et polymorphe

Cours de l’Illiade : d’anciennes usines deviennent les éléments structurants d’un nouveau quartier

Cours de l’Illiade : d’anciennes usines deviennent les éléments structurants d’un nouveau quartier
Une place publique, surtout en centre ville, doit être avant tout un lieu polyvalent, animé sur les rives, et quand elle est vide mettre en scène le bâti qui la définie. La place originelle n’est rien de tout cela, et on peut penser que rares sont les personnes qui regrettent la fontaine en forme de pièce montée, les arbres plus ou moins décoratifs et les pavés bétons. Nous avons tout d’abord hiérarchisé les questions à traiter :
- la première est la pente en travers de la place qui donne un aspect fuyant au sol et rend les usages difficiles.
- la seconde est le rapport d’échelle entre la « massivité » du bâtiment de la Mairie et les rives. Ce bâtiment a besoin d’un espace dédié pour le finir, le « socler » et lui donner son rôle de représentation sans qu’on puisse privilégier un côté plus particulièrement
- la troisième touche à la qualité d’accueil du système formé par la place et la rue Sainte-Anne. L’effet solennel de la mise en scène du bâtiment de la mairie doit être contre-balancé par un sentiment d’intimité de la rue Sainte-Anne, en profitant des libertés que donne sa largeur.
La combinaison de ces trois impératifs nous a permis de dégager un parti d’aménagement composé de deux situations :
Un plateau dégagé sans obstacle autour de la Mairie permettant à la fois de redonner de la solennité au bâtiment et pouvoir l’utiliser rationnellement pour de multiples manifestations festives et commerciales. Ce parvis est réalisé avec de grandes dalles en granit sciées flammées (à l’image de celles utilisées dans les rues Vannolles et de la Gare). Son bord « Sud » est délimité par trois marches permettant de rattraper le niveau du sol actuel. Les places de parkings actuelles, extrêmement pénalisantes pour la cohérence de la place sont recréées dans la rue de la Halle et traitées sous forme d’arrêt de courte durée…
Un espace plus « intimiste » dédié au confort d’usage dans le quotidien. La principale modification que nous avons introduit est la plantation de la rue Saint-Anne par une rangée d’arbres presque centrale afin de changer ses proportions. Elle est traitée, ainsi que l’espace en contre-bas du parvis et la rue Xavier Marmier avec des pavés de pierres naturelles offrant une touche de couleur contrastant avec celle du parvis mais restant, par son calepinage et son esprit, compatible avec le traitement dédié aux piétons dans la charte.
Nous avons représenté le projet de la place avec le dispositif prévu dans la charte sur la rue de la République et la rue des Halles pour montrer la cohérence du projet avec le réaménagement de ces deux rues. Bien entendu notre proposition peut être phasée pour vivre pendant un certain temps avec les rues actuelles. Mais le projet aurait une toute autre ampleur si l’amorce de ces deux rives étaient inclusent !
L’ensemble du projet est pensé comme une continuité des options prises dans la charte d’aménagement avec une touche de modernité, un surcroit d’intensité, mais en restant fidèle au trois maîtres mots :
SIMPLICITÉ – AUTHENTICITÉ – SOBRIÉTÉ !

Place d’Arçon
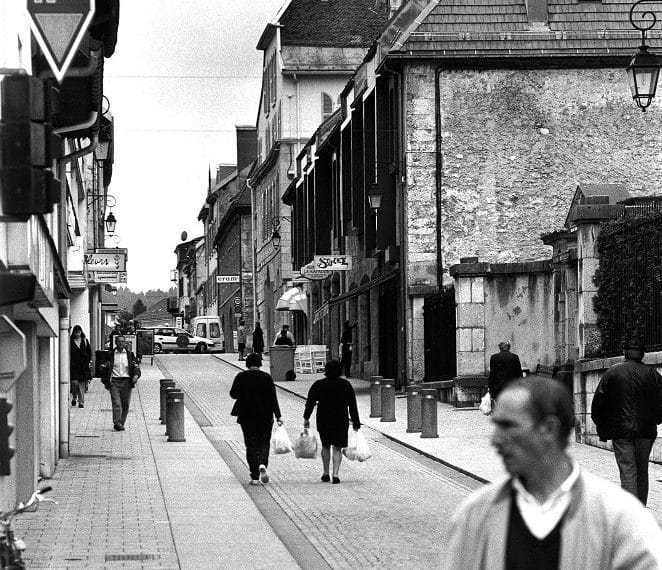
Rue de Vannolles

Plan de la Place d’Arçon et de la rue Sainte-Anne
Un constat alarmant
L’état de l’environnement haïtien est préoccupant depuis de nombreuses années mais n’a eu de cesse de se dégrader, entraîné dans une spirale de vulnérabilité. Le couvert forestier représente moins de 2% et continue à disparaître. Extraction du bois et cultures sarclées dans les fortes pentes accélèrent l’érosion et fragilisent les sols et plus globalement l’ensemble des bassins versants du haut des mornes jusqu’en aval (glissements de terrain, inondations, fragilisation des infrastructures).
Un fort potentiel de sites remarquables
L’île d’Hispaniola constitue en effet un « hotspot » de la biodiversité mondiale. Le contexte géographique insulaire, le climat tropical et le relief offrent une grande richesse d’écosystèmes et de milieux, tant marins, côtiers que terrestres. À ces sites naturels s’ajoute le patrimoine témoin de l’histoire d’Haïti.
Un système d’aires protégées inefficace
Depuis 1937, 10 sites ont été déclarés Parcs Nationaux (12 854ha soit 0,5% du territoire) et 15 aires protégées. Mais la protection effective de ces sites est restée limitée. Les atteintes continuent à être nombreuses : disparition progressive des forêts, pillage des sites historiques…
Des acteurs mobilisés pour le patrimoine et l’environnement d’Haïti
Face à cet échec, nombre d’acteurs se mobilisent pour agir. Le Ministère de l’Environnement, le PNUD et le GEF travaillent notamment à la mise au point d’un système national d’aires protégées financièrement soutenable. D’autres partenaires (notamment l’ISPAN, la BID, l’AECID, les Fondations Seguin et Helvétas…) interviennent sur des aires spécifiques (Parc National Historique, Pic Macaya, Parc de la Visite…).
Des programmes binationaux Haïti-République Dominicaine et trinationaux Haïti-Cuba-République Dominicaine, en particulier le Programme CBC (Corridor Biologique Caraïbes), sont en cours d’élaboration pour aider à la protection et la conservation des aires remarquables de la région. Ces programmes sont une opportunité pour mettre en place un nouvel élan à l’échelle des enjeux. Il s’agit, tout en s’appuyant sur les initiatives des différents partenaires et l’énergie de chacun, d’étendre progressivement le périmètre des aires effectivement protégées et de participer à la régénération écologique d’Haïti.
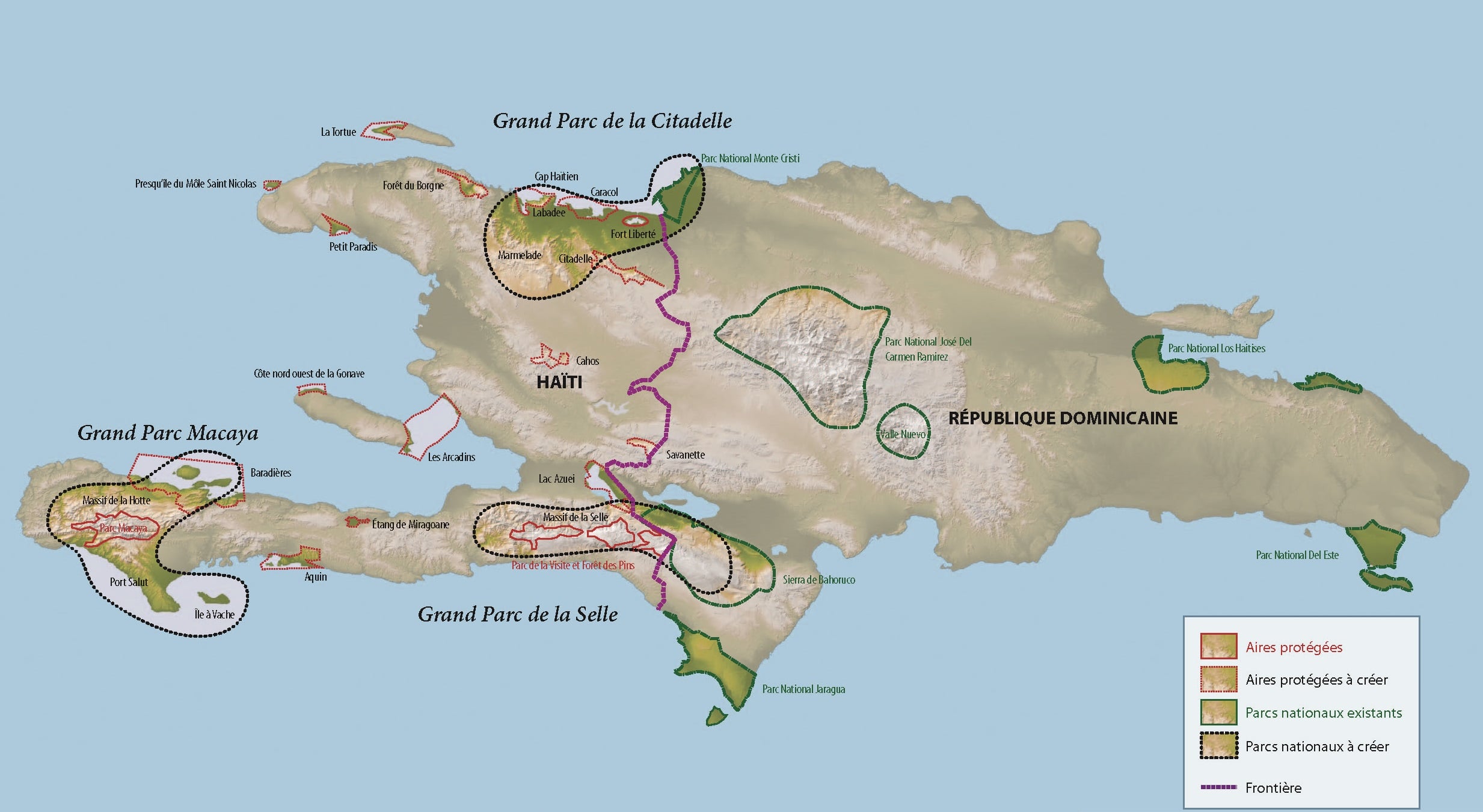
Carte des programmes binationaux de protection des aires remarquables

Massif de la Hotte, dans le Grand Parc Macaya

Vue sur le Morne du Haut du Cap du pied de la Citadelle Henry
Cette île, bien qu’artificielle, façonnée par la main de l’Homme est née du Rhin. Le Rhin est un mythe car le Rhin réunit tout écrivait Victor Hugo. C’est un monument du romantisme chanté par Heine et Apollinaire.
Cet ouvrage est le berceau d’une île n’évoquant qu’une extrémité mi-minérale, mi-civilisée, soit un entre-deux urbain et paysager figé, déstructuré et privé de poésie, mais dont la charge affective, symbolique et temporelle se révèle immense. Ne bénéficiant d’aucune orientation réelle, ce territoire au potentiel largement inexploité, mi-friches, mi-bâti, est pourtant capable de conditionner de manière radicale le devenir des villes alentours tout en les inscrivant dans un paysage sensible.

Perspective du projet
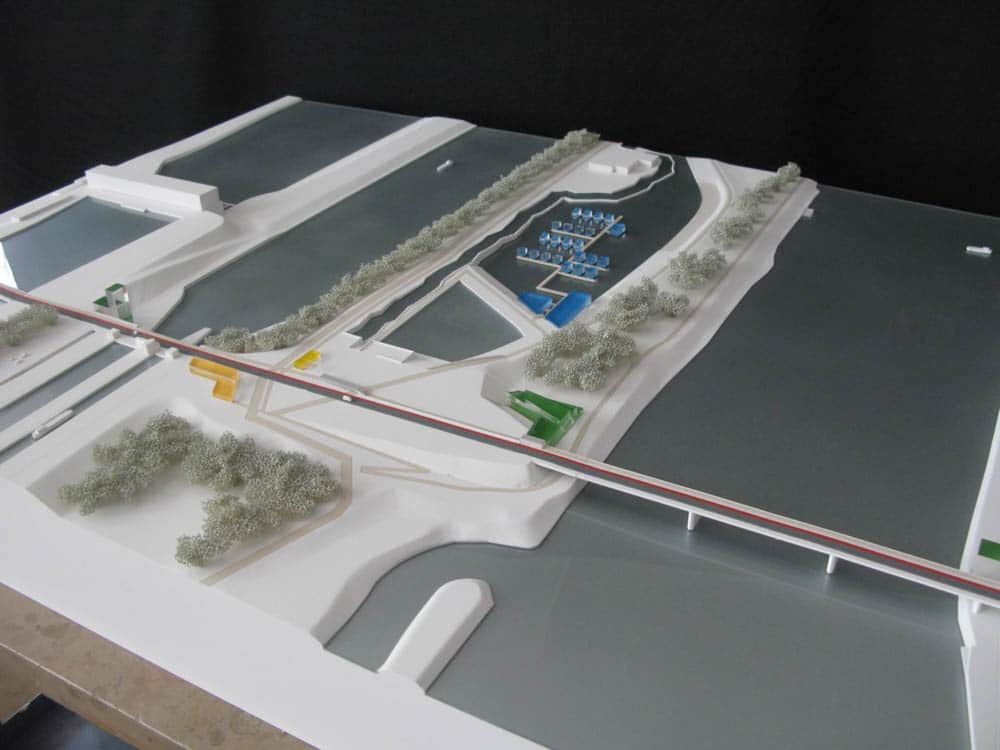
Maquette

Panneau de présentation
L’objectif de ce projet vertueux est de concilier tourisme de masse et renaturation du site. D’autres expériences similaires ont démontré que si la démarche est cohérente, menée à bout dans une logique claire et compréhensible avec un dispositif bien adapté au site, les résistances finissent par céder et le succès populaire est au rendez-vous. Le processus imaginé : suppression de la RD59, desserte du site par 3 poches de stationnement, réhabilitation des cheminements, de la dune blanche nous semble perfectible sur des points essentiels. La desserte du site par la création de deux nouvelles poches venant concentrer les infrastructures d’accueil sur les deux principaux points d’accès et la création de la troisième (Pôle Nord) nécessite des travaux routiers coûteux (bretelles d’accès) sans bénéfice direct pour le site…
Plus d’accueil
Depuis le rond-point du Petit travers jusqu’à celui du Grand Travers est aménagé avec les déblais de la RD59, une contrallée parallèle à la RD66. Celle-ci, installée sur une zone stérile ou de faible valeur écologique, permet de traiter la rive Sud de la RD66 (hydrauliques, nuisances sonores…) en ménageant une transition entre cette infrastructure très brutale et ce site si sensible. Le stationnement est disposé tout du long. La voiture reste donc avec la voiture, elle restaure son propre paysage. Nous pensons que ce dispositif répond à une des principales critiques du projet car il garde une très grande flexibilité d’accès à tous les secteurs de la plage ; une belle promenade cyclable double cette contre-allée de manière plus sinusoïdale et crée un nouveau sas avec le paysage dunaire.
Les moyens financiers sont donc concentrés sur un dispositif très paysager puissant visant à « digérer » au Sud la présence d’une autoroute dans le site. Les distances à faire à pied entre le stationnement et la plage varient de 100 à 250m. Ces cheminements dans le sens Nord/Sud font l’objet d’un aménagement soigné et constituent avec les deux chemins principaux Est/Ouest un maillage dense pour les piétons. Toutes les zones hors ce maillage sont protégées par des ganivelles et ne sont pas accessibles.
Des sanitaires et douches sont aménagés côté parking dans un passage sur deux vers la plage. Ce sont des équipements pérennes avec électricité et eau courante. Ils doivent permettre d’offrir un accueil décent et d’éviter que les espaces publics servent de sanitaire sauvage !
Plus d’écologie
La patrimoine naturel du site est important, comme le montre l’inscription du lieu dans le réseau Natura 2000 et dans l’inventaire ZNIEFF.
En tant que tel, mais aussi pour le public, dès lors qu’il n’est pas très sensible à la fréquentation mais à la dégradation des habitats par les plantes envahissantes et une gestion inadaptée ou inexistante.
Un aménagement réaliste ouvert sur une vision à long terme
Un projet si vertueux soit-il n’est pas une fin en soi. Il doit permettre des évolutions futures. Il est une étape importante vers une autre ère qui s’ouvre et sera caractérisée par un nouveau rapport infrastructure/nature, notre concept d’inversion du regard…

Photomontage du Petit Travers

Rampe d’accès à la plage

Piste cyclable

Cheminement pour les personnes à mobilité réduite
Le Carreau Wendel est le dernier carreau de mine encore intact en France, malgré son arrêt d’exploitation en 1980. L’objectif de cette étude était d’inventer un programme et un projet permettant
de redonner vie au site dans une région économiquement déprimée.
Ce travail, réalisé avec des bureaux d’études allemands, a nécessité une programmation créative alliant
moyens publics et privés.
Le projet associe :
- un élément déclencheur : un Festival des jardins, à la manière des Landesgartenschau allemandes
- des activités sportives
- de l’activité économique sur des créneaux très ciblés.
Réinventer la vitrine de la Côte d’Azur est devenu une nécessité car : le modèle, inventé à la fin du XIXe siècle, s’est usé et ne répond plus au nouveau standard imposé par les grandes « rivales » comme Barcelone, Monte-Carlo, Miami, voire Venise ; et le tourisme est une composante essentielle dans l’économie niçoise. Depuis 1931, date à laquelle a été réalisé le dernier aménagement significatif, ce haut
lieu de la villégiature s’est dégradé en particulier avec l’explosion de la circulation automobile qui a grignoté l’espace dédié aux piétons, complexifié les traversées et créé un niveau de pollution qui nuit fortement à son image.
Son réaménagement en 2010 s’inscrit dans les balbutiements de l’avènement du siècle « durable ».Il offre à la municipalité d’inscrire ce projet dans cette dynamique, comme un modèle du nouveau tourisme basé sur le fait que « plaisir et fréquentation intense » n’est plus incompatible avec « mise en valeur de l’environnement ».
Compétition internationale et siècle « durable » nous ont conduit à imaginer une transformation substantielle globale du paysage actuel ; en incluant dans la réflexion la mer ; en renforçant l’unité du site par la plage élargie, la réhabilitation du mur socle, le traitement du sol, le collier de perles revisité ; et la création de la diversité d’ambiances pour un intérêt égal sur l’ensemble du linéaire.
La mer Méditerranée : son rapport à la ville de Nice est à couper le souffle. Cet immense plan d’eau face à une grande ville, nous a suggéré l’envie de créer une structure flottante polyvalente pouvant enrichir l’envie de profiter de la mer sans recréer une jetée comme celle du Casino qui, malgré son histoire courte, hante encore les mémoires… Grande comme un terrain de football, amarrée dans son port à l’extrémité Ouest de la prom’, elle se déplace au gré des événements qui rythment l’année niçoise. Accostable par de grands yachts, elle est le symbole du nouveau Nice, décomplexé, créatif… Tantôt lieu de spectacle, tantôt lieu de divertissement (piscine, boîte de nuit…), elle forme avec son « belvédère »
une terminaison puissante en résonance avec le projet du Nice moderne qui se développe dans la basse plaine du Var.
Le belvédère et la plateforme flottante
La prom’ se termine actuellement sur une zone mal définie entre le petit port de Carras, la station d’épuration et un espace vert sans caractère.
Nous proposons à cet endroit un nouveau lieu constitué d’une construction composée de terrasses plantées, d’un volume disponible pour des activités liées à la mer et des gradins tournés vers le port et la plate-forme flottante.
Ce lieu est un contrepoint au château, une scène inédite pouvant accueillir toutes sortes de manifestations peu sensibles au bruit des avions (matchs de football sur l’eau, sports acrobatiques…).

Vue de nuit de la plateforme

Séquence 5 : Carras… Les arts de la mer

Vue vers le belvédère
Le passé industriel a légué un territoire sinistré, mais a également laissé quelques « joyaux » dont les carrières de Saint-Avold et de Freyming. Ces dernières sont impressionnantes par leur taille, 336 ha et leur « falaise » accusant à certains endroits un dénivelé de 100 mètres.
Ce lieu emblématique est un atout majeur pour la région, pièce maîtresse du Parc Régional du Warndt, qui sera dédié aux loisirs et à l’habitat.
Il doit s’ouvrir au public, inciter et faciliter des évènements type : concert exceptionnel, défilé de mode, installation d’artiste…
Par ce biais, ce lieu doit « tirer la région vers le haut », constituant avec le site du Musée de la Mine et Völklingen en Allemagne, une carte de visite maîtresse de la région.

Le projet sur le site des anciennes carrières

Secteur Est

Secteur Ouest

Zone sportive
Le site de Besançon est marqué par le Doubs qui définit une temporalité calme et patiente comparée aux actions humaines. La vocation industrielle du site n’a eu qu’une durée de vie limitée. La friche industrielle qu’est devenue la boucle amont de Besançon, amène à une réflexion sur la vocation future de ce site en recherchant à l’inscrire dans la pérennité du lieu.
Le site des Prés de Vaux occupe une situation stratégique entre la ville et la campagne. Le Doubs assure le lien entre urbanité et nature. Les aménagements des berges minérales près du centre, arborées vers les Prés de Vaux, plus sauvages vers l’amont créent une tension entre valeurs de la vie urbaine et nature.
Le projet urbain des Prés de Vaux tend à révéler cette tension. La création d’un parc culturel longeant le Doubs est donc au cœur de notre réflexion.

Entre nature et culture

Plan masse du projet
L’Isère a un fort potentiel évocateur, ce n’est pas un hasard si une carte postale sur deux présente Grenoble en trois plans : la montagne en fond de décor, la silhouette de la ville au centre du tableau et l’Isère en premier plan. L’essentiel du travail consiste donc à redéfinir un juste équilibre entre les différents usages des berges pour passer d’un lieu de passage à un lieu de vie.
Les usages attendus sur les quais :
Notre proposition ne vise pas à faire des quais un thème en soi. Nous avons cherché à nous appuyer sur des pratiques existantes ou latentes pour amplifier les relations transversales. Les ponts redeviennent des lieux privilégiés. Les quais sont essentiellement un espace d’articulation de pratiques déjà existantes en les mettant en connexion entre elles.
À cela nous ajoutons quelques touches ludiques comme la baignade. La passerelle, par exemple qui en se combinant avec le téléphérique donne une touche féérique au projet. La pratique du vélo est comme la marche à pied naturellement encouragée avec ce projet.
La piste bidirectionnelle au Nord, les aménagements cyclistes au Sud mettent en connexion de nombreux équipements cyclables existants.
Ce projet est sans doute le plus emblématique des projets de la ville durable : il touche un élément naturel primordial de la ville et sa réappropriation doit être pour nous enchantée et festive.

Les terrasses et la baignade du quai nord

Le parc Michallon devient partie intégrante des rives
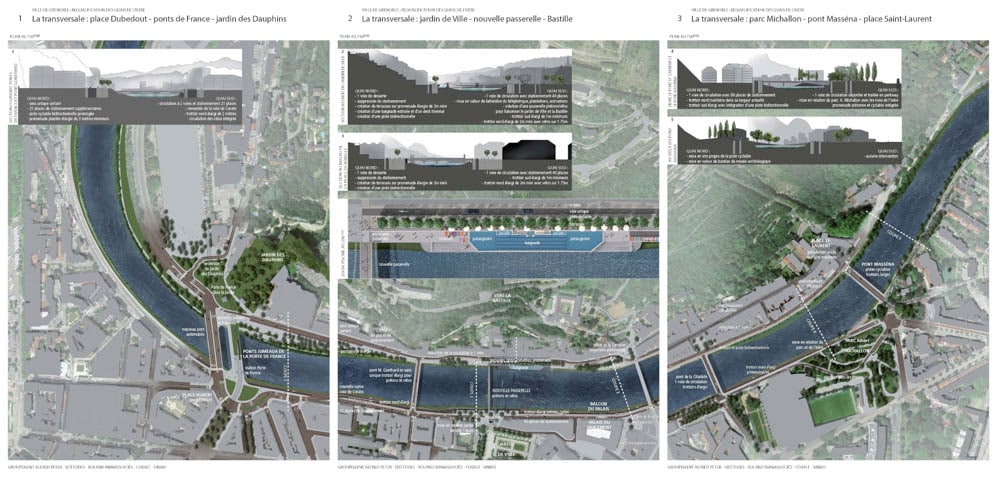
Le jardin de ville, la passerelle et la Bastille
Le lido de Sète est constitué d’une étroite bande sableuse longue de 11 kilomètres et large de 1 à 2 kilomètres, entre l’étang de Thau et la mer Méditerranée.
Ici se juxtaposent des milieux naturels riches et fragiles : l’étang, les salins, les sansouires, les dunes, la vigne. Mais ce lieu est très menacé par, d’une part, une érosion intense et généralisée et d’autre part, une fréquentation intense et mal maîtrisée.
Le parti d’aménagement du lido veut mettre un point d’arrêt à l’érosion et gérer les activités et usages du site. Le projet comprend le déplacement de la voie littorale, le réaménagement des plages, le cantonnement du stationnement, la valorisation des paysages, le développement des circulations douces et des dessertes collectives.

La route reculée et couplée à la voie ferrée

Une plage et son cordon dunaire restauré
Aspatial, atemporel, le Mont Saint-Michel – petit îlot rocheux avec son abbaye bénédictine – va reconquérir son espace dans un double travail sur les mouvements des eaux et les flux humains.
Le parc de stationnement est un sas où l’automobiliste devient piéton. Ce sas doit être le commencement de l’approche, il doit entrer en résonance avec le Mont.
Notre proposition consiste à l’ancrer dans l’essence même du lieu et de faire de l’approche du Mont un temps fort de la visite.
Le parc de stationnement s’inscrit véritablement dans le site : il le valorise, entre en résonance. C’est un champ cultivé, dont la fonction stationnement est imperceptible tant du Mont lui-même que des collines avoisinantes.
Les principes de fonctionnement sont très simples : organisation en alvéoles cloisonnées par des fossés d’assainissement.
Le système d’assainissement contribue pleinement à accompagner le dessin des espaces de stationnement et des circulations. Un complexe herbe/cailloux tapisse le sol : il draine les eaux de pluie. Les fossés ceinturant les alvéoles collectent ces eaux : ils sont comblés de roseaux qui jouent un rôle de filtre.
Une navette hippomobile assure la liaison entre ce lieu d’accueil et le Mont Saint-Michel.

Vue aérienne de l’ensemble du site

Le parc de stationnement, depuis la digue haute, dissimulé par les saules

Promenade en rive ouest du marais blanc
Les remparts d’Avignon font partie du patrimoine mondial de l’UNESCO. L’ouvrage est pratiquement intact, mais les abords sont dans un état misérable :
- côté Rhône, la ville est coupée du fleuve par une quasi autoroute
- côté Est, les douves ont disparu au profit de voies de circulation et de parkings.
L’objectif du projet acté est de créer un plan directeur de mise en valeur des remparts en l’inscrivant dans un nouveau plan de circulation incluant un TCSP côté Est. Le projet a fait l’objet de réalisation très ponctuelle (le Champ de Mars). La réalisation globale dépend de deux préalables : la réalisation d’un nouveau pont sur le Rhône et la création du TCSP.
Cette étude a été réalisée avec la participation de l’architecte des monuments historiques.
Ce long linéaire côtier, de près de 7 km, offre une vue imprenable sur l’estuaire du Komo et l’océan atlantique. Mais ce littoral est très inégal, sans rapport à la mer – excepté la plage Nord et le jardin devant le palais présidentiel – sans lien fonctionnel ni visuel (pas de cadrage, ni de traversées piétonnes adaptées) entre les rues perpendiculaires du cœur de ville et le front de mer. Il est saturé de véhicules ne laissant que peu de place à la déambulation.
Inverser le regard
Au-delà du simple enjeu de réaménagement de la première bande littorale, le réaménagement du Bord de Mer recèle un enjeu urbain de retournement de la ville vers sa géographie, vers l’eau. Dans la grande tradition des parcs linéaires du monde, le Bord de Mer deviendra le « collier de perles » qui unifiera beaucoup de grands ouvrages de Libreville. Rassembler habilement les éléments du Bord de Mer pour promouvoir la participation à la vie de la ville, offrir un divertissement et une accessibilité à tous, créer ainsi des expériences mémorables qui laissent une forte impression positive et durable, sur les habitants et les visiteurs.
Sortir de l’aire routière stérile
L’implantation historique de Libreville au bord de l’eau lui confère un lien privilégié avec la mer, lien aujourd’hui corrompu par l’infrastructure routière.
Libreville a des difficultés à accueillir un volume élevé de véhicules privés et le problème ne peut que s’aggraver avec les 20 000 nouveaux prévus chaque année au Gabon. Le système de transport existant dans et autour de la zone d’étude a ainsi limité le développement des transports en commun et créé une forte dépendance aux taxis. Pour cette raison, la stratégie du gouvernement – qui encourage les initiatives de transports publics, les transports alternatifs comme le vélo ou la marche et veut améliorer les espaces publics en facilitant l’accès pour tous, les connexions et l’intermodalité – est aussi la nôtre.

Plan d’ensemble

Plan détaillé
Bordeaux : aujourd’hui, une agglomération qui marche assez peu…?
Comparativement aux autres agglomérations françaises, la pratique de la marche en tant que mode de déplacement principal est assez peu développée. Bien sûr, le constat est à nuancer en analysant plus finement la pratique selon les distances parcourues : 70% des déplacements de moins d’un kilomètre se font aujourd’hui à pied. Mais la pratique chute à moins de 25% pour les déplacements compris entre 1 et 2 kilomètres (source A’Urba).Sans doute l’agglomération est-elle desservie par des paramètres lourds, sur lesquels l’action publique à court / moyen terme n’aura qu’une prise limitée. Une densité urbaine relativement faible, la performance relative des modes concurrents (les transports publics en urbain, la voiture en première et en seconde couronne), la tendance lourde des dernières décennies à l’allongement des distances parcourues sous l’effet de la spécialisation des territoires, etc.
…mais une dynamique à encourager et à entretenir
Pourtant, l’agglomération s’inscrit dans une vraie dynamique de réhabilitation de la place du piéton en ville :
- Son PDU est peut-être l’un des premiers en France à avoir inscrit le principe d’équilibre « 50/50 » entre espace dévolu aux piétons et espace dévolu à la chaussée pour le (ré)aménagement des voies urbaines ;
- De nombreuses réalisations exemplaires ont été faites en matière d’espace public, sur des lieux emblématiques (le mirroir d’eau, l’extension de la piétonisation du centre-ville) ;
- Des projets urbains structurants, sous-tendus par une commande politique ambitieuse en matière d’éco-mobilité, à l’image du projet Saint-Jean Belcier d’Euratlantique, sont en gestation.
C’est à cette dynamique que le schéma directeur piétons doit contribuer, avec peut-être deux défis spécifiques :
- Celui de s’intéresser à tous les territoires, et pas seulement aux centralités;
- Celui de pouvoir agir dès le court terme, pour donner davantage de visibilité au piéton et redonner l’envie de marcher aux bordelais, sans se résumer à un plan de communication détaché de la réalité du terrain.
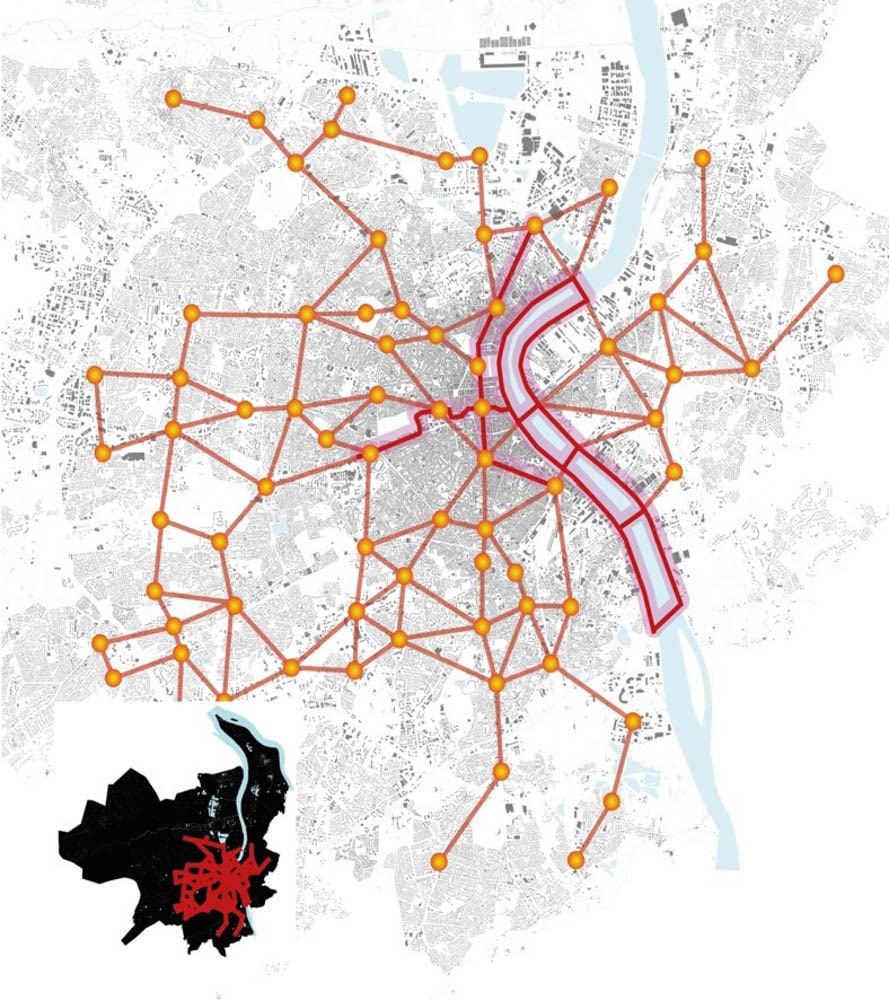
Le réseau « cosmos » : des liaisons entre centralités de l’inter-rocade
Le réseau vélo express de Strasbourg est composé de 3 rocades et 9 radiales. Ces itinéraires pour partie existants, s’inscrivent dans un plan lisible et simple. De largeur 4 mètres, dotés de nombreux services et commodités, ces itinéraires sont conçus pour être très attractifs et avec un minimum de contact avec le réseau routier. Ce réseau est déployé dans le plan nature de la métropole.
L’itinéraire Strasbourg-Brumath est en cours de test.
Cet itinéraire en bord de canal de la Marne au Rhin consiste transformer une véloroute « conseil général » en un axe à forte capacité en aménageant la deuxième rive, en apportant des services et des aménités comme des cafés par exemple.
Le projet transforme le canal en grand parc linéaire reliant 3 communes : Schiltigheim, Bischheim et Hoenheim entre elles…
Après avoir réalisé des infrastructures de transports publics, la Communauté Urbaine de Nantes a demandé d’étudier le « cardo et le decumanus » du vélo.
Ce travail de rattrapage pour rendre la politique du vélo plus visible et efficace nécessite de s’adapter à des situations très diverses pour créer sans casser.
Sur le passage de l’Île de Nantes, les pistes cyclables ont été aménagées en site central de part et d’autre du tramway. De fait, le projet améliore très sensiblement le boulevard aménagé récemment de façon fonctionnelle.

Traversée de l’Ile de Nantes
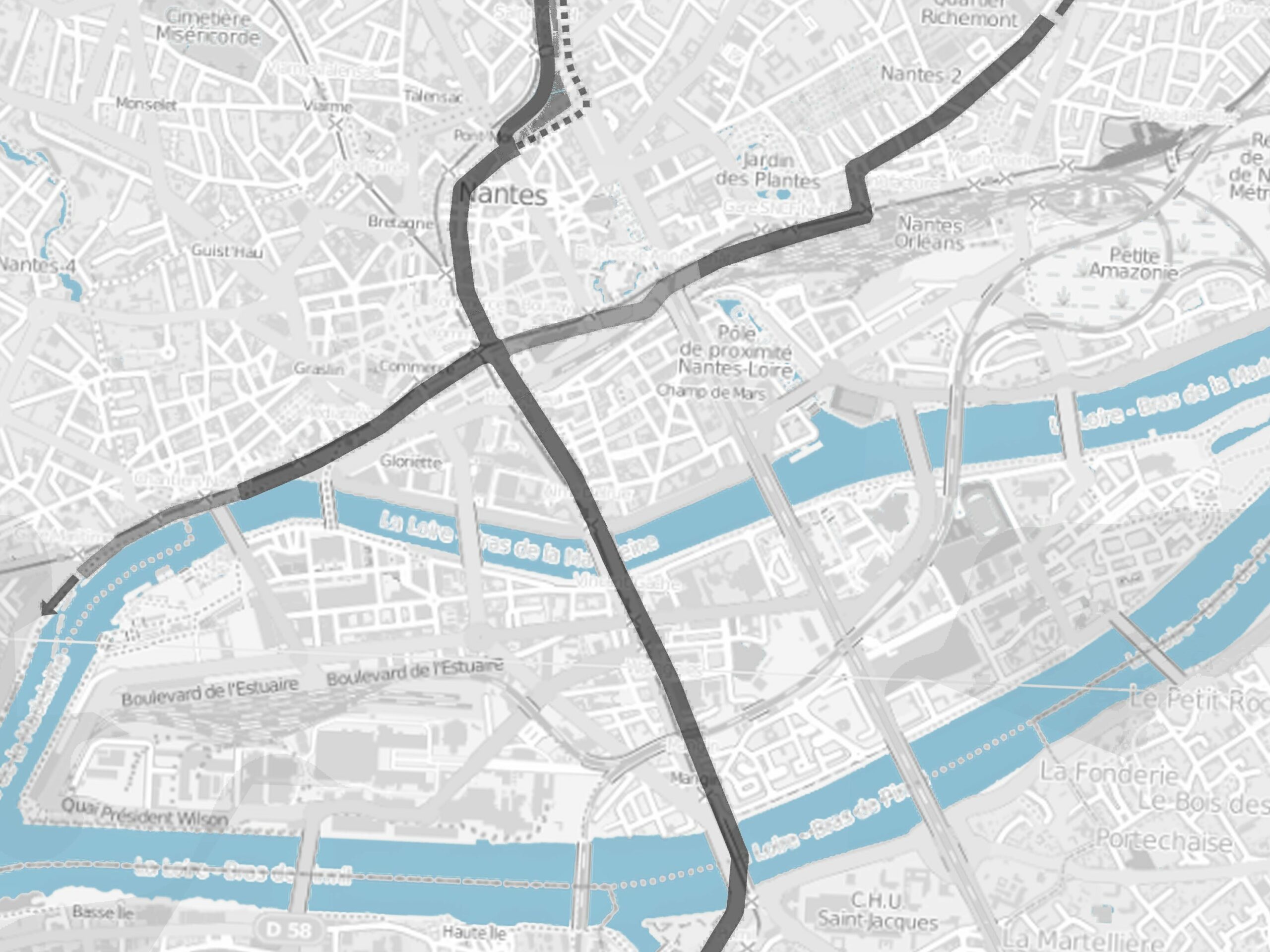
Schéma global du réseau

Le réseau cyclable accompagne le tramway comme sil avait toujours été là

Piste bilatérale très confortable
Le projet de la LINO a évolué dans le temps. Pensé initialement comme un élément efficace et rapide du système routier radio-concentrique, il a progressivement changé de nature. Il figure aujourd’hui au Schéma Directeur comme élément constitutif du « grand boulevard urbain lillois », voie structurante d’un niveau hiérarchique inférieur à celui de la rocade Nord-Ouest.
La LINO ne doit plus se penser comme une offre supplémentaire qui se mettrait en concurrence avec les transports publics, mais comme un des maillons d’un système de modes de déplacements complémentaires les uns aux autres.
- LINO SUD est une route dans un écrin planté type parkway, avec deux séquences fortement bâties à Haubourdin et à Lomme.
- LINO NORD est un boulevard planté 2×1 voie avec stationnement et voie Bus à Haut Niveau de Service.
- LINO CENTRE est raccordée sur l’avenue de l’hippodrome pour améliorer son fonctionnement.
Une voie bus en rocade empreinte l’ensemble de l’itinéraire (en voie unique sur certains tronçons).
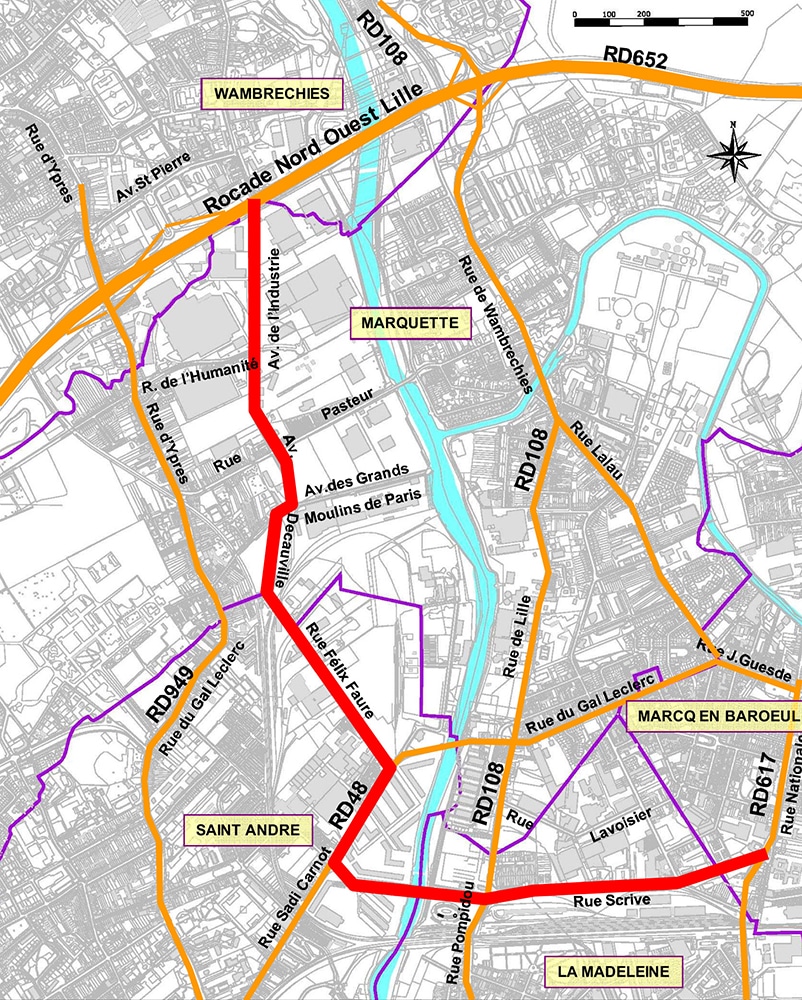
Plan du réseau
Le bord de mer de Villeneuve-Loubet est surtout caractérisé par la présence très imposante de la Marina. La route qui la contourne en se décrochant du bord de mer fait découvrir un envers de décor très délabré.
L’objectif du projet de requalification consiste d’une part à « civiliser la route » dans le prolongement du travail réalisé à Cagnes-sur-Mer, d’autre part à restructurer le bâti sur les deux rives et aménager la plage.
C’est un travail à plusieurs échelles de temps, mais la restructuration du bâti au Sud et l’aménagement de la plage, sont des actions en cours de réalisation.
Le traitement de l’espace public sobre et appropriable
Le littoral méditerranéen entre Nice et Antibes est usé. Le tronçon de Cagnes-sur-Mer d’une longueur de 3 km concentrait tous les ingrédients de la disqualification : architecture médiocre, voie rapide créant une forte coupure entre ville et mer, promenade inconfortable, plantations sporadiques…
Réhabiliter ce site a consisté en premier lieu à civiliser cet axe en supprimant 2 voies de circulation, les échangeurs dénivelés, les passages piétons souterrains sinistres, sans créer de report de trafic. La contribution de l’ingénieur mobilités suisse, Philippe GASSER, a été déterminante pour régler un système circulatoire complexe dans un espace limité.

Promenade piétonne et cyclable le long de la mer

Promenade piétonne et cyclable le long de la mer

Séquence hippodrome de nuit
Côté terre
Le projet prend appui sur la voie ferrée : pour affirmer cette ligne de force, nous traitons le soutènement de la voie en gabions et le bordons d’une rangée de plantations (des pins d’Alep, qui ne nécessitent aucun entretien).
Côté mer
Le projet utilise la largeur disponible pour créer une promenade de 10 mètres de large sans obstacle.
Pour rythmer ce long linéaire sans porter atteinte à la perception générale du panorama, une quinzaine de palmiers sont plantés dans la bande de stationnement au niveau de chaque passage transversal.

Promenade piétonne et cyclable, le long de la mer entre le Fort-Carré d’Antibes et la marina de Villeneuve-Loubet
Le projet est assumé par notre équipe depuis la recherche de l’itinéraire jusqu’à celui de la réalisation.
De Moineville (54) à Rombas (57), 23 km de berges le long de la rivière Orne franchie par 8 nouvelles passerelles et agrémenté de 10 placettes d’accueil aux abords des communes traversées.

Un exemple de section courante

Base de kayak à Homécourt

Passage à gué à Homécourt

Passage à gué à Auboué
Les tours de résidences, immeubles posés dans des pelouses sans âmes, ont fait l’objet d’un retraitement de leurs façades et de leur pied. Ce travail a permis d’affecter des parcelles privatives à chaque tour avec : délimitation par une grille, repositionnement des conteneurs à ordures et création d’aires de jeux fermées pour les enfants.

Aménagement du pied de tour

Création d’aires de jeux

Plan masse de l’aménagement du pied de tour du 5 rue Dorey
Cette étude vise à tirer parti de l’ouverture de la route des Tamarins (2×2 voies) pour y mettre tout le trafic de transit et affecter à la route nationale, entre St-Paul et Etang-Salé, un statut d’axe secondaire à caractère touristique réservé aux vélos et piétons, aux bus Eolis et Car Jaune (en site propre) et aux accès locaux tout en valorisant le littoral.
Les enjeux pour le développement des mobilités douces et des transports publics, pour le patrimoine paysager et le tourisme sont énormes alors que les inconvénients par rapport aux habitudes actuelles concernent moins de 3% des déplacements du secteur concerné par la route des Tamarins.
L’étude a démontré la faisabilité d’un tel projet avec des moyens extrêmement limités. Ce projet pouvant passer par une phase d’expérimentation à coût marginal – barrières et marquages – et à tout instant rouvrir la RN1 au trafic si des problèmes majeurs devaient s’avérer.
En dernier recours il serait possible d’ouvrir la RN1 au trafic les jours de semaine et d’appliquer les restrictions uniquement le samedi et le dimanche, même si une telle proposition aurait un impact limité sur la valorisation du littoral…
Longtemps martyrisée par un trafic de transit infernal, cette rue paraît soudainement vide depuis la mise en service du contournement et laisse apparaître toutes ses imperfections. Avec ces postulats, nous avons bâti une stratégie de projet entièrement dédiée à l’ATTRACTIVITÉ.
Le projet consiste à réaménager 1,5 km de voirie de façade à façade, en redistribuant l’espace entre tous les modes de circulation : véhicule léger, transport en commun, cycles et piétons. Le projet comprend entre autres un arrêt du TSPO (Transport en commun en Site Propre de l’Ouest) dont le trajet emprunte la rue du général de Gaulle, un autre arrêt est prévu à la limite Est de notre intervention et sera suivi en maîtrise d’ouvrage par le Conseil Général et son propre maître d’œuvre.
Redécouvrir un site exceptionnel
La géographie de Marlenheim riche et complexe est son premier atout. Nous voulons insérer le projet dans une mise en valeur globale du territoire pour éviter le piège du surinvestissement et la perte d’authenticité.
Une attention particulière est portée aux connexions perpendiculaires à la rue principale. Elles ont toutes un caractère différent et sont une invitation à découvrir la diversité et la richesse de la commune. Notre proposition consiste à retraiter certaines amorces sur une dizaine de mètres.
Affirmer une image pittoresque
L’image de Marlenheim est brouillée : ni ville, ni village, cette commune manque d’identité capable d’attirer les visiteurs. Le terme bourg-centre utilisé dans le SCOT résume bien cette ambiguïté. Globalement l’image penche plutôt vers le village notamment grâce au très grand nombre de maisons rurales de qualité présentes le long de la rue du Général de Gaulle.
Intensifier la centralité du noyau médiéval
La réussite d’un projet est toujours liée à celle de l’aménagement de son centre. Un changement spectaculaire pour la Place du Kaufhaus est donc totalement stratégique. Nous pensons qu’il ne faut pas la regarder comme un sujet en soi, mais comme un élément d’un puzzle comprenant la place de l’Église, de la Liberté, les rues de la Mairie, du Maréchal Leclerc, Sainte Famille, et le parc de la Mairie. C’est donc l’appartenance à ce réseau d’espaces publics que nous avons privilégié en changeant le tracé de la bande roulante.
Ce dispositif permet une continuité piétonne avec la rue du Maréchal Leclerc, le marché peut aussi s’agrandir sur la place sans interruption par une voie de circulation et des terrasses de restaurants agrandies.
Le changement de tracé de la bande roulante donne un prétexte pour démolir la maison du syndicat d’initiative ; son architecture inqualifiable, sa position au milieu de l’espace qui en fait l’élément de composition principal est un obstacle à l’appréciation de la très grande qualité des architectures autour de la place.
La plantation tire parti de la spécificité de la morphologie de l’espace : 2 alignements d’arbres disposés en éventail occupent l’espace, créent une ambiance conviviale et permettent une très grande polyvalence d’usages à l’ombre lors des beaux jours. Les terrasses des restaurants autour de la place deviennent plus visibles et plus grandes. Pendant la période de Noël, les arbres s’illuminent et créent un cadre féérique propice à l’ambiance « marché de Noël ». Tous les équipements nécessaires à une forte animation sont intégrés dans l’aménagement de la place : bornes électriques rétractables, points d’eau… Le sol en pavé naturel est solide, confortable, peu sensible aux salissures. La place du Kaufhaus doit redevenir le fer de lance de la politique touristique de la commune.
Rompre avec une traversée aménagée pour la fluidité du trafic
L’avenue de la Liberté constitue le principal accès au centre ville en venant de l’Ouest. Comme dans le Sud, elle fonctionne en «couple» avec l’avenue de Lodève / Gambetta. Cette dernière va perdre une grande partie de sa capacité avec l’installation de la 3ème ligne du tramway reportant ainsi une partie du trafic sur l’avenue de la Liberté.
Son réaménagement doit être pensé comme un système de deux avenues parallèles, l’une devenant un axe fort de transport public, l’autre restant principalement dédiée aux automobiles.
La bonne référence en matière d’aménagement d’entrée de ville est l’avenue Pierre Mendès France : mais les données ne sont pas strictement les mêmes. La largeur disponible est plus faible, le bâti, essentiellement de l’habitat, essaye de se protéger contre les nuisances de la route. Les carrefours sont nombreux, dangereux et compliqués. Ils sont souvent le fruit d’adaptations successives avec une constante : la traversée piétonne et cycliste est risquée. Le bâti autour de l’avenue est hétéroclite et n’arrive pas à constituer des bords solides capables de «tenir» cet axe d’animations, en osmose avec les activités permanentes.
Cette inversion de fonctionnement vient sans doute rompre une habitude qui s’inscrit dans l’histoire, mais la redynamisation commerciale de cet espace passe par des changements radicaux. Nous voulons faire de ce cours une salle polyvalente à ciel ouvert sans pour autant porter atteinte à son rôle de colonne vertébrale du système de circulation.
En terme d’image, nous proposons de garder à ce « cours de services » un côté rustique, simple et polyvalent. Dans le triptyque nîmois VEGETAL – MINERAL – EAU , nous substituons à l’eau, si présente en haut du cours, la LUMIERE. Car le travail sur l’éclairage est un accompagnement incontournable des lieux « où il se passe quelque chose ».
Le retraitement de l’ancienne route nationale dans la traversée de Blénod-Lès-Pont-à-Mousson a permis de mettre au point un concept original en privatisant les usoirs. Chaque maison a été prolongée par des murets et grilles jusqu’à la limite de l’espace public.
De fortes plantations dans les parties privatisées permettent d’atténuer la tristesse des façades et de créer un espace de transition entre le trottoir et le seuil de la porte.

Trottoir confortable et piste cyclable continue

Les usoirs rendus au privé : plantation généreuse et clôture neuve
C’est une longue pénétrante, itinéraire obligatoire pour accéder à Amiens, qui a été retraitée dans l’esprit d’une avenue séquencée en fonction des largeurs disponibles. Une plantation centrale sur un terre plein sans dénivelé a permis de créer une charpente arborée, sans générer de déviation de réseaux, tout en gardant une grande flexibilité d’usages.

Une artère structurée avec de grands arbres

Une artère structurée avec de grands arbres

Une entrée de ville « civilisée »
L’axe constitué par les boulevards A. France et J.-F. Kennedy est un pur produit de l’urbanisme des années 1960.
S’il est aujourd’hui incontestablement une des voies structurantes de BELFORT , il manquait singulièrement d’urbanité : seule la rangée d’arbres centrale rappelait un peu que nous étions en ville. Très peu d’activités étaient tournées vers le boulevard, la pratique des circulations douces était désagréable et parfois dangereuse.
Large comme le périphérique parisien, mais utilisé par un nombre d’automobilistes stable et largement inférieur à sa capacité, ce boulevard d’opérette avait besoin de se remettre en phase avec les quartiers traversés. Cela se forge au cœur de l’identité, dans un travail tout à la fois sur l’axe et les rives.
Le ruban de 2 kilomètres traverse un monde qui n’est pas monocorde, uniforme. C’est une succession de 4 entités bien distinctes, ayant chacune sa personnalité propre. Notre proposition cherche à exhaler ces réalités dans une suite de situations contrastées. La qualité du parcours (3 – 5 minutes pour un automobiliste, une demi-heure pour le piéton) est déterminée par un enchaînement de paysages cohérents.

Un boulevard qui s’étire sur 2.3 km


Prendre soin de cette ville, tel est le mot d’ordre de ce projet. La proposition de rouvrir la Leysse sur une grande partie de son parcours n’est pas tant la réparation d’une maltraitance du cours d’eau, mais bien un acte de réhabilitation de la ville avec son territoire, sa géographie, son histoire.
Ce faisant, ce projet est bien plus qu’un projet d’espace public : il déclenche un processus visant à donner une perspective à toute la partie Nord de la ville et – si on inclut les mutations autour de la gare et celles que nous avons proposé sur le site de la Boisse – dessine une vision, un visage d’une ville prospère sachant allier développement et qualités spatiales.
Bien entendu cette vision se heurte à quelques habitudes bien ancrées en matière de circulation par exemple, de coups partis comme la réfection de la couverture de la rivière, ou la configuration du nouveau pôle d’échanges.
Pour chacune de ces questions nous avons proposé une solution qui nous semble apporter un plus à la situation et au projet préexistant.
Faire de ces éléments contraignants un projet urbain
Ainsi, les éléments de contraintes, autrefois relégués au rang de solutions techniques s’affirment comme des éléments de projets urbains. La Leysse retrouve une position de centralité et d’interface entre les quartiers adjacents, ménageant de nouvelles liaisons et proposant un cadre résidentiel très valorisant pour les ensembles d’habitat. La Leysse n’est plus ignorée mais redevient le principal vecteur de transformation identitaire du centre ville.
Sa redécouverte en fait l’un des principaux composants du paysage urbain requalifié, faisant écho dans sa linéarité à la dimension géographique de la cluse.
Associée aux avenues recalibrées et aux espaces publics connexes (place du Palais de Justice, jardin du Verney, place de la Gare, …), nous proposons que la Leysse détermine la base de la nouvelle armature urbaine qui articule l’ensemble des entités constitutives de la centralité d’agglomération.

Quai du Jeu de Paume

Retrouver les fondamentaux : la ville se redessine avec sa rivière
Lauréat d’un concours portant sur la rénovation des aires de l’autoroute A4 entre Metz et Strasbourg, l’équipe a cherché à renforcer leur traitement naturel en harmonie avec les sites dans lesquels elles sont implantées.
L’idée de mettre l’automobiliste au repos dans un paysage authentique, a également inspiré l’architecture des édicules.

L’Aire des Quatre Vents
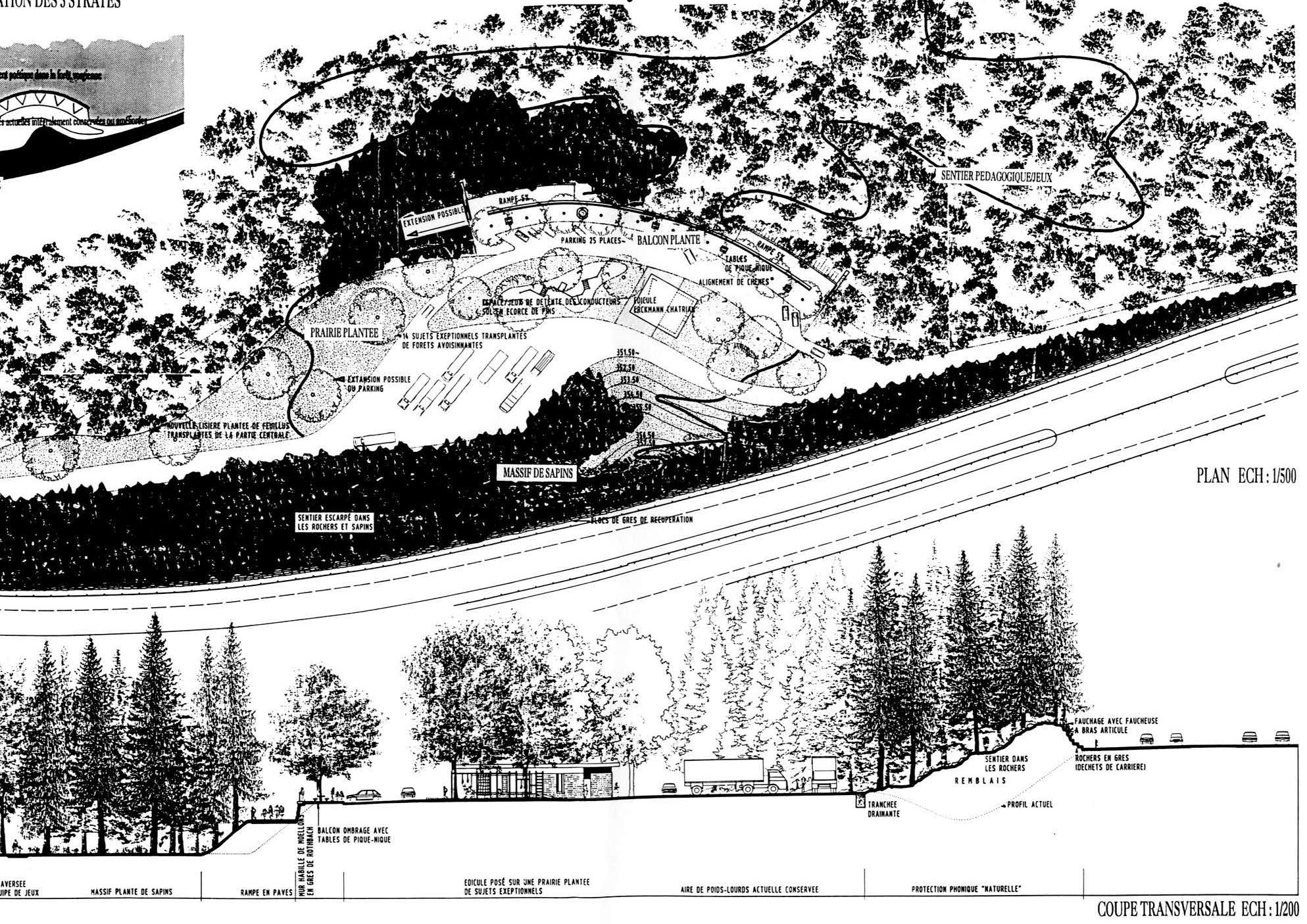
Schéma d’organisation des trois strates

Les ambiances

Les bâtiments de service
L’insertion paysagère et architecturale du projet est traitée avec une volonté de discrétion, d’effacement et de renforcement des traits principaux du paysage existant. Ainsi le fil rouge de la proposition architecturale est de renforcer le paysage existant pour adoucir au maximum l’impact de l’ouvrage. Cette posture est déclinée dans tous les domaines :
- La recherche constante de la moindre consommation de terres agricoles
- L’expression architecturale des ouvrages d’art
- Les modelés de terrain
- Le traitement des échangeurs et de l’aire de service

Insertion en viaduc du tronçon Nord à Vendenheim

Intégration de l’infrastructure par reconstitution de la lisière forestière
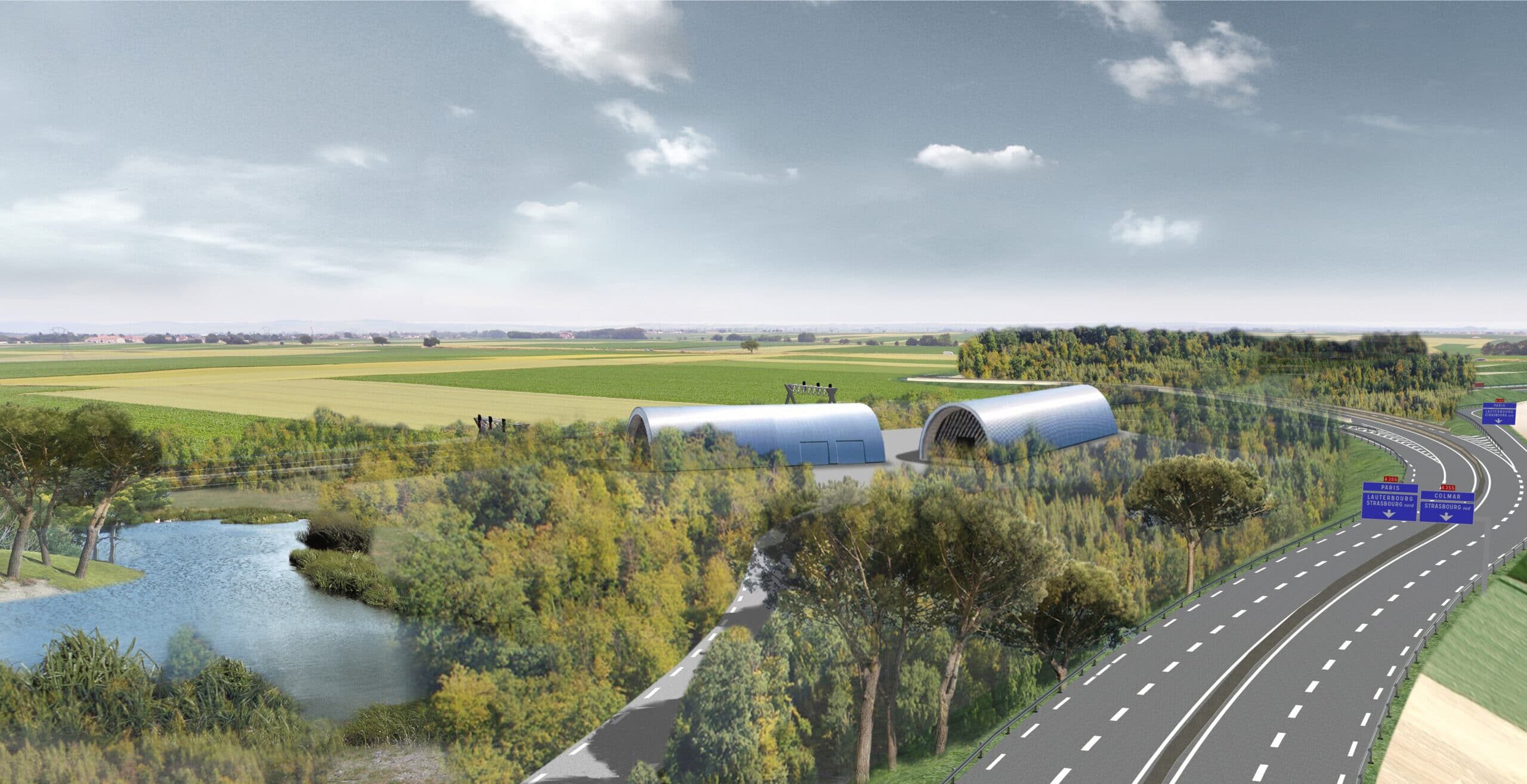
Centre d’entretien et bassin de récupération d’eau se fondant dans le paysage

Ouvrage d’art sobre surplombant le canal de la Bruche et sa piste cyclable
La 42ème Avenue est un microcosme de NYC reflétant ses multiples facettes et le flux dynamique, varié et onduleux de la ville. La rue iconique traverse des environnements multiples ; une promenade du fleuve au fleuve est un voyage à travers l’atmosphère de NYC, son allure, son paysage et sa culture.
Trois concepts urbains utilisés pour un tramway gratuit sur la 42ème Avenue :
- Un grand jardin linéaire : Création d’un jardin linéaire Est-Ouest planté et pavé. Il connecte l’Hudson et l’East River, et dessine l’esprit de la rivière dans le cœur grouillant de la ville.
- Le passage du tramway : Comme un caméléon, le tramway s’imprègne du caractère de chaque section qu’il traverse. Le design souligne l’esprit de l’environnement et exploite sa diversité pour créer une continuité.
- La trame : L’intégration urbaine du tramway est conçue dans le prolongement du plan orthogonal de NYC, respectant la trame des rues et le quadrillage des façades. Le tramway devient ainsi la cinquième façade de la ville.
Le Design
L’esprit de la rivière (repères A) – l’est et les quais de l’Hudson sont conçus comme une promenade verte vivante, pour créer une continuité. À l’entrée de la 42ème avenue, le tramway dessine cet esprit dans la ville grâce à des restaurants, bars, café et terrasses. La piste cyclable, le tramway et les espaces verts piétons sont éclairés pour que la rue soit vivante, de jour comme de nuit.

Un jardin linéaire
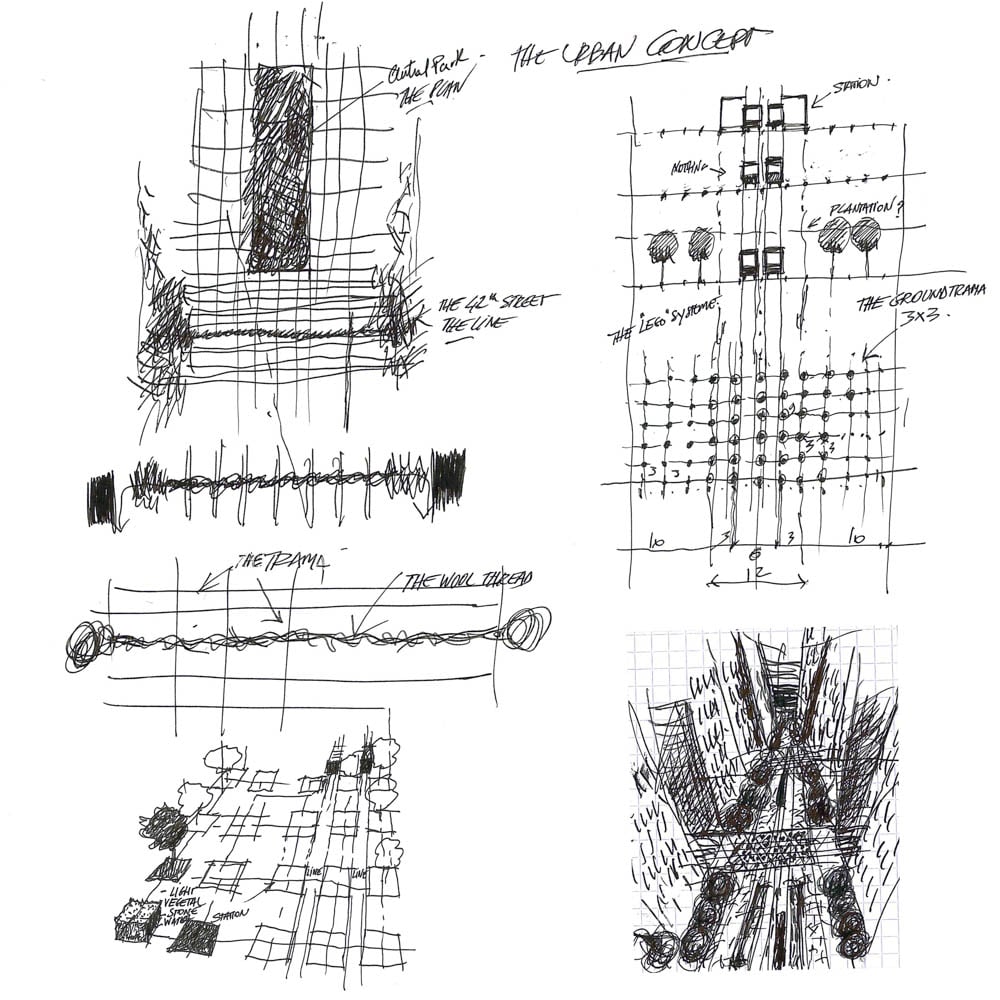
Croquis d’ambiance
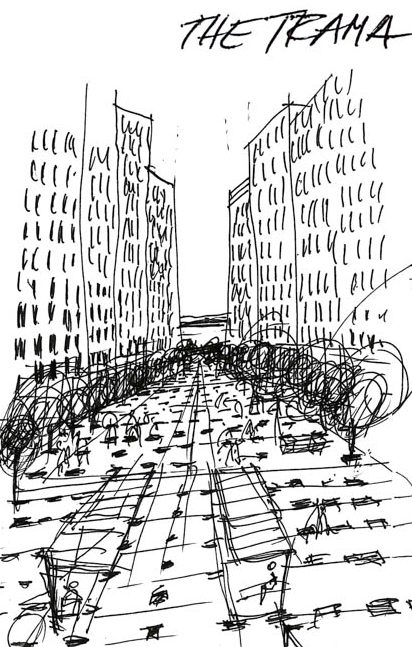
Croquis d’ambiance
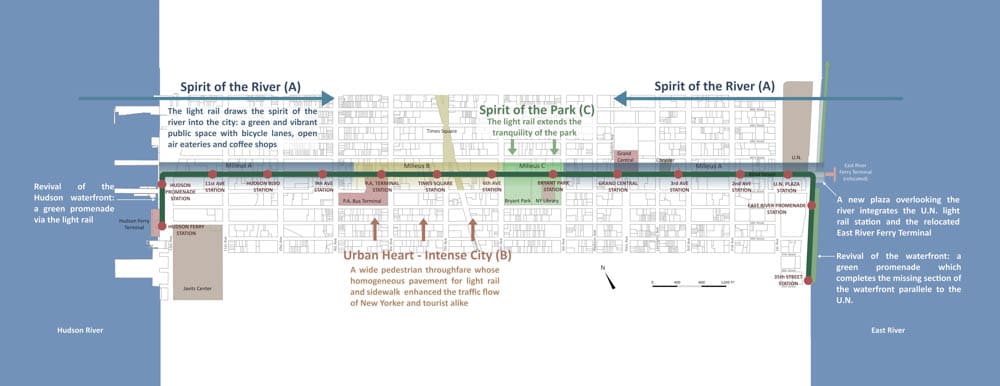
L’agglomération lyonnaise, comme tant d’autres, est victime d’un étalement urbain dont il est difficile d’organiser le fonctionnement des transports. L’Ouest lyonnais propose une véritable alternative à l’utilisation exclusive de la voiture en développant un réseau de tram-train performant et attrayant.
Trop souvent, les espaces aux abords des gares ou des voies ferrées sont les « oubliés » de l’aménagement urbain. Cet ambitieux projet, au contraire, est un moteur pour lancer d’importantes opérations de requalification et d’amélioration de la qualité de vie aux alentours. Choix de la localisation des gares, souci de continuité des aménagements le long de la ligne, affirmation de l’identité de la gare et de sa centralité : le tram-train participe à la constitution d’une continuité urbaine, d’un tissu urbain.
Cette étude a pour objectif de revisiter les 23 gares du réseau et de définir pour chacune d’entre-elle : le contenu nécessaire sur 3 périmètres.
- le périmètre de la gare proprement dite : quais, équipements, éclairage, accessibilité, destination du bâtiment historique…
- le périmètre du stationnement : échanges bus-train, équipement vélos, signalisation…
- le périmètre urbain : accessibilité par les modes doux, relation de la gare avec les villes…
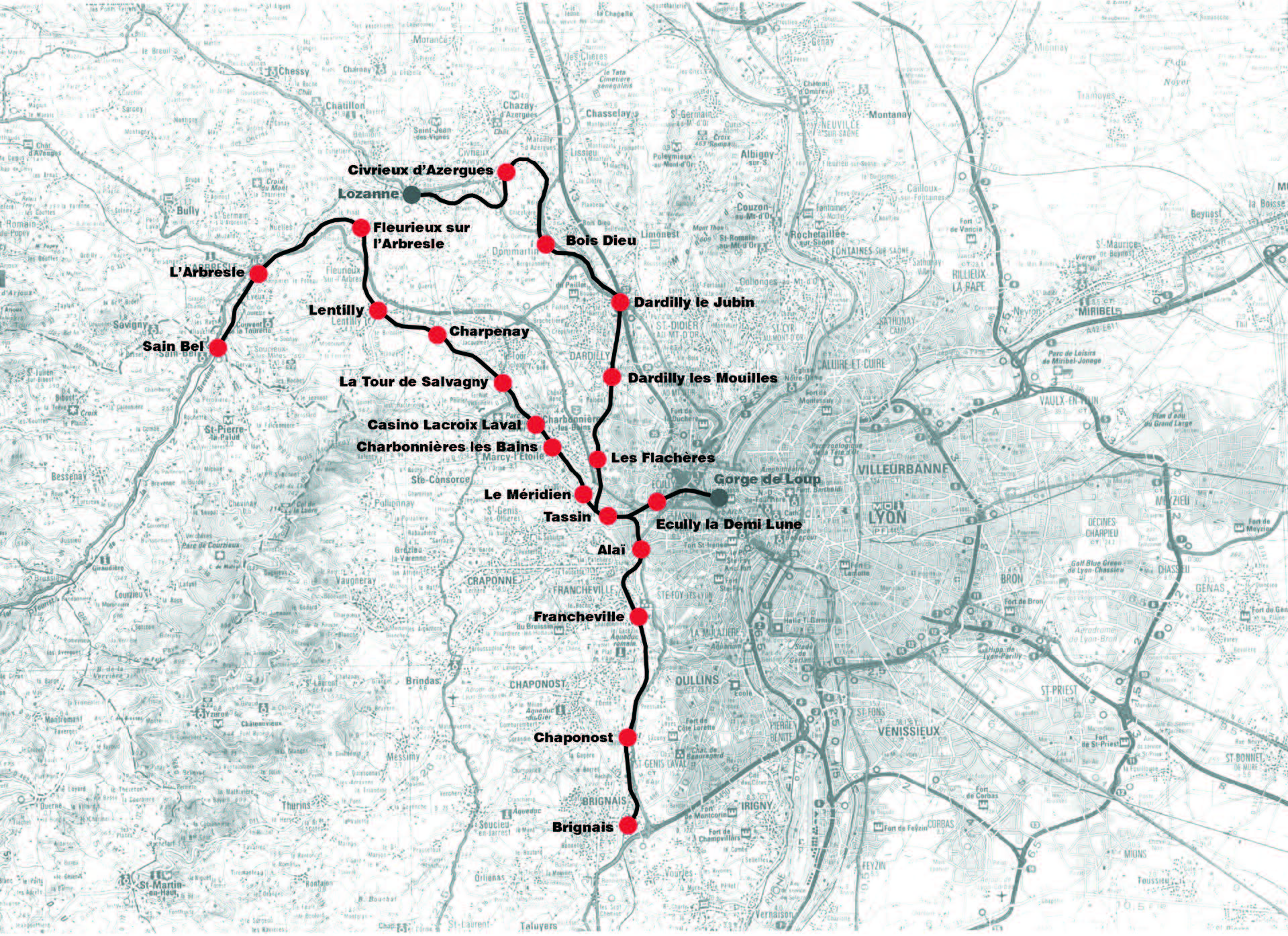
Développer une alternative à l’utilisation exclusive de la voiture
La mission a consisté à analyser les situations urbaines des 23 arrêts prévus suivant 3 périmètres :
- la commune : accessibilité, nouveaux projets, densification autour des arrêts
- le secteur élargi de la gare : conception de l’espace public des parkings et mise en valeur de l’environnement
- la gare elle-même : définition de la destination des bâtiments existants, accessibilité, équipements des quais…
La section urbaine du Tram-train Bruche-Piémont des Vosges, en cours de chantier, permet de connecter les voies du tramway avec celles de la SNCF. Pour cela, leur arrêt est prévu en surface (place de la Gare) puis le Tram-train emprunte plusieurs voies urbaines pour se connecter avec les lignes actuelles. Ces voies font l’objet d’un travail qualitatif identique à celles du tramway.

Exemple de pôle d’échanges en section campagne : l’aéroport d’Entzheim

Exemple de section urbaine : l’arrivée place de la gare à Strasbourg
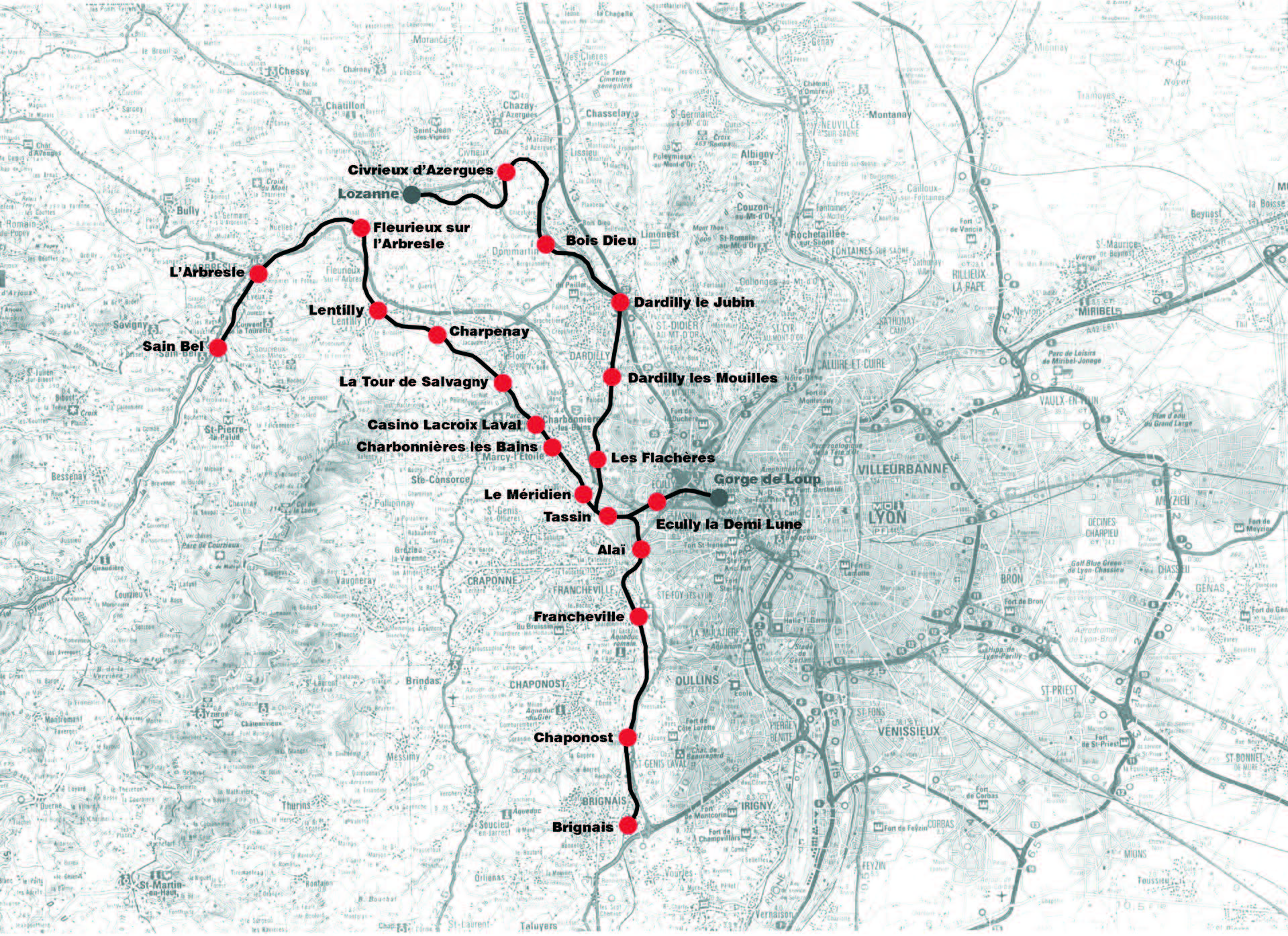
Réaménagement des stations existantes et création de 11 nouvelles stations

Perspective dune station type

Plan masse dune station type
Située au Nord de la Lorraine, dans la vallée de la Fensch, à quelques kilomètres de la frontière luxembourgeoise, la ville de Villerupt doit faire face depuis les années 1970 à la disparition de l’industrie sidérurgique.
Aujourd’hui, le Luxembourg développe à immédiate proximité de la frontière le vaste campus universitaire de Belval et de grands équipements scientifiques, culturels et sportifs.
Un nouvel avenir se dessine pour le territoire français qui va connaître d’ici à 2020 une forte croissance démographique. Le site de l’étude est identifié comme une opération d’intérêt national.
Dans ce cadre, la ville de Villerupt souhaite être acteur de son avenir et profiter du développement à venir pour renforcer, développer et rénover son centre-ville.
Nous avons réalisé un diagnostic urbain et commercial sur la traversée de Thil à Micheville puis effectué des propositions de programmations urbaines (équipements, commerces, transports, aménagements…).
L’ensemble est traduit dans un schéma d’aménagement urbain global, articulant densité urbaine et nature dessinant un cadre de vie agréable et attractif.
La mise en œuvre se fera par le lancement de 9 opérations successives.

Un cœur plus urbain, plus nature
Le come-back du tramway moderne dans le paysage urbain est un phénomène majeur de l’histoire de l’urbanisme dans les vingt années écoulées. Si ce phénomène est particulièrement puissant en France, quasiment toutes les villes se sont dotées d’un tramway. Le phénomène existe aussi dans d’autres pays comme l’Allemagne, la Belgique, la Hollande…
Pourquoi ce succès, cette popularité soudaine pour ce système de transport ? Il s’explique bien sûr par sa commodité d’accès, son confort, son efficacité. Mais la conception équilibrée dans les domaines de la mobilité et de l’aménagement urbain a largement contribué à en faire une «superstar» de l’urbanisme. Le tramway moderne permet de canaliser une vision de la cité de demain : une cité au développement maîtrisé mariant des ambitions métropolitaines et des qualités de vie au quotidien.

Principe d’aménagement place Reine Astrid

Place Reine Astrid
Le réaménagement de l’entrée sud de Strasbourg doit répondre à de nombreux objectifs :
- clarifier les relations avec les rives, en traitant la question des nuisances sonores dans les zones habitées et en créant une vitrine plus attrayante dans les tronçons dominés par les activités et le commerce
- créer des relations plus fortes entre les rives Est et Ouest par la création et la restructuration de carrefours
- favoriser la mutation des rives en créant une plus-value « de situation »
- donner une image urbaine et paysagère signifiant « un changement de monde »
- laisser la possibilité de créer des branchements intermédiaires
- fabriquer un paysage structuré de l’axe pouvant se poursuivre vers le nord.
Deux variantes contrastées
Le boulevard urbain
Les voies montantes et descendantes sont séparées par un site propre bus de 12m de large avec un accès direct des riverains sur le boulevard (pas de contre-allée) ; les cheminements cyclables sont placés sur des trottoirs élargis
Le parkway
les voies montantes et descendantes sont réunies sur une plateforme sans séparateur ; des contre-allées permettent la circulation des bus et la desserte des riverains et des aménagements paysagers amples donnent une connotation de parc à l’ensemble.
Le concept
Une allée (Landsberger Straße), une promenade et la NUP forment trois axes verts Est-Ouest fortement structurés par 640 arbres d’alignement ! Ils convergent, Am Knie : ce lieu devient une nouvelle place publique fortement soulignée par des toits couvrant des activités commerciales temporaires et une grande station de tramway marquant l’entrée du centre ville.
Ces trois axes sont reliés entre eux par des rues perpendiculaires ayant chacune leur personnalité :
- GleichmannStraße devient une rue piétonne classique, plantée.
- BäckerStraße devient un espace public inédit déterminé par des éléments issus de ses rives.
- Rathausgasse est une rue « classique éternelle »,Offenbach Straße est caractérisée par une trémie couverte avec une structure métallique recouverte de panneaux solaires.
Les préconisations du projet débordent de l’emprise de ce concours car il nous semble impossible de ne pas concevoir l’ensemble des espaces publics comme un système global et cohérent !
Le tramway : la grande boucle
Le programme prévoit de transformer l’aire de retournement de Marienplatz en une boucle intégrant la gare dans le système tram. Nonobstant la construction du futur métro nous avons pris le risque de présenter une variante appelée « La grande Boucle » pour 3 raisons essentielles :
- Ce dispositif permet une spectaculaire mutation de la Landsberger Straße,
- Il nous semble difficile d’imaginer qu’un projet de construction aussi important ne puisse être irrigué de suite par un système de transport public.
- Le tramway créera une animation sur cette longue promenade sans en dégrader sa fonction.
- La suppression de la contrainte dans la BäckerStraße permet de lui donner une qualité urbaine inédite, dans le but de rendre le centre encore plus attractif.
Nous sommes conscients que le programme du concours est le fruit d’un long travail, mais il nous semble qu’aucun des objectifs recherchés n’aient été sacrifiés et qu’au contraire ce dispositif donne de l’ampleur au projet.
La promenade
Cet espace public impressionnant par sa longueur est rallongé pour englober la place de la Gare et la station de bus dans sa structure plantée. Le nouveau bâtiment prévu devant la gare est doté d’un passage couvert reliant la station tramway aux quais bus. La position exacte du tramway dans la promenade peut être redéfinie en fonction des contraintes.
La Gleichmannstrasse
Pour augmenter la convivialité et la qualité spatiale de la rue, nous proposons de planter une rangée d’arbres côté Ouest. Aucune rupture n’est introduite dans le profil en travers. La partie circulée se distingue simplement par un autre revêtement.
La Bäckerstrasse
Cette rue large au bâti très hétérogène doit devenir la rue « branchée » de Pasing. Le jardin de l’hôtel de ville déborde dans la rue, un toit prolonge et signale le marché couvert, une station de taxis et des petits commerces réunis sous un auvent donnent à cette rue un cachet inédit. Le passage des bus et des vélos est bien conservé dans un espace où le cheminement se fait « d’un élément à un autre » et non dans un corridor bordé de façades.
Landsberger Strasse
La réduction de l’emprise du tramway sur cet axe permet une vraie mutation de son statut et de son usage. Il prend la forme d’une allée avec de larges trottoirs plantés. Le trottoir Nord accueille le tram, celui au Sud le vélo. Cet axe prend la forme d’une « place linéaire » dans laquelle la Marienplatz devient une séquence un peu plus large. Ce dispositif doit encourager une intensification commerciale dans un espace apaisé.
La ligne du projet
Nous souhaitons mettre en place une ligne sobre avec des codes d’usages clairs : un matériau pour les piétons – dallage en pierre ou béton posé à 45° – enrobé fin pour les plateformes mixtes bus/tram et pierre naturelle pour les quais. Pour les luminaires, le mobilier urbain, nous proposons une ligne moderne, sobre mais de fabrication courante. Le parti d’aménagement repose beaucoup sur les 640 plantations d’alignement. Pour l’éclairage, nous utiliserons autant que faire ce peu les façades ; la nouvelle génération de micro projecteurs permet d’assurer un confort d’éclairage avec des appareils quasiment invisibles de jour.

Esquisse de la Bahnhofsplatz
Relier Sophia Antipolis à la gare d’Antibes par un système de transport public en site propre est devenu un impératif incontournable pour le développement de la technopôle.
L’étude de faisabilité a consisté à rechercher un mode de desserte dans un parc construit sur le principe de l’anti-densité…
Dans cette étude exploratoire pour prolonger le tram-train qui était planifié entre Saint-Paul et Saint-Denis, l’équipe a inventé un concept très original dans un raisonnement systémique associant la route des Tamarins.
Réutilisation des emprises disponibles, franchissement des ponts, traversées des communes… ont été parmi les nombreux défis de cette mission réalisée dans un esprit pragmatique.
La question urbaine a été abordée sous l’angle de la densification du littoral sans reproduire les erreurs de la côté d’Azur.
L’objet de cette étude est de définir une stratégie d’aménagement pour :
- l’extension de la ligne 1 vers la Trinité
- l’extension vers Saint-Laurent du Var et Cagnes-sur-Mer via l’aéroport et le pôle d’échanges de Saint-Augustin
- l’extension dans la plaine du Var et la connexion avec les chemins de fer de Provence.
L’ensemble des extensions représente un linéaire de 5,4 km et un investissement de 193 millions d’euros maxi.

La Promenade des Anglais

Une des variantes étudiées : un tramway sur la Promenade des Anglais

Extension L1
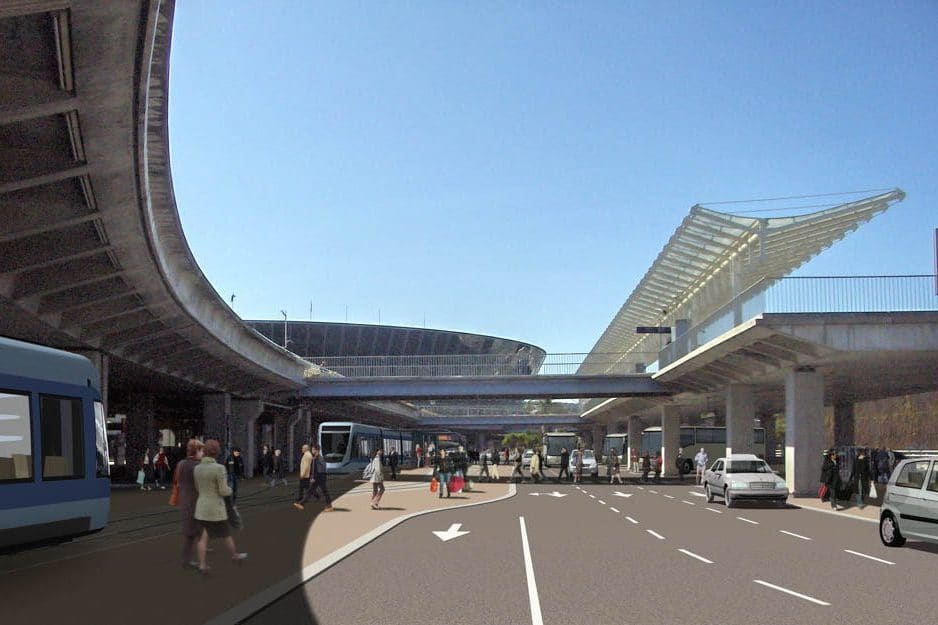
Extension vers l’ouest, via l’aéroport
Le projet dunkerquois se caractérise par la refonte du réseau pour :
- Dynamiser le centre-ville. Le projet suis les artères commerçantes les plus importante du centre.
- Doubler la fréquentation des bus avec un réseau adapté à la ville, juste et gratuit. Le nouveau réseau mettra 80% des habitants à moins de 20 minutes de la gare.
En termes d’aménagement, le projet se compose de 7 interventions majeures et d’une centaine d’interventions ponctuelles… Dans les 7 principales, la suppression de la coupure formée par la voie express est devenue l’emblème du projet.
L’agglomération de Montbéliard est multipolaire et faiblement structurée. De plus, 80 % de la population travaille directement ou indirectement dans l’industrie automobile.
Dans ce contexte, rendre un projet de transport public performant et populaire est un vrai défi !
Plutôt que d’axer le projet sur une ou deux lignes structurantes, le projet vise à monter en gamme l’ensemble du réseau. Les actions en matière d’aménagement urbain se concentrent sur quelques sites à forts enjeux, en harmonie avec le projet d’agglomération. Ces actions ciblées tendent à renforcer les centres-villes, donner de la cohésion urbaine, transformer des routes en rues…
C’est un véritable projet géographique associant très étroitement les paramètres de mobilité et d’aménagement.
Ce projet de transport en site propre vise à créer une épine dorsale aux trois principales communes de l’agglomération formant un continuum urbain.
Le parcours de la ligne 1 est ponctué de situations urbaines très variées permettant de déployer tout le registre des potentiels d’un BHNS : les voies relativement étroites nécessitent une très forte complicité entre les stratégies de circulation et les stratégies d’aménagement.
Le projet est associé à un très grand nombre de projets urbains : restructuration des Hauts de Bayonne, la gare SNCF de Bayonne, le centre-ville de Bayonne et d’Anglet, des zones commerciales, et des séquences natures.

Panorama du Quai Adour

Pont Saint-Esprit
Fidèle au travail simultané sur des problématiques d’aménagement et de mobilité, ce projet traite aussi bien d’espaces de la ville constituée que de la périphérie.
Les images montrent comment grâce au BHNS un banal échangeur a été transformé en porte urbaine et montrent comment transformer des avenues urbaines même dans des sites très contraints.
Le projet OPTYMO 2 est concentré sur des réaménagements lourds dans la ville dense pour permettre de conjuguer un projet de transport public et un projet de réaménagement urbain. Le projet de transport public est basé sur une accélération du système bus dans les zones les plus fréquentées par toutes les lignes et sur son optimisation par une meilleure visibilité des arrêts et des aménagements de qualité facilitant les correspondances bus/bus, piéton/bus/vélos, bus/VL.
Le volet « aménagement » des espaces publics du projet consiste ici à assurer la performance du mode de transport bus, tout en accentuant l’attractivité de la ville en permettant d’amplifier des actions de requalifications urbaines prévues et déjà amorcées.
Ces actions concernent essentiellement :
- La mise en valeur des berges de la Savoureuse,
- Les relations/connexions entre la vieille ville et les pôles dynamiques.
Ces aménagements privilégient systématiquement les sites propres bus, les cheminements doux et la création d’ambiances urbaines. Optymo 2 à la manière des TCSP de « l’Ecole Française » va donc profondément modifier l’espace public. Ce levier très puissant permet d’envisager des modifications substantielles sur des espaces impossibles à réaménager sans un moteur de cette nature, comme la place Yitzhak Rabin ou le quai Vauban par exemple. Par voie de conséquence, ce projet entraîne une profonde modification du schéma de circulation et permet ainsi à Belfort de s’inscrire dans un mouvement de recalibrage des usages de l’espace urbain.
Ce travail nécessite une très bonne coordination entre ville et SMTCTC car les questions de mobilité et d’aménagement sont totalement imbriquées et fédèrent l’ensemble des projets d’une agglomération cohérente et ambitieuse quant aux enjeux actuels de la ville et du vivre-ensemble…

Place de la Gare

Le retraitement d’une voie du centre ville
Le tramway sur pneus de Nancy a beaucoup fait parlé de lui et souvent de manière assez négative à cause du manque de fiabilité du véhicule.
Néanmoins la création de cette ligne de TCSP, dont l’atelier Alfred PETER a assuré la maîtrise d’oeuvre du tronçon allant de la gare au carrefour du Vélodrome, a permis de requalifier des rues de faubourgs de faibles largeurs.
Un support de ligne « art nouveau » en fonte a été développé à cette occasion en partenariat avec le designer Charles Bové de l’agence STOA.

Le tramway sur pneus

Viaduc Kennedy
Avec la ligne 1, le tramway fait son entrée dans le cœur de Toulouse. le parcours de 5 km s’installe sur trois sections aux enjeux très différents :
- Avenue Déodat et la place Emile Male : le tramway installé en site latéral est longé par une promenade cyclable plantée reliant les différents équipements scolaires
- Avenue du muret, rue typiquement toulousaine, peu large et très commerçante : un travail au centimètre a été nécessaire pour augmenter son confort et son ambiance
- Allée Jules Guesde : espace public monumental perpendiculaire à la Garonne retrouve son lustre. Suppression de trémies, de parkings de surface, nouvelles plantations pour compléter la trame très altérée ont été nécessaires pour retrouver son usage historique de grande promenade populaire.

Allée Jules Guesde

Allée Jules Guesde

Photomontage

Un site exceptionnel : tracé de la ligne B
Le rapprochement des transports publics avec les centres de grande distribution de périphérie permet d’envisager des lieux plus polyvalents et plus urbains. Le centre commercial devient un lieu avec de multiples fonctions : hébergement, restauration, culture, loisir, sport…
C’est cette mutation qu’a amorcé le projet dijonnais de la Toison d’Or en enveloppant le tramway par un geste architectural bienveillant.

Centre commercial et tramway intimement liés

Centre commercial et tramway intimement liés
Cette grande place de 2,5 hectares a, comme toutes les places dijonnaises après des remaniements successifs, plutôt l’aspect d’un carrefour / parking qu’une place.
En y positionnant le principal pôle d’échange entre les deux lignes de tramway, est né un pôle / place urbaine avec les stations de tramway sur les deux petits côtés, les bus sur les grands côtés. Le centre reste libre pour de grandes manifestations et les rives sont réattribuées aux activités de restauration.
Une fontaine socle habillant le monument Sadi Carnot, crée un point d’intérêt central permanent.

Pôle d’échange et place urbaine

Un mobilier élégant et convivial spécialement adapté au lieu

Plan masse
En sortant de la gare, le tramway attend le voyageur dans la cour parallèle au bus départementaux, aux taxis ; à quelques mètres se trouve une station de vélos.
Dans le parking sur la gare se trouve une station de voitures de location et du car sharing. Sur une très petite surface donc, on trouve l’ensemble des systèmes de déplacement dans un espace urbain de qualité.
C’est le principal tour de force de ce projet : mettre en contact tous les modes sans dispositif sophistiqué, dans une cour avec une surface limitée.

Parvis de la gare SNCF

Terminus du tramway
Le tramway de Dijon pénètre et traverse le grand ensemble en renforçant le mail central. Sa réalisation a nécessité des démolitions/ reconstructions et une remise en scène d’équipements comme : la piscine, le marché, la place de la mairie…
Ce projet de rénovation urbaine, très spectaculaire, est une bonne illustration des synergies pouvant exister entre des projets semblables et un aménagement de transport en site propre.

Doubler le mail central

Une opération de démolition / reconstruction
La place Darcy a été laminée comme bien d’autres espaces publics emblématiques en France dans les années 1960-70, par l’action conjointe des projets de circulation et de stationnement.
Ce projet conjugue trois objectifs :
- rééquilibrer les usages entre circulation et pratiques urbaines
- se confronter à l’exercice difficile du traitement d’une dalle de parking
- réintroduire de nouveaux usages grâce à la convivialité restaurée
Le Rééquilibrage des usages
Surface occupée par les voiries, trémies, voies Bus avant aménagement : 80 %
Surface occupée par les mêmes usages (hors Tram) après aménagement : 20%
Ces deux chiffres montrent à quel point la situation a changée. La circulation n’a pas été déportée sur d’autres voies mais reportée sur les anneaux périphériques du centre ville.
Les nouveaux usages
Sans doute échaudé par l’aménagement d’une autre place (de la Liberté), jugée trop minérale par la population le maître d’ouvrage a imposé la présence du végétal dans l’aménagement.
Cette expérience a conduit à traiter la place comme un sas entre ville et jardin : la taille des végétaux est progressive de l’arc de triomphe vers le parc.

Place Darcy

Détails du mobilier

Détails du mobilier

La station… et le jardin

Entre ville et jardin
La réalisation concomitante de 2 lignes de tramway a permis dans un temps record de changer considérablement la physionomie de l’agglomération. Ce projet n’est pas simplement un projet de redéfinition de l’espace public, mais un véritable projet urbain s’inscrivant dans une vision à long terme.
Des thèmes très divers ont été traités dans ce projet :
- La relation avec 3 projets ANRU
- Le réaménagement de 3 pénétrantes
- La création d’un véritable campus
- La densification des faubourgs
- La revitalisation du centre ville
- Un nouveau plan de circulation
- etc…
C’est cette « épaisseur » qui caractérise le tramway dijonnais : on peut dire qu’il est le fil du collier qui relie une quarantaine de perles.

Boulevard de Brosse Trémouille

Rond point de la Nation
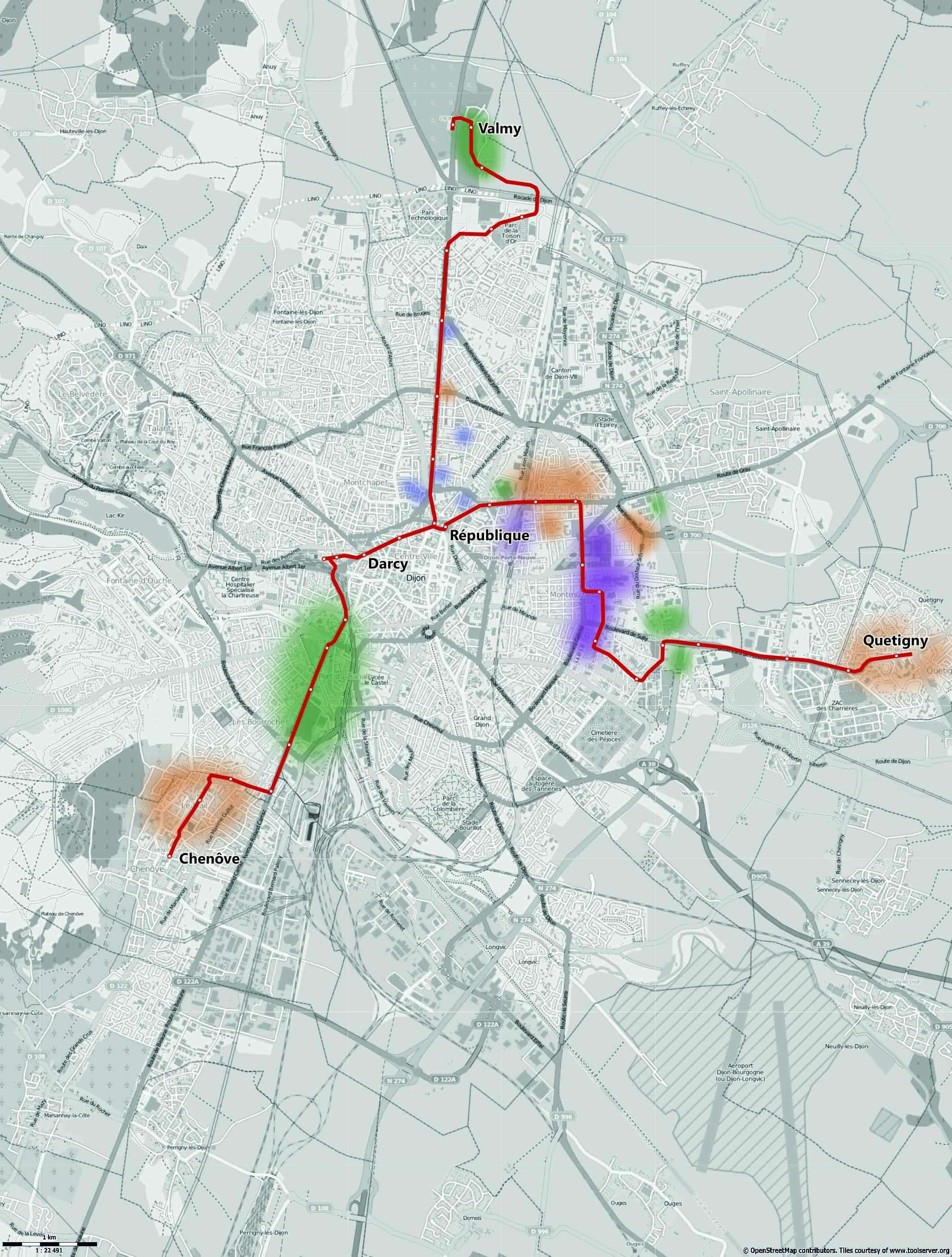
Le réseau tramway et les 22 projets connectés
Le réseau tram et tram-train de Karlsruhe compte parmi les meilleurs d’Europe.
Ce projet de ligne neuve irrigue un quartier de 5 000 logements construits après guerre par les américains.
La ligne s’inscrit dans un très beau parkway et offre quelques situations particulières comme la grande station Am Mühlburger Tor, ou le terminus dans un parc existant.

Parkway, section courante

Parkway et station
Dans le centre urbain, la plateforme du tramway peut souligner les qualités intrinsèques des rues traversées ; mais en périphérie, il est illusoire d’espérer restituer la trace des campagnes marseillaises
qui ont été systématiquement détruites.
Notre ambition est alors modeste :
- ne pas ajouter de grandes coupures
- s’appuyer sur le relief, élément permanent du site
- qualifier les entre-deux, les délaissés et les jachères
- raccorder les infrastructures nouvelles et anciennes par le moyen le plus simple et « naturel ».

Cours Belsunce

Station La Parette, soutènement par restanques

Boulevard de Dunkerque

La Canebière
Le tramway traverse une place emblématique sur la « pointe des pieds », puis emprunte des grands axes sur lesquels la circulation et le stationnement ont été fortement réduits au profit de l’activité urbaine et des cheminements doux…

Avenue de la Paix, vers la Cathédrale Notre-Dame

Place de la République et Avenue de la Paix, en direction de la Place de Bordeaux

Place de la République
Presque tous les grands ensembles des années 50-60 sont desservis par le tramway ; le positionnement et le traitement de la ligne ont permis d’engager des restructurations en profondeur…

Hautepierre : réduction des barrières

Lingolsheim : un nouveau rapport ville/nature

Désenclavement du quartier Elsau

Création d’une nouvelle centralité à Neuhof

Hoenheim Ried

Quai Bévin : une promenade au bord du canal

Passage sur le pont Zaepfel

Entrée du Parlement Européen

Quai Bévin

Palais des Droits de l’Homme

Foire exposition
Les Pôles d’échanges sont plus que des simples lieux de changement de systèmes de transport, ils sont des lieux de vie pouvant générer des « produits dérivés » : commerces, restaurant, culture…

Du tramway à la voiture à l’Elsau

Toujours la mobilité douce

Un parking perméable à l’échelle du quartier

Un parking fondu dans son environnement

Une nouvelle gare dans un ancien poste d’aiguillage

Un véritable quai à quai entre le bus et le tramway

Une signature architecturale de Zaha Hadid
Strasbourg est une ville d’eau. Le tramway croise de nombreuses fois rivières et canaux dans des contextes très différents. L’architecture des ponts, souvent couplée à des stations, est un thème très présent dans le projet. La ligne est toujours sobre, en harmonie avec le site et dénuée de gestes gratuits.

Pont de l’Elsau : deux arcs en milieu sauvage

Pont de l’Elsau : vue de la plateforme

Pont de Saverne

Pont National : reconstitution d’un pont historique dans un site « patrimoine de l’UNESCO »

Pont Zaepfel

Pont Zaepfel

Baggersee : céconstruction dun rond-point
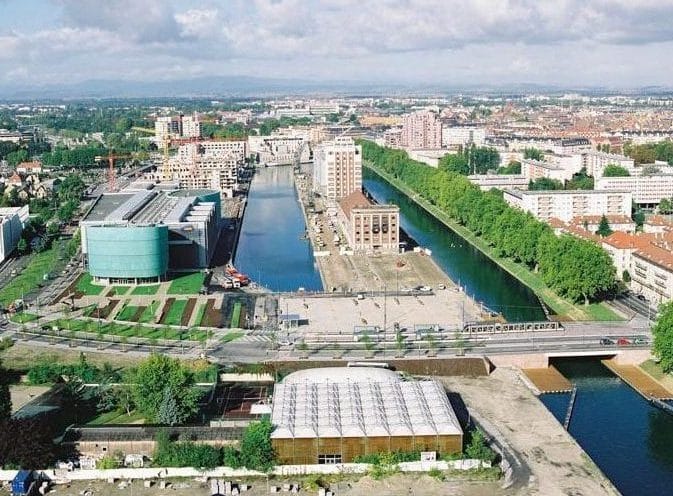
Pont Winston Churchill
La création d’un réseau de tramway donne l’occasion de repenser les déplacements urbains, mais aussi de faire un vrai travail de requalification d’espaces publics à l’échelle de toute une ville, et au-delà…

Cronenbourg : rue Marcel Proust

Montagne Verte : porte de Schirmeck

Neudorf : avenue Jean Jaurès

Neudorf : avenue Jean Jaurès

Meinau : avenue de Colmar

Esplanade : avenue du général de Gaulle

Meinau : Krimmeri

Montagne Verte : rue de l’Unterelsau
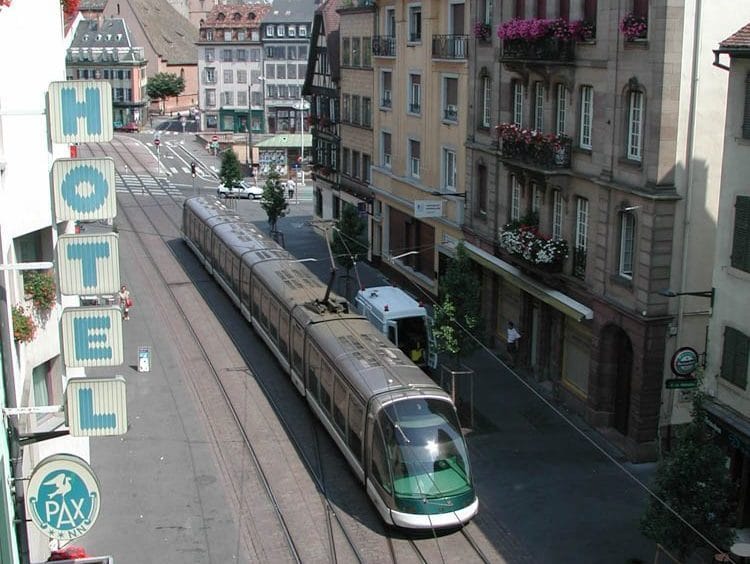
Gare : rue du Faubourg National

Gare : route de Molsheim

Boulevard de la Victoire

La station type : Shongauer

Supports optimisés
Le réseau du tramway est constitué de deux axes Nord/Sud et Est/Ouest. Ils se croisent place de l’Homme de Fer, le nœud du système.
Le principal changement avec l’arrivée du tramway dans le centre-ville a été la mise en place d’un nouveau plan de circulation empêchant physiquement le transit et augmentant de ce fait significativement les zones piétonnes.
D’abord très opposés à cette nouvelle conception de la ville, les commerçants l’ont finalement adoptée et reconnaissent que l’arrivée du tramway est une plus-value pour leur activité.

Place Brooglie

Rue du Vieux Marché aux Vins : piétonnisation de l’axe Nord/Sud

Bisccheim

Hœnheim

Station Rives de l’Aar

Reconversion d’une route à fort trafic

Requalification de l’artère principale

Centre-ville

Réseau de petits espaces publics
Lancé en 1994 par Catherine Trautmann en lieu et place d’un projet de métro automatique, ce projet de transport public en surface et en site propre a été le point de départ d’une « école française » des tramways, mariant un projet de mobilité et un projet urbain.
Phénomène très rare, l’Atelier a participé à ce projet depuis son lancement et, 20 ans après, y œuvre toujours ! Ce travail dans la durée a profondément transformé la ville et son agglomération. On peut, avec cette expérience, discerner trois phrases dans l’évolution de la pensée urbanistique autour de l’infrastructure :
L’époque « héroïque » (1994-2000)
Rejet quasi unanime du projet considéré comme un retour en arrière, une catastrophe pour la circulation, la ruine des commerçants… Le commencement a plus porté sur la légitimité du projet que sur la manière de le construire ; ce qui nous a laissé une grande liberté.
Cinq ans après, Catherine Trautmann était réélue triomphalement, ce qui fut un signal fort pour d’autres villes hésitantes…
L’époque « Espaces Publics » (2000-2006)
Avec la construction des 2ème et 3ème lignes, le projet a pris une dimension « aménagement urbain à grande échelle » caractérisée par un traitement très ambitieux des espaces publics ; le lancement de la politique des modes doux et des grands parkings-relais extérieurs.
L’époque « urbanistique » (2006-2014)
De grands projets, soit de restructuration, soit de développement urbain, sont totalement imbriqués avec les extensions du réseau. Le projet des 2 Rives, consistant à créer une ville nouvelle sur les rives du Rhin, est l’illustration parfaite de cette aventure toujours en cours. D’un projet de mobilités en ville, le projet a glissé progressivement vers la ville des mobilités.
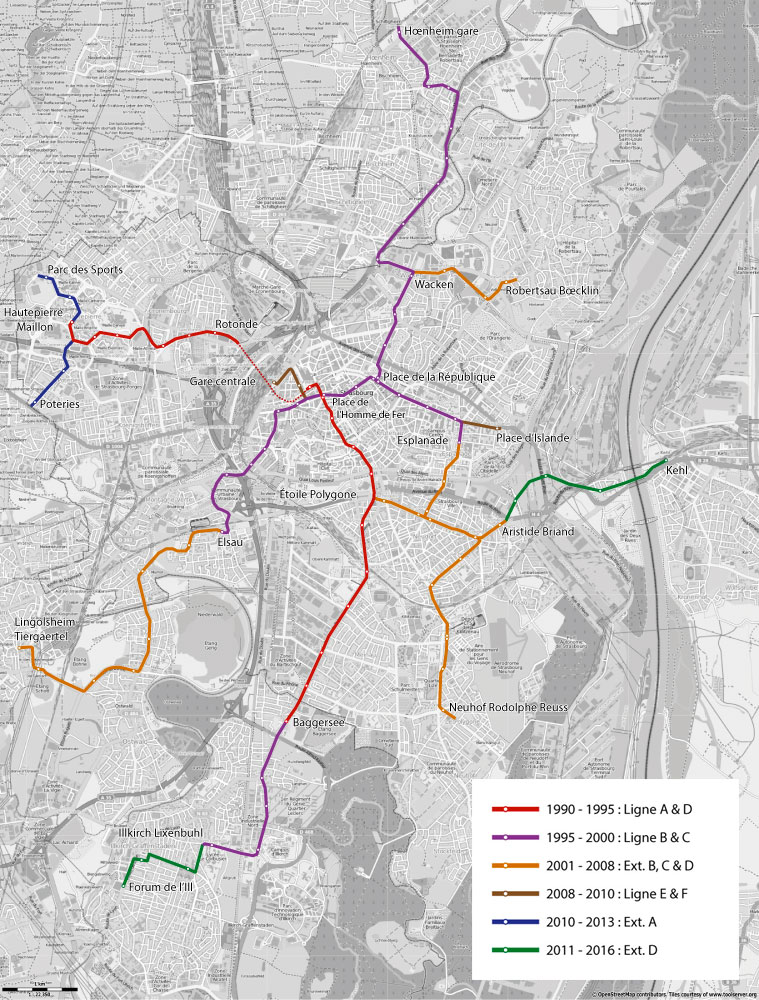
Plan d’ensemble du réseau
En 2009, VNF souhaite se dégager de sa compétence sur différents bras morts de la métropole lilloise. L’étude du Plan Bleu doit permettre de répondre à une question simple : « quel est l’intérêt pour la Communauté urbaine de prendre la compétence sur ce réseau secondaire ? »
L’étude a mis en évidence la pertinence de l’eau comme vecteur d’identité et de cohésion dans un territoire très contrasté. L’équipe propose de s’appuyer sur le réseau bleu et les voies décentralisables pour engager un projet de territoire fort autour de quatre objectifs :
- Intensifier les continuités écologiques et douces métropolitaines, de manière à créer un corridor écologique
- Améliorer le cycle de l’eau en agissant sur l’alimentation, l’assainissement urbain et la prévention des inondations
- Améliorer la qualité du cadre de vie et l’attractivité du territoire en développant les animations touristiques et culturelles autour de l’eau
- Et enfin, soutenir le développement urbain en retournant les villes sur l’eau et en intensifiant les relations eau/espaces publics/bâti.

Développer les animations d’eau : Tourcoing-Plage

Améliorer le cycle de l’eau : l’exemple des bassins filtrants de Grimponpont

Développer les continuités douces

Une esquisse a été réalisée pour chacun des segments décentralisables

Carte des bras d’eau stratégiques pour le Plan Bleu Métropolitain
La Réunion connaît actuellement une démographie galopante. Peuplée de 800 000 habitants aujourd’hui, elle devrait rapidement atteindre 1 000 000 d’habitants. Sujette par ailleurs à de grosses difficultés de circulation, la Région a choisi d’y construire un tram-train reliant Saint-Denis à Saint-Paul
en passant par la Possession.
Un tunnel constitue une grande partie de la ligne, interrompu qu’en un seul lieu, le plateau Couilloux. C’est là que la Région a choisi d’établir une ville d’environ 20 000 habitants, à dix minutes du centre de Saint-Denis. Le site grandiose surplombe l’Océan. Le tram-train le traverse sur une grande digue sur laquelle s’appuie la ville nouvelle étagée, tout en épousant le relief.

Le projet urbain sur le plateau Couilloux

Le plateau Couilloux, aujourd’hui
Le Sud de Montpellier est un enjeu majeur pour le développement de l’agglomération. Le SCOT en a défini une stratégie d’aménagement basée sur une mise en tension des vides et des pleins, sur les mutations des bâtiments commerciaux et sur l’installation du tramway sur l’axe central.
L’étude urbaine faisant suite au SCOT a permis de préciser cette stratégie, de la quantifier et de la faire « attérir ». L’avant-projet du tramway a fixé le parti d’aménagement du premier projet concret de cette grande opération d’urbanisme. Il en est la colonne vertébrale en site central, tous les grands ronds points actuels devenant caducs.
L’objectif de cette étude est de compléter le projet tramway par des propositions d’aménagement concernant le traitement des rives de l’avenue et des principaux axes perpendiculaires ; et le retraitement du carrefour des Levades, point très important dans cette stratégie de reconversion. Une étude de déplacement tous modes concomitante, a permis d’affiner les conditions minimales en terme d’aménagement pour créer un système de transport cohérent.
La question des temporalités des différentes propositions a été évoquée. Un certain nombre de propositions semble nécessaire à la mise en service du tramway en particulier les aménagements autour
des stations. L’étude d’urbanisme lancée par la SERM devra préciser les maîtres d’ouvrages et le financement de ces aménagements.

Un aménagement prospectif ambitieux
L’arrivée du tramway clermontois dans le Nord de l’agglomération, et la rénovation des quartiers de Champratel et des Vergnes provoquent à proximité du stade G. Montpied des transformations urbaines profondes.
La volonté d’agrandir le stade entraine une réflexion sur son accessibilité et sur son rôle à jouer dans les transformations urbaines actuelles.
En s’appuyant sur la création d’un pôle d’échange bus/tram, nous proposons une réflexion plus large sur l’accessibilité du stade et les quartiers voisins ainsi que sur l’articulation à créer entre la Plaine agricole toute proche et cette zone grands équipements en devenir.
Le canal pour tous
Le principal atout de ce site rectangulaire est le canal du Rhône au Rhin qui constitue une limite exceptionnelle sur un des grands cotés. En faire jouir au maximum les futurs habitants est notre premier objectif. Le canal est une valeur sure et possède une forte identité. Les futurs immeubles sont implantés de telle manière à profiter au maximum de cette valeur naturelle et patrimoniale.
À contrario, les usagers du canal, qui seront beaucoup plus nombreux après l’ouverture de la liaison directe avec Colmar (réouverture du tronçon de l’ancien canal entre Artzenheim et Friesenheim) profiteront eux aussi de l’offre spécifique du bassin et de la qualité de ses espaces publics. Canal et masses bâties doivent s’agréger pour créer un ensemble indissociable. Une promenade publique éclairée au pied de la digue de halage permet à chaque immeuble de communiquer avec cet espace public de qualité.

La gare d’eau au cœur du quartier
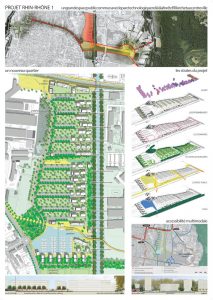
Un grand espace public commun avec le parc technologique relié à la forêt d’Illkirch et au centre ville
La plateforme d’activités vitrine du développement durable « made in Bas-Rhin »
Le développement durable est un critère transversal qui se traduit dans notre proposition dans plusieurs domaines :
- Au niveau de la mobilité : l’organisation de la plateforme permet de desservir discrètement plus de 50 % des entreprises. D’autres embranchements sont possibles pour d’éventuelles extensions. Le dispositif permet aussi l’accès au fer d’entreprises extérieures à la zone. L’intégralité des parcelles est reliée à un réseau de cheminements doux dont la colonne vertébrale est formée par une piste cyclable qui pénètre
dans la plateforme par l’espace vert central. Le confort des cheminements piétons est aussi très soigné et ils sont tous déconnectés des routes. - Au niveau du traitement de la qualité du paysage : le traitement des eaux pluviales est totalement aérien et constitue l’armature paysagère du projet. Le système constitue une trame verte puissante aussi bien dans le sens Est/ Ouest que dans le sens Nord/Sud et estompe fortement la présence des volumes imposants des bâtiments. Notre objectif n’est pas de cacher la plateforme mais de soigner les premiers plans et de valoriser l’horizon dominé par la silhouette des Vosges.
Une figure ouverte, rationnelle et souple
Notre plan d’aménagement est dans la continuité de la tranche 1 en la perfectionnant. Les deux routes de desserte interne sont prolongées jusqu’à la nouvelle route de connexion à l’autoroute. Il se crée une forme de « ring » permettant des configurations multiples en terme de découpage foncier. Nous n’avons éprouvé aucune difficulté à simuler les trois scénarii proposés dans le programme ni à y intégrer la voie ferrée. C’est une figure ouverte permettant d’éventuelles extensions de manière « naturelle » dans toutes les directions.
Deux aires d’accueil sont disposées aux jonctions entre la future voie d’accès principale et les voies de
desserte interne. Les bâtiments de services structureront deux espaces publics, lieux de rencontre des
usagers de la plateforme et le monde extérieur. Chaque placette comporte 6 emplacements pour poids lourds, un grand totem signalétique permettant de trouver sans sortir du véhicule sa destination finale.

Plan masse d’ensemble

Plan masse d’ensemble
Suite à l’arrêt de l’exploitation minière, la Communauté de Communes de Freyming-Merlebach s’est engagée dans un processus de reconquête des anciennes emprises des Houillères du Bassin de Lorraine. Ces emprises sont une opportunité de développement pour le territoire de la Communauté de Communes et de restructuration urbaine pour la ville de Freyming-Merlebach.
La Communauté de Communes a ainsi décidé de réaliser une opération d’aménagement de type Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC) sur le secteur de la vallée de la Merle. Cette ZAC, d’une superficie
de 50 ha, est à vocation d’habitat, d’équipements et d’activités.
Conformément au SCoT du Val de Rosselle, le projet a pour objectif de densifier, de donner un nouveau visage au centre de la commune de Freyming-Merlebach, de trouver une réutilisation aux grandes friches industrielles et de renforcer les transports publics.
Dans le centre-ville, les rues principales seront doublées de promenades plantées accueillant les cheminements doux et des plantations généreuses.
Le « corridor vert » s’étirant de la carrière à la rue du Maréchal Foch fera l’objet d’un soin particulier car il constitue un espace au potentiel paysager et biologique exceptionnel.
La renaturation de la Merle et le système de conduite en surface des eaux pluviales font partie intégrante du projet paysager. Plusieurs opérations s’intègrent dans cette trame «nature» :
- Création d’un écoquartier sur la zone du parc à Bois : opération d’habitat individuel avec de grandes parcelles
- Site de Vouters : mise en valeur paysagère avant de trouver une fonction potentielle.
- Voies VFLI : prolonger la zone artisanale avec équipements et habitat.

Plan masse du projet

Vue aérienne du site
Le rectangle magique
Sochaux se transforme… Le concept de rectangle magique est un nouveau cadre «marketing» pour le
centre-ville. Il sert à insuffler à la ville une nouvelle énergie. Le rectangle révèle des pépites enfouies dans le méli-mélo urbain (église Sainte-Croix, école du Centre, musée Peugeot…).
Ses deux grands côtés sont le futur boulevard Peugeot, qui relie Sochaux à Montbéliard et l’avenue du Maréchal Leclerc, l’axe principal du centre-ville. Le nouveau quartier doit apporter du corps à ce projet pour assurer la masse critique minimale du fonctionnement d’un pôle urbain.Le nouveau quartier fabrique un premier segment de ce lien. Même si son tracé n’est pas encore acté hors ZAC, il est indispensable d’avoir une vision précise de son tracé futur pour prendre les bonnes décisions pour la ZAC. Il peut se réaliser de façon graduelle mais c’est autour de cet axe qu’est organisée une relative densité. Ce tracé, s’il est retenu, nécessitera probablement une adaptation des limites de la ZAC dans la partie Nord du projet. L’avenue est à quatre voies jusqu’à l’église ; elle accueille le BHNS. Puis le bâti s’y accroche et crée le resserrement. L’église et les bains douches sont mis en valeur par des parvis généreux.
Le nouveau quartier de logements doit répondre aux besoins des familles et rester dans des coûts accessibles. La densité sera dégressive du boulevard Peugeot vers le Sud.
Le long du boulevard Peugeot, les rez-de-chaussée commerciaux tiennent la voirie. Au sud des collectifs, des îlots lâches accueillent de l’habitat groupé qui bénéficie de jardins et terrasses. L’ensemble d’habitat intermédiaire est desservi par un réseau de voiries internes partagées, où la voiture a une vitesse limitée et où les usagers (piétons, cycles et automobiles) se croisent. Dans la partie sud du terrain, des villas regroupant 2,3 voire 4 foyers sont installées librement dans un jardin. L’ensemble forme une propriété dans laquelle toute liberté est laissée pour stimuler la créativité architecturale. Des projets d’autopromotion et des modèles de cellules préfabriquées pourront se côtoyer avec comme seule règle de se distinguer au maximum de son voisin !
La première étape du projet sera la mise en valeur paysagère du site. Elle se fera en cassant l’enrobé pour laisser apparaître la prairie. D’autre part, l’église sera révélée par une stratégie lumière. L’éclairage
mettra en exergue l’œuvre de Marcel Lods, aujourd’hui oubliée dans un carrefour routier.

Perspective

Vue oblique de la prairie

Plan masse de la phase 3
Cet ensemble typique de l’architecture sur dalles des années 1970, est vieillissant alors qu’il bénéficie d’une situation exceptionnelle et stratégique. Le site constitue un espace monumental qui tourne le dos à la ville. L’objet de ce projet est de le faire évoluer pour mieux l’intégrer dans le quartier, pour mieux le desservir par les transports en commun. Le vaisseau amiral du centre-ville doit retrouver son attractivité commerciale, touristique et culturelle à travers une opération complexe pariant des opérateurs privés et publics.

La face sud du centre restructurée

La face nord du centre restructurée

Le scénario
Le site d’Eurasanté fait partie des projets majeurs de l’agglomération de Lille. Ce cluster autour du thème de la santé permet de développer une expression de la «ville intense» en périphérie. Il croise des questions liées au rapport ville/nature, aux mobilités et à une programmation originale.
La mission confiée au bureau d’étude consiste à élaborer un master-plan réunissant les nombreux acteurs du site (CHR, campus, SORELI…) autour d’une stratégie consensuelle…

Vue aérienne
Cette plaine fut dès le XIXème siècle occupée par les mines et les industries liées. Avec la disparition de bon nombre de ces activités, elle a accueilli à partir des années 60 de nombreux équipements. Leur implantation anarchique et la logique du tout automobile ont fait de ce lieu, un espace extrêmement dur à parcourir.
Le projet vise avant tout à libérer le sol autour de ces équipements et revendique la notion de lieu unique. Par ce travail de libération du sol, la Plaine établit un nouveau rapport avec l’ancienne Manufacture d’armes reconvertie en pôle d’enseignement et de loisirs largement orienté vers le design, dont la cité toute proche est le fer de lance.
Les principes fondateurs :
- Accepter et valoriser la différence de ce site extraordinaire. Surtout ne pas le banaliser, d’une certaine manière : surtout ne pas l’urbaniser !
- Poser les bases spatiales d’un projet politique local susceptible d’inventer un projet de vie quotidienne en appui sur les compétences et les qualités locales et de catalyser le foisonnement créatif entre acteurs publics et privés.
- Produire un quartier de ville, c’est-à-dire un quartier de vie inédit, fort d’un programme exceptionnellement engagé dans le développement durable.
- Offrir des lieux publics ouverts à l’usage de tous pour inviter le festif et le partage, l’inattendu.
- Installer les conditions du partage d’une exigence écologique, sociale, culturelle et économique qui portera le projet tout au long de sa conception ultérieure et de sa réalisation.
Pour y parvenir, nous proposons un projet urbain qui n’aurait jamais le dernier mot. Nous ne pouvons pas imaginer de refermer par notre travail l’éventail des possibles offert par La Plaine Achille, fédératrice de tous ses alentours.
À partir du creux de La Plaine Achille comme rare événement urbain susceptible de fédérer un avenir, nous avons construit notre proposition stratégique, à la fois spatiale et temporelle, sur trois dispositifs fondateurs permettant d’opérer dans la longue durée :
- Reconnaître l’existence d’un Forum : sur une surface de 25 ha (qui peut s’étendre vers le Nord), un ensemble d’objets célibataires et hétérogènes crée une ambiance de « Tivoli ».
- Poursuivre le tissu existant jusqu’aux bords du Forum, affirmer le caractère ouvert de ce dernier et établir les transitions avec les quartiers riverains.
- Diffuser l’espace public sur un mode quotidien : dans notre proposition qui vise à reconnaître les disparités, les différences, les richesses dissemblables du site.
C’est l’espace public qui crée la cohérence, équilibre les usages en satisfaisant à la fois les besoins de la vie quotidienne et les manifestations évènementielles grandes et petites.

Photomontage

Stratégie spatiale
De la déconstruction d’une infrastructure autoroutière à un quartier de ville :
– Métamorphoser un pan de ville demeuré longtemps sous l’emprise de l’automobile en un quartier vivant, à l’échelle des usagers.
– Réorganiser les flux de circulation pour redonner un rôle central aux espaces publics et articuler patrimoine historique, ville moderne et opérations contemporaines.
– Créer un quartier de ville cohérent à partir de pièces bâties très hétérogènes
– Répondre à la très forte attente d’un espace de nature dans un quartier et une ville en déficit chronique.
Forte démarche environnementale :
– Simplicité, et durabilité de l’aménagement des espaces publics (matériaux simples et éprouvés, végétation rustique …)
– Création d’un parc « sobre » : terrassement minimum, utilisation de blocs de calcaire ‘rebuts’ de carrières et de dalles monumentales en réemploi, création de masses arborées denses à l’ombre généreuse à partir d’essences méditerranéenne, arrosage très limité.
Dans un contexte très urbain, la moitié de la surface de la ZAC est arborée et près du quart de la surface est traitée en sol végétalisé.

Place Jules Guesde

Au cœur du grand jardin

Plan masse du projet
Conception d’un parc d’activités dans une plaine agricole pour une superficie de 200 ha. Le projet tisse
des liens très étroits avec la nature, grâce à un système hydraulique en surface très élaboré et avec le transport urbain, l’axe central étant réservé au transport public.
La disposition des bâtiments répond à une règle d’intensité allant decrescendo de l’axe vers les limites. La base de l’élaboration du plan de masse ressort des 3 dialogues suivants :
dialogue avec les infrastructures / dialogue avec le bâti / dialogue avec la nature.
La qualité environnementale du projet découle de 13 objectifs, dont les principaux, issus des 3 dialogues, sont :
- optimiser les déplacements et favoriser les transports les moins polluants
- aménager en relation avec l’environnement urbain : riverains, cohérences architecturales, santé, etc…
- aménager en relation avec l’environnement naturel et les paysages : les principes d’aménagement du parc tendent vers un parc environnemental inséré dans son milieu appuyé sur les éléments naturels préexistants (haies, fossés, arbres isolés, trame parcellaire…).
Le choix s’est porté sur une forte proportion d’espaces paysagers publics les uns à tendance naturelle (les corridors Est-Ouest et les franges) et les autres à conception plus urbaine et structurée (les voies), afin de ne pas contraindre à des espaces verts privatifs qui ne sont pas toujours bien traités. En effet les professionnels ne sont pas toujours soucieux de la qualité de leurs espaces extérieurs, même si en terme d’image cela peut paraître important, leur objectif premier reste légitimement la bonne marche de leur activité économique. De plus, eu égard à la rationalisation de l’utilisation de l’espace dans un souci de développement durable, il aurait été surabondant à la fois d’avoir un espace public généreux et de qualité paysagère, et d’imposer dans un article du règlement de la zone AUE un minimum d’espaces verts.

Dialogue avec la nature

Plan masse du projet
Un quartier qui préserve et économise les ressources naturelles…
Gestion de l’énergie : par des constructions aux standards passifs ; par le recours à l’énergie solaire ;
par le recours complémentaire au réseau de chaleur urbain alimenté par des sources performantes.
Gestion de l’eau : par la récupération des eaux pluviales ; par la filtration naturelle des excédents avant rejet en Seine
Économie de matière : en construction légère utilisant en particulier des matériaux renouvelables et à faible contenu énergétique
Un quartier à vivre…
Qualité de vie : circulations apaisées et partage de l’espace, valorisation de l’eau des berges, espaces protégés du bruit.
Implication dans la gestion et pérennisation : gestion collective découlant de la recherche des échelles de pertinence environnementale des diverses techniques (réseaux, solaire photovoltaïque) et d’une mise en commun des moyens.

Le jardin filtrant et la plage verte

La plage verte, inondable depuis le quai haut

Usage du sol : un tiers d’espaces verts pour les berges et le jardin, un tiers d’espaces publics plantés pour les rues et un tiers de bâti
La ZAC Berthelot, opération privée de 800 logements à Lyon, est un projet ayant pour objectif de décliner une haute densité avec de la mixité, une ligne de tramway (T4) qui passe dans son cœur et un rapport aux espaces extérieurs extrêmement soigné.
L’atelier Alfred PETER a participé à la conception générale du quartier et a suivi le chantier d’aménagements paysagers.

L’espace central îlot 1 est composé d’une coursive au niveau R+2 et d’un jardin destiné à infiltrer les eaux pluviales.

Plantations de l’îlot central
Ce site aux portes de Strasbourg, offre une localisation idéale pour une Plateforme Départementale d’Activités : au sein d’un maillage équilibré de 6 plateformes dans le département ; en position de carrefour routier/autoroutier bordé d’une voie ferrée ; dans un environnement faiblement contraint ; au cœur d’un bassin d’emploi important, dans un territoire en développement démographique.
À travers la création d’une zone d’activités de grand ampleur, le Conseil Général vise à rationaliser et gérer de manière économe l’offre foncière ; d’inscrire le développement économique dans une démarche de développement durable et d’équilibre des territoires ; d’organiser une solidarité fiscale entre les Communautés de Communes concernées ; d’assurer un accompagnement technique et financier renforcé auprès des acteurs locaux dans une logique de qualité.
Le site du futur quartier des Planches est un très beau terrain en pente douce entre la frange de la ville et la forêt de Chailluz. La géologie karstique très particulière, la présence d’agriculture et de forêts permettent d’esquisser un fragment de ville dans lequel la morphologie de la ville est dessinée par les « vides » qui l’entourent.
Sept micro-quartiers viennent s’agréger autour des dollines ; un tiers du terrain reste agricole, et cette agriculture aura un rôle de premier plan dans la configuration d’ensemble des quartiers.
La conservation d’une zone significative (environ 20 ha) en agriculture urbaine est une composante originale et innovante. L’exploitation actuelle des terrains essentiellement en prairies de fauche par des exploitants âgés nécessite pour pérenniser cette activité, l’installation d’un ou deux nouveaux exploitants. La partie Sud de la zone agricole serait plutôt destinée à du maraîchage, le reste du territoire serait utilisé par une exploitation polyvalente tournée vers l’élevage et utilisant les prairies comme lieu de pâture.
Cette zone agricole au cœur du quartier serait ouverte à des pratiques urbaines : sentiers de promenades entre les microquartiers, vente directe des produits de la ferme, voire un fonctionnement de type ferme-auberge urbaine.

Trame verte
La pensée urbanistique a bien du mal actuellement à produire de la surface bâtie de grande qualité urbaine. Face à cette faiblesse endémique, nous avons pris le parti de concentrer les bâtiments autour d’un espace public, renouant avec la tradition des places vertes d’entrées de ville.
Chaque bâtiment peut fonctionner de façon autonome, sans que l’on minimise pour autant l’importance du travail architectural.
Nous limitons l’impact du trafic en le réorganisant et en l’enserrant dans de grands arbres. Le nouveau bâti prend place autour du parc.
L’espace libéré est attribué aux piétons : l’articulation entre le quartier du Neudorf et le centre ville se fait naturellement, par l’esplanade plantée qui draine les petites rues du quartier puis le parc qui amène au centre ville.

Perspective de la Place de l’Étoile
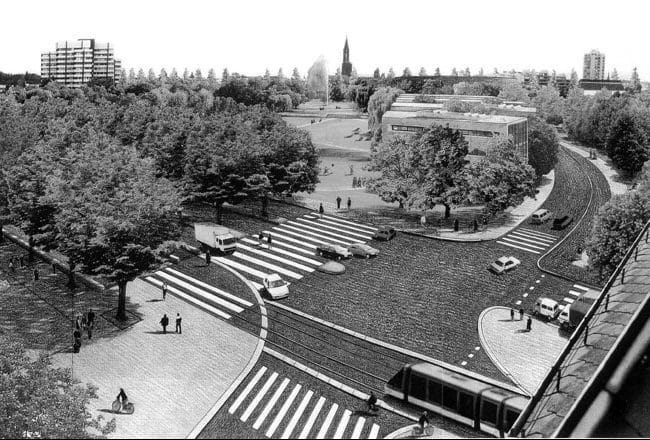
Place de l’Étoile, vers la cathédrale
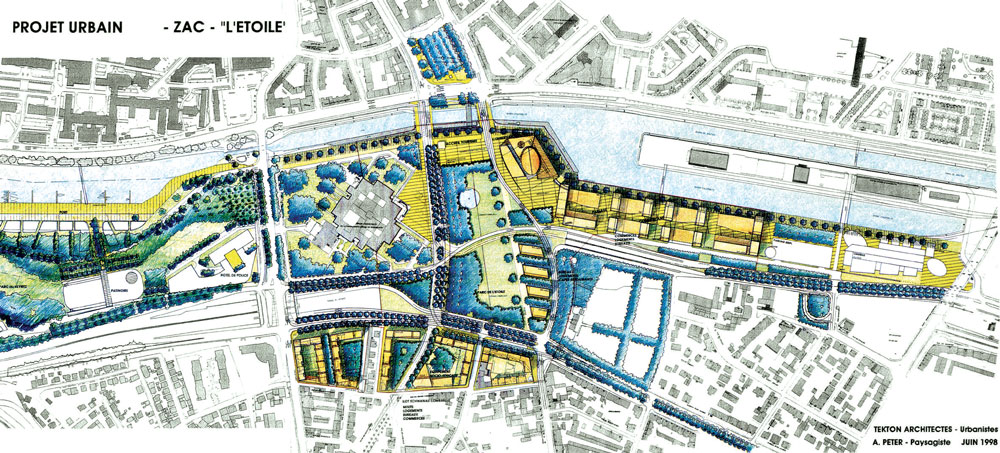
Plan masse
Un terrain de 2,5 ha au bord du parc de l’Orangerie extrêmement convoité, est urbanisé avec un programme essentiellement tourné vers le logement haut de gamme.
Le projet aujourd’hui réalisé, prolonge et articule le site aux éléments environnants : le parc, la cité jardin et la ville dense.

Plan masse

Vue du projet réalisé

Vue du projet réalisé

Vue du projet réalisé
Faut-il densifier Euralille?
C’est la question qui se pose, et sur laquelle nous menons notre réflexion aujourd’hui.
En effet, c’est grâce à la forte inventivité de Rem Koolhass dans les années 90, qu’Euralille 1, avec sa morphologie urbaine «capable», va pouvoir engager sa mutation. Les transformations projetées vont dans le sens de la densification. Une étude globale est menée, afin de permettre et faciliter l’accueil de nouveaux programmes, de créer de nouvelles liaisons, de générer de nouveaux usages, en sommes de
renchérir le potentiel des lieux. C’est sur cette aptitude à «s’intensifier», qu’Euralille +++ va fonder ses jalons pour bâtir voir surbâtir, redéfinir les espaces publics, améliorer les systèmes de déplacement avec entre autre l’arrivée projetée du tram-train.
Deux échelles d’intervention se croisent , l’une globale qui accroît la figuration symbolique et économique d’Euralille au cœur de «l’Eurorégion»; l’autre plus locale, visant à rendre lisible et efficace les accès aux différents programmes existant et à venir.
Euralille +++ légitime la place des piétons et des modes doux de déplacement, au cœur des différents
programmes et propose d’animer la scène urbaine et à redonner son intensité à la vie de quartier.
Ce projet envisage l’usage sous toutes ses formes (visiteur, voyageur, spectateur, consommateur et habitant) et propose de nouvelles circonstances aptes à réconcilier la ville compacte.
Euralille+++, c’est une stratégie d’intensification en 7 actions :
- Fusionner les gares d’Euralille et de Lille-Flandres pour inventer EURAFLAN DRES (hub métropolitain).
- Garantir la fonction habitante d’Euralille en ajoutant 1000 logements.
- Consolider le centre d’Euralille comme vecteur de dynamique urbaine.
- Concevoir un espace public à sol continu.
- Réorganiser les systèmes de déplacement pour faciliter l’intermodalité.
- Prolonger la nature en ville en créant un réseau de parc urbain.
- Créer de l’Extraordinaire, l’art urbain comme outil pour façonner l’espace public.
….Euralille +++ sera en activité continue à tous les moments du jours et de la nuit, avec une intensification en espace et temps digne d’une métropole.

Photomontage
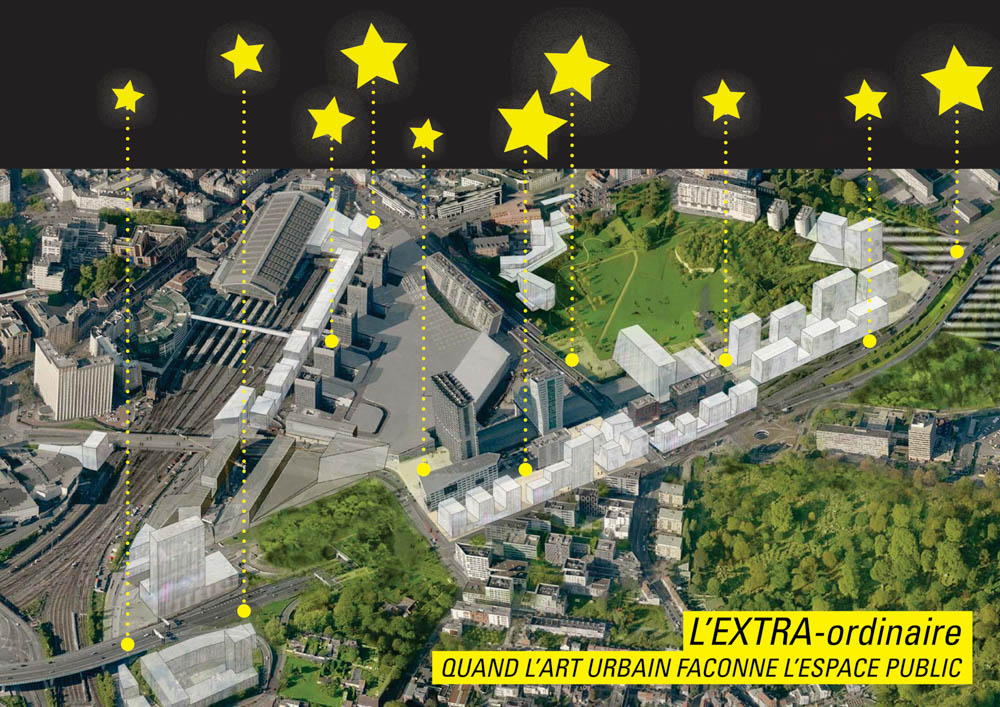
Photomontage
Le quartier de la Cité Descartes peut préfigurer la ville de demain, ce qui est moins une question de style qu’un renouvellement de l’éthique qui a présidé aux fondations humaines. Ce qui est en jeu c’est la transformation des raisons fondamentales qui nous font édifier des villes, pour accueillir aujourd’hui plus de la moitié de la population de la planète, vivant demain forcément plus près les uns des autres.
Sur le « Cluster Descartes » l’opportunité d’une action immédiate est fondatrice : elle semble devoir être facilitée par la volonté publique certes, mais aussi et surtout par les très bonnes facilités territoriales qui reposent sur un foncier disponible et s’appuient sur la fondation de la ville nouvelle il y a environ quarante ans pour en prolonger le parcours. Ce qui est intéressant à Marne-la-Vallée tient dans la qualité de la géographie encore largement exploitable, son rôle évident dans l’agglomération parisienne et sa programmation emblématique d’une nécessaire refondation.
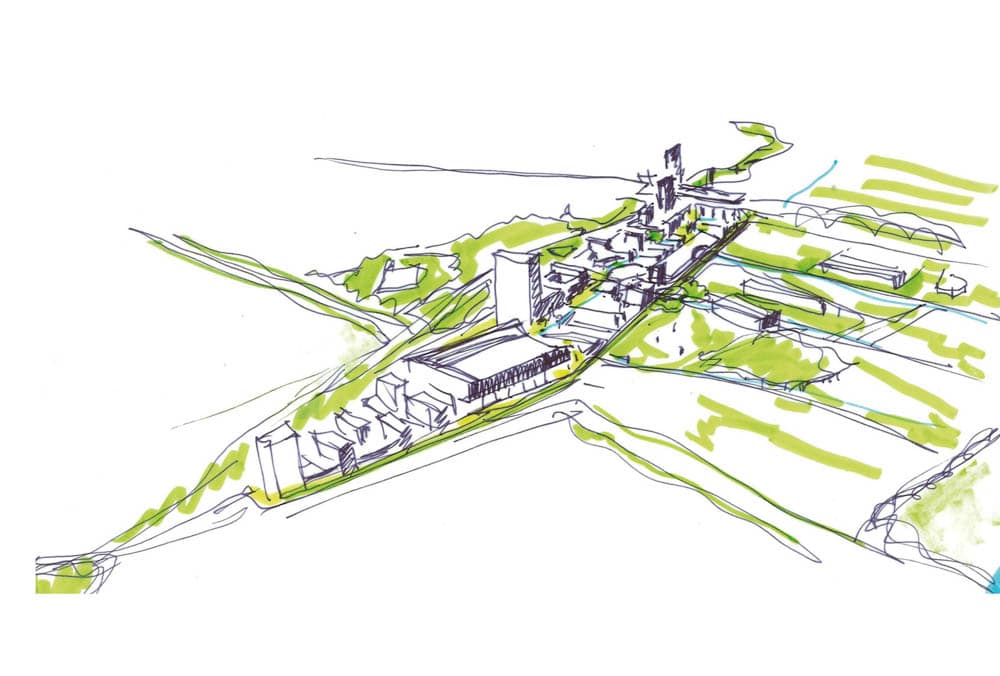
Infrastructure, ville et nature : une entité transversale forte

Perspective
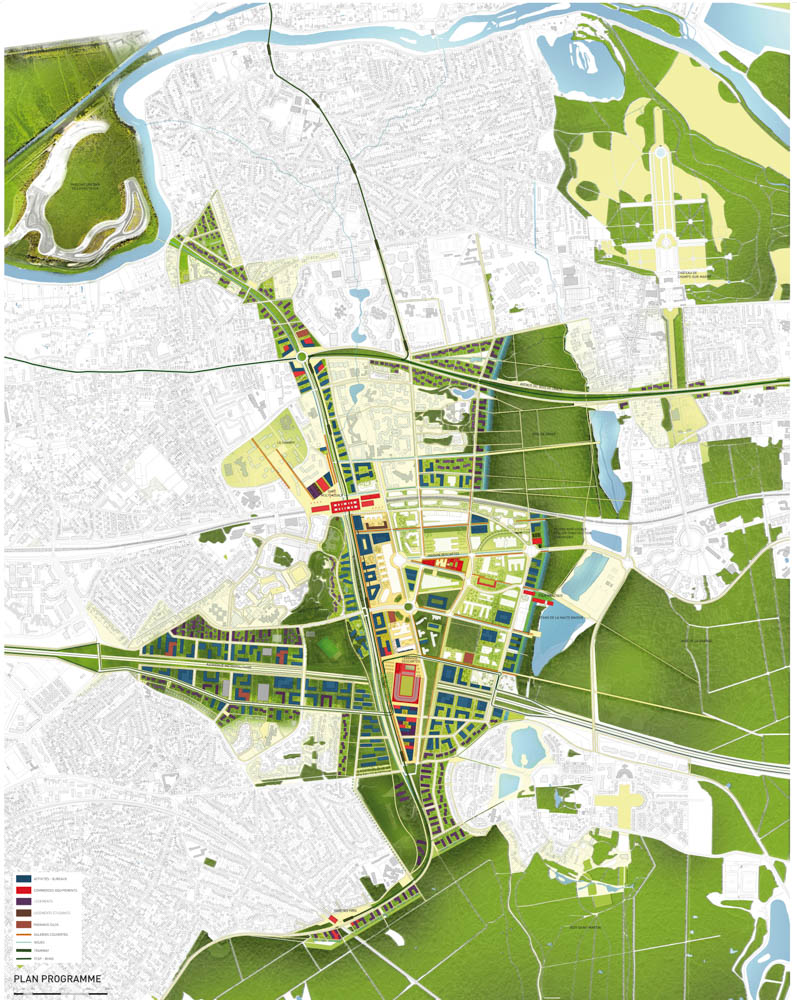
Plan masse du projet
Le projet ODE A LA MER est une application concrète du SCOT réalisé avec Bernard REICHEN sur un territoire d’environ 1 000 ha situé au Sud de Montpellier. C’est un projet d’ « Écocité » basé sur la déconstruction/reconstruction d’une zone commerciale constituée d’une des plus grandes collections de « boîtes à chaussures » alignées le long d’une route à 4 voies ponctuée de plantureux ronds-points.
Ce projet, situé dans une zone très vulnérable aux inondations, est fondé sur un « projet nature » essentiellement hydraulique. Une trame bleue très généreuse circonscrit les nouvelles limites urbanisables et les qualifie.
Ce projet hydraulique, basé sur des études techniques très poussées, démontre comment faire de la ville avec une contrainte forte qui s’exprime en termes de projet et non de règlement. Vivre avec la menace doit démontrer qu’il est possible de ne pas opposer Ville et Nature, mais au contraire que les contraintes de l’une créent les conditions du renouvellement de l’autre.
Ce projet induit de nouvelles formes urbaines construites sur un « plan des bords » totalement inédit. Ces nouvelles formes urbaines d’une ville éclatée en de multiples polarités denses et différenciées permettent une autre manière de vivre avec les avantages de la ville (proximité des services et des commerces) et de la campagne (pratique des loisirs, se sentir en vacances chez soi…).

Le SCoT de Montpellier : le projet Nature fondement de la ville compacte

L’inversion du regard

Perspective du projet
Haut lieu de recherches, d’activités et d’éducation installé dans un environnement méditerranéen boisé et vallonné remarquable, Sophia Antipolis est une ville introuvable.
Ce sentiment est lié à un système d’accessibilité sans repères, fortement congestionné et entièrement voué à l’automobile, qui tend à isoler la technopôle et devient un obstacle à la vie sociale. La spécificité d’un site exceptionnel disparaît et l’avenir de la technopôle paraît fragilisé.
Pérenniser l’avenir de la cité scientifique
Seul un réseau performant de déplacements collectifs et doux permettra d’inscrire Sophia Antipolis dans son époque. L’équipe Reichen/Peter a donc imaginé un tracé de BHNS pour créer de nouvelles conditions d’accessibilité à la métropole et permettre le développement de la cité dans 4 pôles de vie complémentaires mis en réseau : Trois Moulins, le Fugueiret, la Cité du Savoir et les Clausonnes.
Inverser le regard : de la protection à la valorisation d’un cadre naturel d’exception
Que ce soit au titre des Espaces Boisés Classés ou de la protection contre les feux de forêt, la quasi-totalité des terrains autour de la boucle du BHNS est concernée par des mesures de protection… qui tendent à les figer dans un état médiocre.
L’ambition du projet urbain appelé à se développer autour du transport en commun nécessite d’inverser le regard : ces espaces de nature se situeront désormais au cœur des 4 pôles de vie auxquels ils devront donner le change.
En relais des Parcs Naturels de la Valmasque et de la Brague, il s’agit de créer un 3° parc départemental afin de porter la grande couronne verte Sophipolitaine à plus de 1500 hectares.
En renforcant le mailllage des cheminements doux, le Parc départemental du Fugueireit doit devenir un connecteur actif entre les 4 pôles de vie périphériques. Le développement des activités sportives et de détente sur ce grand coeur de Nature permettra d’asseoir l’attractivité d’un campus de renomée internationale.

La Cité du Savoir : le campus de la Côte d’Azur
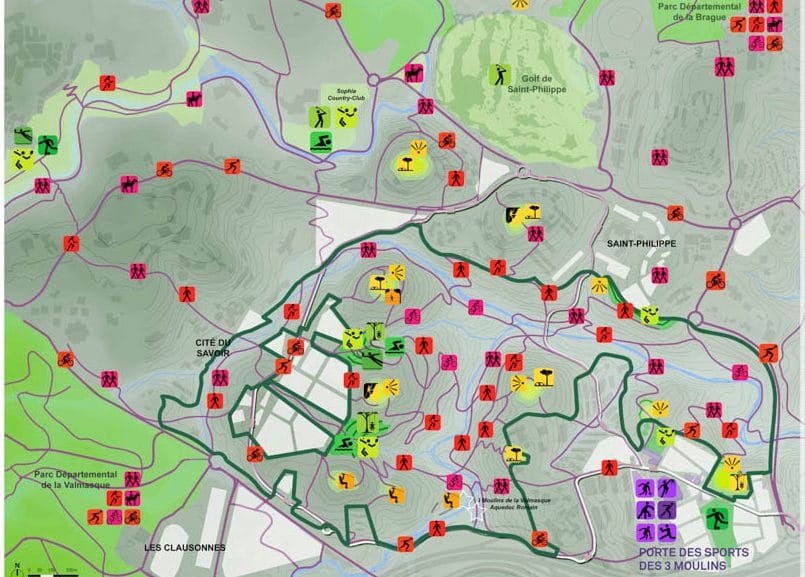
Le Parc Départemental de loisirs et de Nature du Fugueiret

Développer quatre pôles de vie autour de la boucle du BHNS
Faire de la prospective urbanistique en 2013 est un exercice aléatoire car le contexte est durablement marqué par un avenir incertain.
Contrairement au schéma directeur élaboré dans les années 90, très orienté vers une croissance assumée, le prochain doit anticiper sur de nouvelles aspirations à la fois déterminées par la crise économique et l’inévitable ascension des valeurs du développement durable.
À la mosaïque des ZAC doit répondre un projet de ville revenant sur ce qui existe, en y introduisant du développement, de la sociabilité, du beau…

Zone d’aménagement concerté des Tuileries et BHNS

Passerelle pour piétons et vélos au-dessus de la Moselle

Réaménagement de la rue Roosevelt

Création d’un boulodrôme
Un projet urbain, portuaire et territorial
La réalisation d’un nouvel ensemble urbain entre les récentes opérations strasbourgeoises de Danube, Bruckhof et Aristide Briand et la gare de Kehl constitue un enjeu stratégique pour la collectivité et l’Euro District. En effet, le cœur du site d’étude du schéma directeur forme le nœud d’échanges du port autonome. Il ne s’agit donc pas d’une reconversion urbaine en terrain neutre mais de résoudre une équation complexe entre un équilibre économique portuaire à maintenir, voire à développer, et un renouveau urbain qui doit profiter d’une localisation exceptionnelle au cœur de l’Euro District, le long du tramway et à proximité des horizons ouverts des voies d’eau.
Le paysage, premier vecteur des continuités urbaines
Le parc des deux rives a contribué à révéler le grand paysage Rhénan, autrefois mal connu et peu pratiqué par les habitants. Ce paysage va maintenant être traversé et découvert d’Est en Ouest par le fil du tramway et des circulations douces.
La réalité d’un espace ouvert associé à l’eau s’impose comme l’élément structurant du milieu normal habité qui va s’installer ici. On peut le voir aussi comme le contrepoint des espaces fermés de la ville centre : l’horizon prime sur la perspective.
En complément de l’intensité générée par le bâti, nous devons inventer une « intensité verte » servant d’écrin à la nouvelle urbanisation.
L’idée d’un « travelling » associant forme urbaine à son processus de mise en oeuvre
Le tramway, dessiné comme le fil conducteur d’un continuum urbain particulier, a été l’acte déclencheur d’un projet basé sur l’installation d’un « milieu habité » dans cet espace industriel.
Son tracé introduit l’idée d’une « scénographie urbaine » qui existe avant l’urbanisation par la découverte des grandes silhouettes des silos et des grues du port ou de l’architecture régionaliste de la COOP.
Le bâti futur est pensé comme une « installation ». L’analogie avec l’idée « d’installation artistique » affirme notre volonté de ne pas rompre la magie des espaces ouverts existants tout en installant des « marqueurs urbains ». Horizontaux ou verticaux, grands ou petits, continus ou isolés, ces ensembles bâtis, associés au contexte de chacun des sites, devront s’effacer ou au contraire s’affirmer pour composer un « travelling urbain » harmonieux, mémorisable et lisible dans le mouvement du tramway. C’est une vision diurne et nocturne qui sera pensée dans une conception héliographique comme par la mise en lumière.
Chaque quartier aura sa propre logique programmatique et spatiale en veillant à la diversité comme à la complémentarité des lieux qui composeront cette chaîne urbaine.
La prise en compte du temps comme outil de conception
Un projet d’une telle ambition et d’une telle ampleur impose une réflexion sur le temps : celui du projet comme celui de la vie sociale. Ce temps s’exprime par les caractéristiques du « déjà là » et par la nécessité du « faire avec » : vivre au contact du port, intégrer les mobilités et les contraintes industrielles, interpréter les valeurs patrimoniales… Dans un tel contexte, nous voulons installer l’idée que, dès la mise en service du tramway, le « travelling urbain » doit être une réalité avant même que la ville ne soit stabilisée. Nous concevons cette démarche comme un vaste chantier de préfiguration et d’usages temporaires permettant l’appropriation progressive des lieux. À terme, nous voulons promouvoir une ville des petits investissements où les petits projets s’insèrent harmonieusement dans les grands pour créer la vie, la diversité et l’identité de ce site unique.
Par la nature du lieu et de l’époque, l’idée d’un « laboratoire urbain » s’impose à nous. La « vie avant la ville » pourrait en être le slogan.

Un projet transformateur au bord du Rhin

Un ouvrage d’art conçu par l’agence

Le projet dans son ensemble
Pendant de nombreuses années, la planification urbaine de l’agglomération de Rennes s’est basée sur le concept de cités suburbaines satellites. La commune de Cesson-Sévigné, sur le territoire de laquelle est menée cette étude, en fait partie.
L’étude propose de prendre le contre-pied de ce concept en insistant sur les continuités et propose la création de champs urbains pénétrant dans l’espace urbain. En parallèle, la forêt domaniale de Rennes est elle aussi étendue jusqu’au cœur de l’agglomération. Cette offensive du paysage rural et forestier permet d’inverser le regard et de redonner une structure à ces zones péri-urbaines.
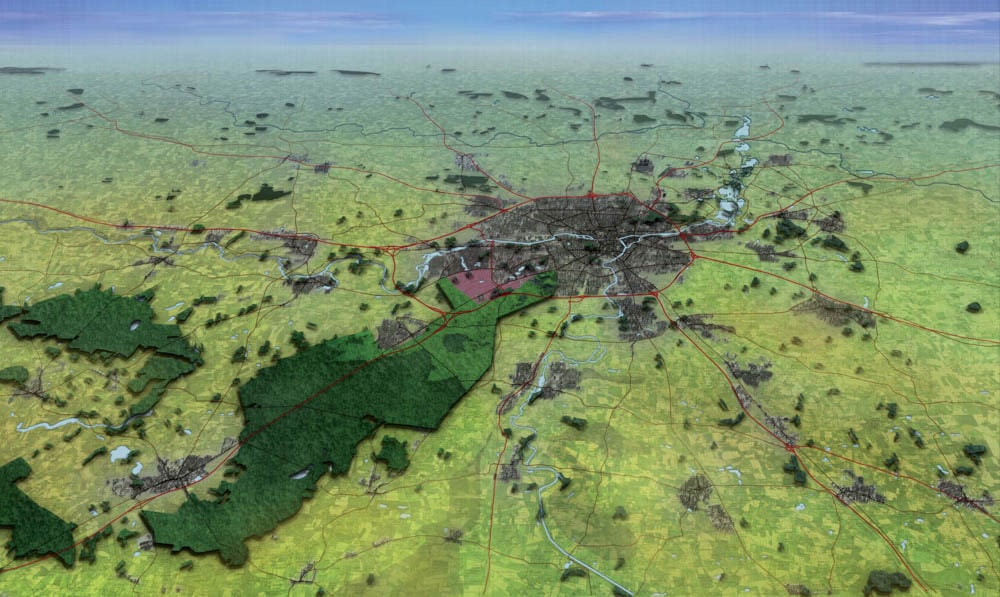
Relier la forêt à la Vilaine à travers le SINE
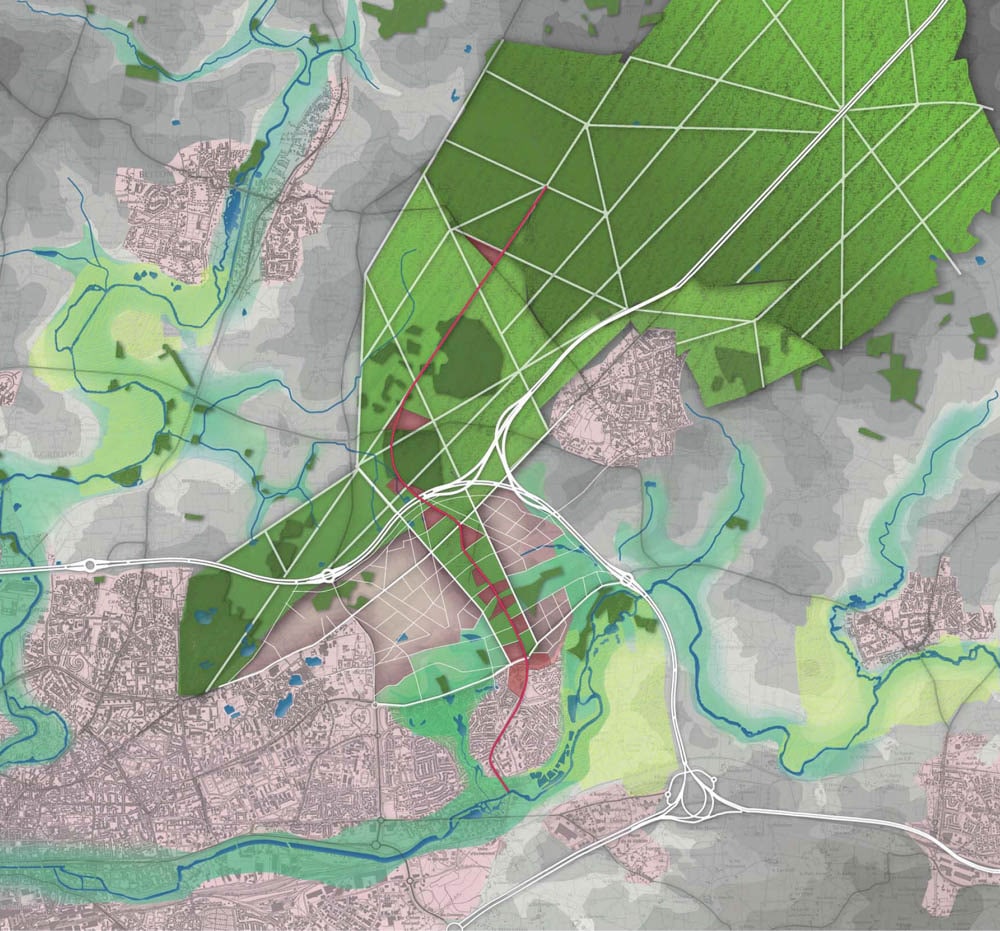
Une grande césure paysagère relie la forêt aux zones humides le long de la ligne de crête
Les logiques actuelles de fonctionnement et de mobilité dans la plaine du Var correspondent à un gaspillage des ressources qu’il faut transcender. Il s’agit de la dernière grande réserve foncière de l’agglomération niçoise, il est donc impératif d’imaginer un cadre de vie moins consommateur d’espace, de temps et d’énergie.
Une stratégie à 15 ans
Nous proposons d’entrecouper des zones bâties denses par des terrains agricoles de grande taille. Cette alternance de surfaces bâties et non se couple à une stratégie de vis-à-vis de part et d’autre du fleuve : à une zone agricole sur une rive correspond sur l’autre une poche d’urbanisation dense.
Nous irions progressivement vers le seuil minimum des 260 ha. À 15 ans, nous suggérons de conserver 65 ha supplémentaires dans la partie Sud de la plaine, afin d’éviter qu’une trop forte offre foncière n’aboutisse à un mitage généralisé.
Nous avons défini 8 zones agricoles et naturelles, de surface variant de 20 à 156 ha, en groupement de 50 à 180 ha.
Certaines zones devant assurer la résistance face à l’urbanisme étalé, d’autres anticipant notre proposition de ville-jardin extensible sur l’ensemble de la plaine, ou bien encore ayant vocation à devenir une zone de loisirs non constructible.

Développer une densité forte autour du pôle d’échanges TGV-Aéroport
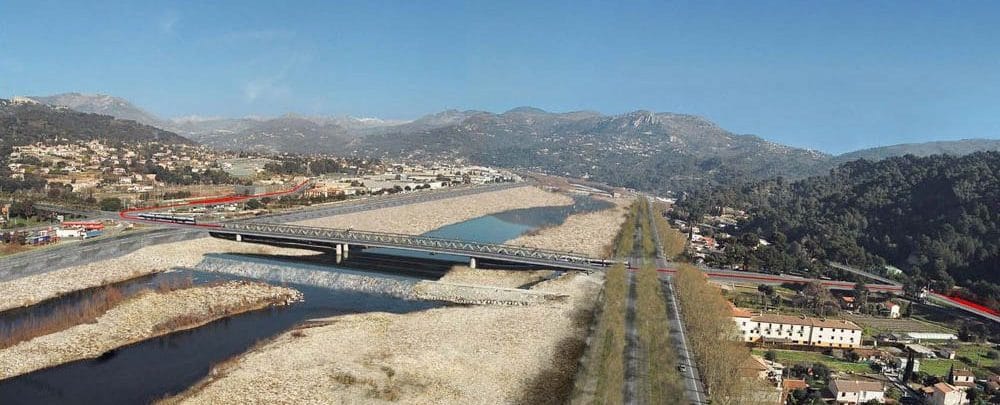
Retraiter les infrastructures et le lit mineur du Var

Préserver de vraies coupures agricoles
Le SCOT du Val de Rosselle recouvre l’essentiel du bassin houiller de l’Est mosellan. Dans un contexte économique très difficile, dans une région qui perd de la population, l’objectif de ce SCOT est d’élaborer une stratégie permettant d’enrayer et d’inverser la tendance.
C’est donc un SCOT/projet avec une forte dimension transfrontalière basé sur trois grands principes :
- changer le regard sur le territoire en créant un parc naturel constitué de la forêt du Warndt
- créer un transport public fédérateur relié à la ville centre : Sarbrucken
- canaliser les investissements publics vers quelques objectifs prioritaires et éviter la dispersion actuelle.

Concentrer les investissements sur quelques cibles : le site du Musée de la Mine
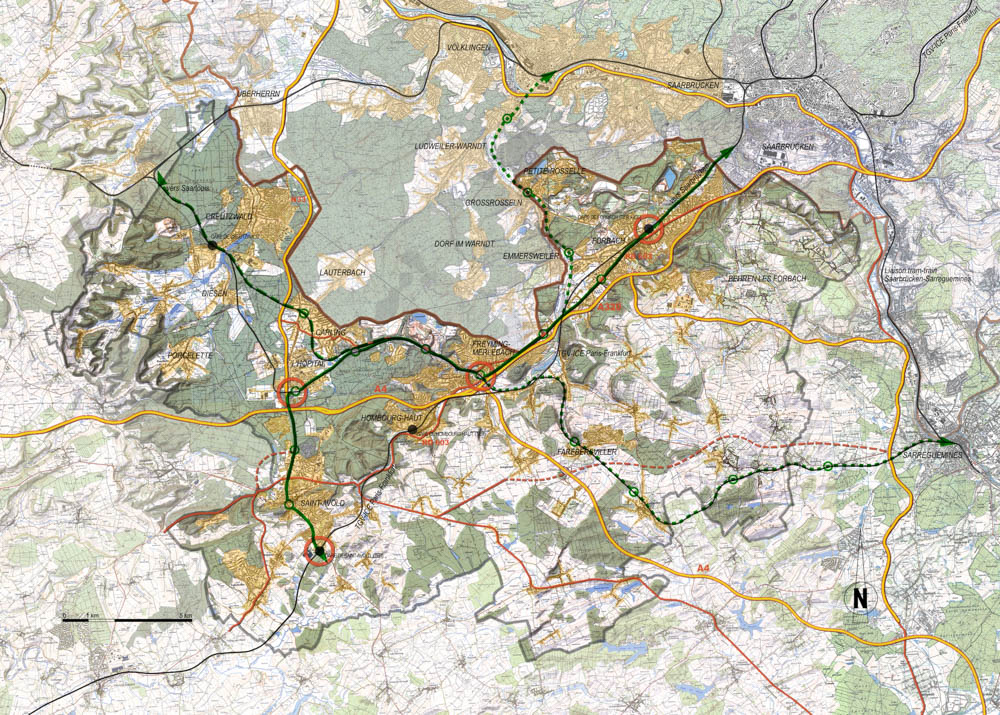
Faire du projet du tram-train l’ossature de la mobilité transfrontalière et du renouveau urbain
Les effets de la consommation d’espace exponentielle, de la prédominance de l’automobilité et de l’accélération des mécanismes ségrégatifs interrogent les capacités du territoire à supporter durablement le mode de développement actuel.
Le territoire, par nature limité et donc rare, n’est-il pas le bien le plus précieux ?
Les espaces naturels et agricoles ne peuvent plus être considérés comme la simple variable d’ajustement de la croissance urbaine.
Le SCOT de Montpellier fut une référence de SCOT « projet » basé sur un rapport ville/nature totalement inédit. La fiche de l’opération Ode à la Mer (1-A-10) est une application concrète de cette vision stratégique.

Carte des armatures naturelles et agricoles
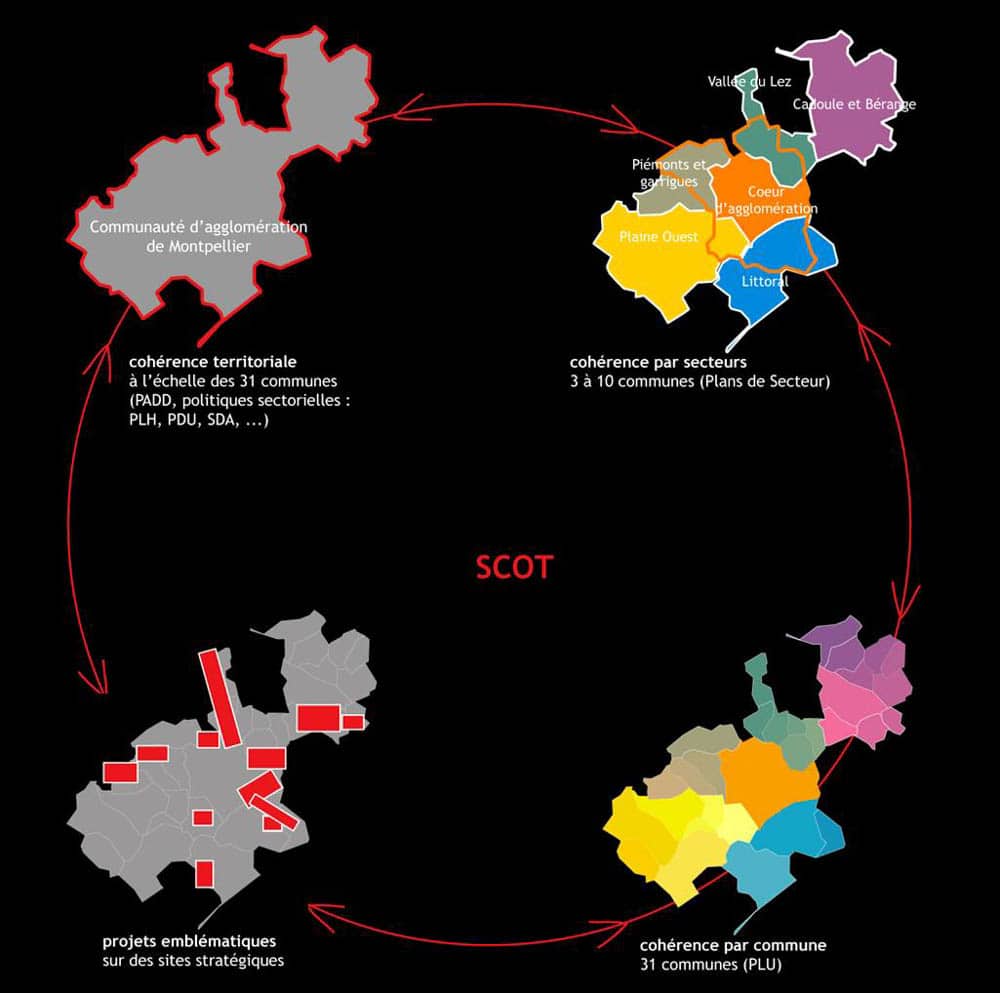
L’esprit du projet
La question climatique
Si nous ne faisons rien, la température parisienne avoisinera en 2100 celle de Cordoue.
Nous avons travaillé avec l’équipe de recherche de Météo France sur l’hypothèse d’une régénération globale des forêts, d’une diversification de l’agriculture et d’une augmentation des surfaces humides de la région parisienne. Nos calculs montrent qu’il est possible d’agir sur une amplitude de deux degrés.
Cette action, simple et peu onéreuse, contribue à redéfinir le paysage parisien tout en alliant un objectif économique à de meilleures conditions d’habitat et de loisirs indispensables à l’émergence d’une grande métropole durable.
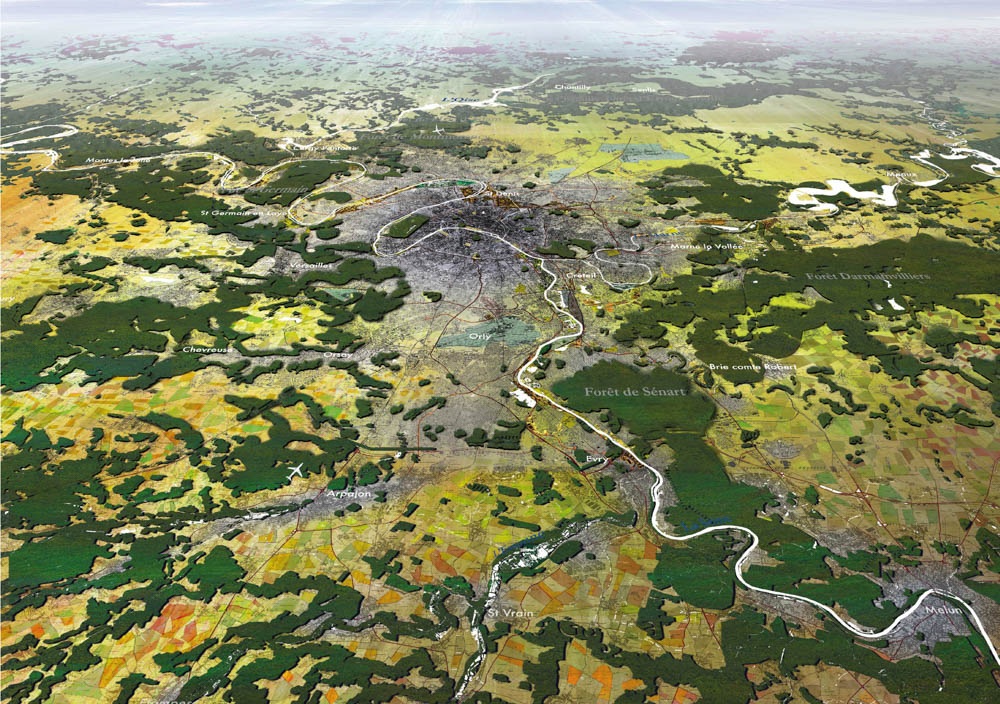
Vue d’ensemble de la métropole

-2°C : grand paysage et confort métropolitain